Pierre Georis (anciennement secrétaire général du MOC)
Les coopératives ouvrières chrétiennes ont une longue histoire, commencée en 1886 et qu’on ne reprendra pas ici, sauf à en poser quelques jalons[1]. Pour faire face aux exigences du marché, les coopératives de production ont eu besoin de financements : pour l’assurer, une série de coopératives (sous)-régionales ont été créées en vue de collecter de l’épargne. Une première coordination de tout cela s’opérera en 1935 avec la création de la Fédération nationale des coopératives chrétiennes (FNCC). La dénomination se transformera en « Groupe C » en 1972.
Se mettre en coopérative est une option de défense de valeurs : l’entraide, la solidarité, la gestion démocratique, la responsabilité sociale. Il n’en reste pas moins que la coopérative doit trouver sa place sur un marché, proposer un produit ou un service qui trouve un débouché ; autrement écrit, il s’agit d’une entreprise qui, comme toutes les autres, doit parvenir à l’équilibre économique, faute de quoi elle disparaît. L’histoire des coopératives n’est dès lors pas un fleuve plus tranquille que celui de l’histoire économique générale. Ainsi certaines entreprises de la coopération chrétienne peuvent-elles avoir été florissantes à une époque et néanmoins disparaître à l’époque suivante. Le cas le plus exemplatif est sans doute celui du « Bien-Être », une chaîne de magasins particulièrement prospères durant les années 1950 et 1960, qui s’est ensuite effondrée faute de s’accrocher à temps et en heure au nouveau modèle de la grande distribution. L’imprimerie SOFADI mourra elle-aussi d’avoir perdu son principal client, le journal La Cité, lui-même décédé peu de temps auparavant (1995)[2].
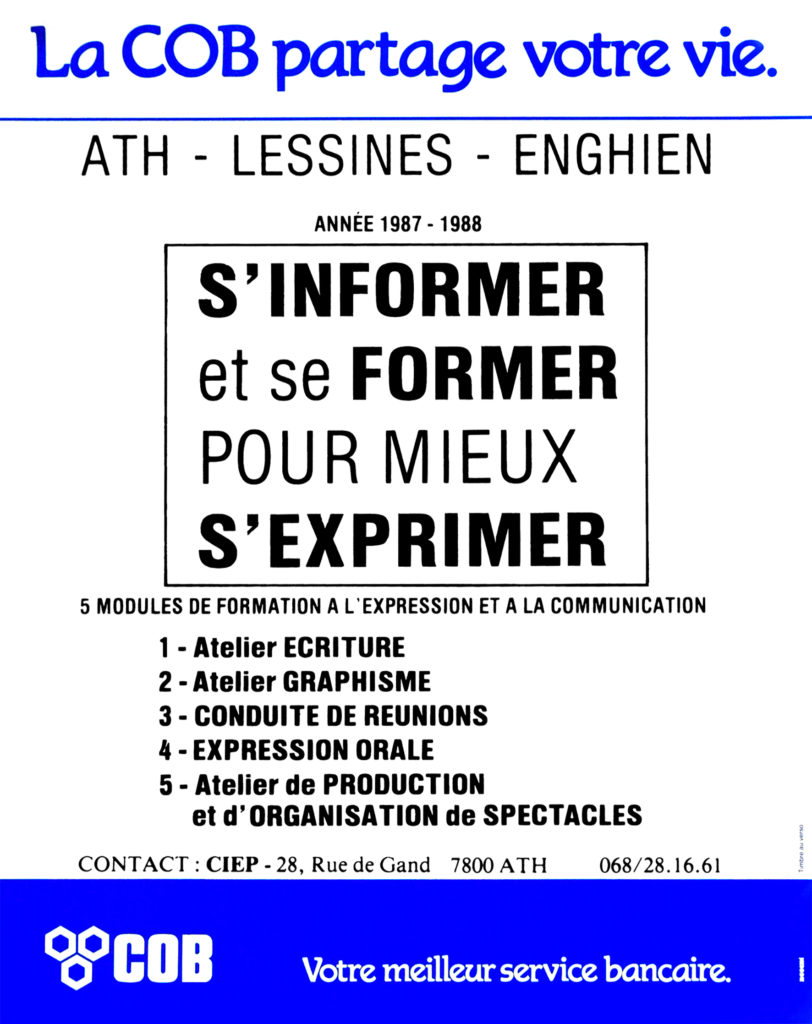
Au rang des coopératives : une banque d’épargne, la COB, Caisse ouvrière belge, qui deviendra BACOB[3] (en sorte d’avoir une marque unique pour couvrir la Belgique plutôt que BAC pour les néerlandophones et COB pour les francophones), et une compagnie d’assurance DVV-Les Assurances populaires (Les AP). Le départ de ces initiatives de services financiers était pédagogique et pratique : apprendre l’épargne et à se couvrir contre des risques, tout en offrant les outils utiles pour y parvenir. C’est assez largement par l’intermédiaire des organisations du Mouvement ouvrier chrétien (MOC), en particulier syndicat et mutuelle, que des personnes deviennent clientes de la COB. Les coopérateurs des coopératives FNCC de financement sont quant à eux largement recrutés parmi la clientèle de la COB. Au-delà de la rémunération de l’épargne de ses clients, la COB devient un acteur de l’accès à la propriété par la voie du crédit hypothécaire ; à tout coopérateur d’une coopérative financière FNCC, elle offre un avantage sur le taux d’intérêt du crédit accordé. Le MOC est quant à lui rémunéré pour son apport de clientèle. Tout un circuit est en place qui, in fine, soutient le mouvement coopératif : le MOC apporte des clients à la COB et perçoit une commission commerciale qui contribue au financement de ses activités d’éducation populaire ; la COB apporte des coopérateurs aux coopératives financières de la FNCC et offre des avantages aux coopérateurs recrutés[4] ; lesdites coopératives financières financent les coopératives de production et de service. Au fil du temps et de sa croissance, la COB/BACOB contribuera aussi à financer l’État, ainsi que des hôpitaux, des écoles, des maisons de repos : une banque pour le non-marchand.
Création du Groupe ARCO
Pour beaucoup d’acteurs de ce réseau coopératif, les années 1980 sont compliquées ; la réorganisation est nécessaire. La création du « Groupe ARCO » en 1990 est le résultat de cette restructuration, qui simplifie et rationalise un système jusque-là très éclaté. Pour des raisons de facilité, on dit « ARCO » mais c’est d’un « groupe » qu’il s’agit, comprenant plusieurs sociétés et des filiales. L’organigramme précis et le dessin des liens entre les sociétés n’est pas prioritaire pour notre propos à vocation généraliste.
Retenons simplement que le système est à trois niveaux. Le premier est celui des coopératives de financement. La principale est ARCOPAR, qui est le produit de la fusion des 28 coopératives sous-régionales de financement. C’est la société qui continuera à recruter de nouveaux membres, et qui en compte les plus nombreux[5]. L’argent récolté est placé dans deux holdings, c’est-à-dire des sociétés de gestion de portefeuilles ; ces holdings constituent le deuxième niveau de l’organigramme du groupe. L’une d’entre elles, ARCOFIN, gère les participations dans les sociétés financières : elle est la propriétaire de BACOB et DVV/LesAP, qui peuvent donc être situées en troisième niveau de l’organigramme. L’autre, AUXIPAR, est holding ayant participations dans des sociétés industrielles et commerciales. C’est important à dire car c’est souvent éludé : ARCO a aussi été propriétaire de EPC (de l’ordre de 600 emplois dans la distribution de produits pharmaceutiques et dans le réseau « Familia » de pharmacies principalement wallonnes)[6]. Les autres investissements ont été diversifiés, dans des perspectives de soutien à l’économie belge et de développement durable. Ils se sont faits dans les secteurs de l’énergie (éolienne pour la production, Elia pour la distribution), l’épuration des eaux, le logement social, les télécommunications (Belgacom), le traitement des déchets, une société publique (flamande) d’investissements, d’autres outils de financement de l’économie sociale (CREDAL côté francophone et Hefboom côté flamand)[7].

Complémentairement, le Groupe ARCO a organisé un service juridique de défense de ses coopérateurs, et un service d’achat groupé de combustible. Il a offert des services d’audit à des sociétés et associations demandeuses (le MOC en a bénéficié plus d’une fois, pour lui-même et pour « Loisirs & Vacances » son service de tourisme social), assuré la gestion des ASBL PROCURA (flamande) et SYNECO (francophone) pour informer et accompagner les projets non-marchands et/ou d’économie sociale, sauvé des équipements de tourisme social (Duinse Polders à Blankenberge et Sol Cress à Spa) en les reprenant dans une ASBL spécifique (SOFATO), offert de nombreux sponsoring à des initiatives et projets ponctuels.
Si on veut juger complètement et équitablement, il faut retenir d’ARCO que le Groupe ne faisait pas que dans la banque et l’assurance même si, par la force des choses, c’est 80 % des moyens qui y étaient investis. La ventilation des coopérateurs était de l’ordre 87 % Flamands-13 % francophones[8]. Cette réalité basique explique que l’essentiel de l’activité s’est joué en Flandre sans pour autant que, on vient de le voir, la Wallonie soit abandonnée. Dans le système, par la force des choses, les acteurs francophones étaient très minoritaires ! Pour renforcer la position relative, il aurait fallu plus de coopérateurs francophones ; mais, malgré les efforts, on n’y est jamais arrivé. Ceci écrit, il ne faut pas confondre : être minoritaire n’a jamais signifié être victime de maltraitance ! Dans les conseils d’administration, les francophones disposaient d’une représentation supérieure à leur poids objectif et disposaient également d’un administrateur indépendant (à comprendre dans le sens : pas un responsable salarié du MOC et des organisations, mais un académique disposant de l’expertise suffisante à utilement épauler le collectif).
De BACOB à Dexia
La signature de l’Acte unique européen (1987) accélère l’intégration économique des pays de l’Union dans une logique de marché : dans tous les secteurs, la concurrence se renforce ; on observe des mouvements de concentration. Pour BACOB, son statut de « plus grande des petites banques belges » n’était pas suffisant à la rassurer sur son avenir à moyen terme, a fortiori eu égard à son profil. Elle s’est cherché des partenaires, dans une perspective d’établissement de complémentarité des métiers. Nous n’entrerons pas ici dans toutes les péripéties[9] : ces démarches ne vont jamais toutes seules, simplement ou sans échec. Le moment clé a été la reprise de Paribas Belgique (1997)[10] : avec une clientèle d’entreprises et de personnes lui confiant la gestion de leur patrimoine, Paribas n’était absolument pas concurrente de BACOB. On mettait ensemble deux structures en sorte d’offrir un service bancaire sensiblement élargi. Pour bien marquer qu’elle ne relevait plus de sa maison mère française, Paribas Belgique a été rebaptisée ARTESIA. En 1999, la coupole pour les activités BACOB-LesAP-ARTESIA prendra le nom Artesia banking corporation (ARTESIA BC).
L’épisode ARTESIA n’a été qu’une transition. Au tournant du 21e siècle, époque de l’introduction de l’euro (précisément le 1er janvier 1999), quand la réalité économique du marché européen pouvait désormais être « touchée du doigt » concrètement, y compris par le citoyen lambda manipulant les nouvelles pièces et billets désormais identiques pour un nombre important de pays, l’ambition était de construire du neuf à la mesure de l’enjeu : une grande banque européenne spécialisée dans le financement des fonctions collectives, c’est-à-dire les pouvoirs locaux et le non-marchand, en particulier les hôpitaux, les écoles… Qui donc pouvaient être les « partenaires naturels » d’un tel projet ? Pour ce qui concerne la Belgique, le paysage était assez simple : il y avait le Crédit communal et Ethias, respectivement banquier et assureur des pouvoirs locaux. On est dans un schéma qui est autre chose que celui d’une banque classique, celle qui cherche surtout à « faire du chiffre » au profit d’actionnaires et d’intérêts purement privés ; ici, si du chiffre est fait, il l’est pour des actionnaires qui réinvestissent dans l’action publique et sociale ! Car c’est bien de cela qu’il s’agissait : les dividendes de la banque étaient reversés à des actionnaires qui, pour les uns, contribuaient à donner plus de confort aux finances communales, pour les autres in fine contribuaient au financement de l’action sociale. Si on veut bien ne pas faire d’anachronisme, c’était un projet parfaitement défendable dans le MOC et ses organisations. Il pourrait d’ailleurs le rester !
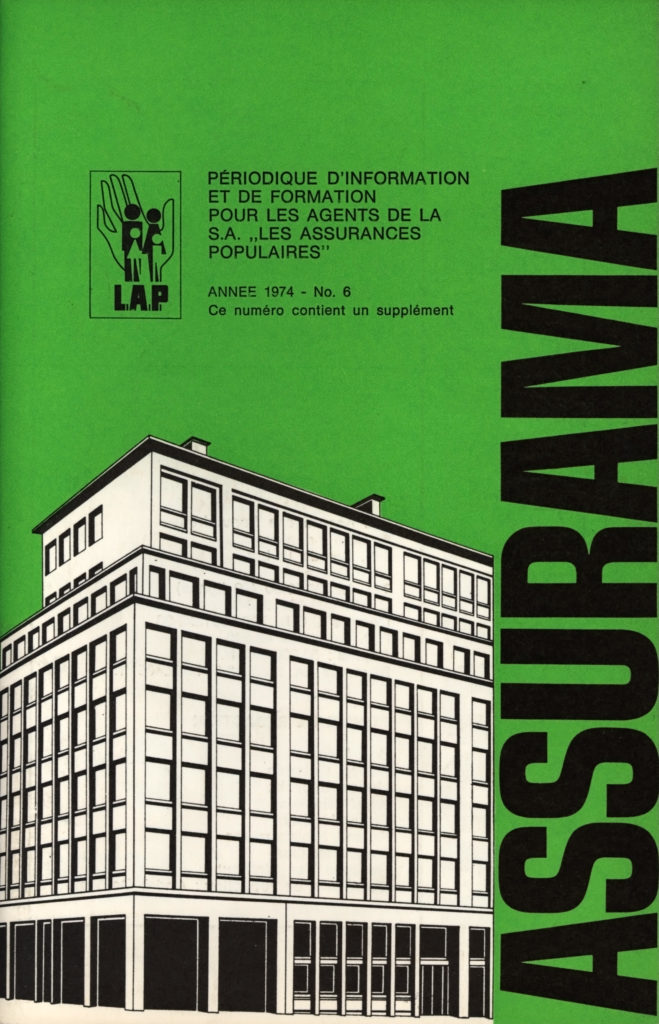
Mais ce n’est plus à proprement parler avec le Crédit communal de Belgique qu’on jouait car celui-ci s’était déjà mis en cheville avec un homologue, le Crédit local de France[11]. Leur fusion avait créé Dexia[12] dès 1996. Le Holding communal regroupait les participations des communes belges : c’est par son intermédiaire qu’elles étaient actionnaires de la banque. Ainsi, Dexia était-elle la banque des communes et des provinces en Belgique d’une part, des municipalités et autres entités locales en France d’autre part : il y avait changement d’échelle. Le processus se continuait : en 2000, la branche française de Dexia faisait l’acquisition de l’américaine Financial Security Assurance Inc. (FSA). Avec ce rachat (accompagné d’autres encore, par exemple CREDIOP en Italie), Dexia devenait le leader mondial des services financiers au secteur public !
C’est donc avec Dexia que s’échafaude le projet de grande banque pour le financement des fonctions collectives. Une série d’opérations se mènent en 2001-2002 qui ont pour résultat que l’ensemble ARTESIA BC, BACOB et Les Assurances populaires est intégré dans Dexia Belgique (une fusion par absorption), tandis qu’ARCOFIN devient l’actionnaire principal de Dexia SA, la holding chapeautant les « Dexia nationales ». Le groupe d’assurances publiques Ethias, perçu comme proche du monde socialiste et particulièrement présent en Wallonie monte dans le train en même temps. Du point de vue des équilibres politiques et communautaires belges (socialistes et chrétiens, Flamands et francophones), c’était « tout bon ». L’opération est particulièrement bien accueillie par les agences internationales de rating, celles qui donnent des cotes aux acteurs économiques et aux pouvoirs publics. Avec une bonne cote, on gagne la confiance des marchés, on bénéficie d’une meilleure position pour emprunter à des conditions avantageuses[13].
Dans Dexia, la composition des instances est partagée entre Français et Belges. Le Groupe Arco va « peser » de l’ordre de 18 % de l’ensemble : suffisant pour exercer une influence[14] mais insuffisant pour imposer une décision, sauf à parvenir à construire les alliances utiles, ce qui est par ailleurs arrivé. Car, le management de Dexia poursuivait sa politique d’expansion au niveau international. Des investissements nouveaux semblant particulièrement imprudents, ARCO est parvenu à les empêcher, au prix de grandes tensions entre lui et le management : en particulier, dès 2004, l’achat de San Paolo IMI, troisième banque italienne, a été bloqué par l’alliance des actionnaires belges. Il est absolument inexact de dire qu’ARCO se serait simplement « laissée faire » par le management (car c’était un projet du management), qu’il ne serait pas intervenu à temps et à heure ; au contraire, dès cette époque, il a tenté de brider l’expansion aventureuse et y est parvenu pour partie.
Témoignage d’un acteur du dossier ARCO
Dans la corbeille du cahier des charges d’un nouveau secrétaire général du MOC en 2005 figurait la reprise d’une série de mandats dans le groupe ARCO. L’auteur est ainsi devenu administrateur d’ARCOPAR, ARCOPLUS et ARCOSYN[15] dès le mois de novembre, juste à temps pour observer l’effondrement du système depuis l’intérieur de quelques-uns de ses lieux de décision, à vrai dire dans un sentiment de grande impuissance, et ce jusqu’à la décision de dissolution volontaire (décembre 2011). Il a par ailleurs été administrateur de deux ASBL du périmètre : SOFATO et SYNECO[16], qui ont survécu à la dissolution, parce qu’on y a veillé : dans ces cas, les mandats de l’auteur se sont terminés en même temps que l’exercice de la fonction de secrétaire général MOC (novembre 2020).
À ce moment du récit, le registre change : on sort de la contextualisation préalable pour entrer dans un espace qui est celui du témoignage, avec son inévitable part de subjectivité et aussi un côté (auto)justificateur qu’il serait inutile de nier. En particulier, la longue séquence de crise, accompagnée de sa tempête politique et médiatique pour déboucher sur la décision de dissolution, n’a pas été sans impact sur le moral militant. Les interpellations ont été nombreuses, souvent vigoureuses, de la part de militant.e.s du MOC et ses organisations, légitimement déçus, désappointés, parfois pleins de colère. On ne reprendra pas ici tout l’exposé factuel pointu relatif à la dissolution : il existe par ailleurs[17]. On se limitera à synthétiser les réponses aux questions qui nous ont été le plus souvent posées. La conviction intime est que, au cœur de la séquence dramatique, les instances ont systématiquement pris les décisions les plus rationnelles eu égard aux informations disponibles et à un environnement aux évolutions très incertaines. Ce qui suit est dès lors un autre récit que celui qui a été largement répercuté par « les gens qui ne nous aiment pas » et qui, tant qu’à faire, ne peuvent que se réjouir de l’affaiblissement d’un des pôles du mouvement ouvrier. À tout le moins, la mémoire de l’événement mérite d’être nuancée : notre espoir est de parvenir à y contribuer. Cela n’exonère pas de toute erreur le collectif auquel nous avons participé et dont nous partageons collégialement la trajectoire. Mais l’accent médiatique a été à ce point mis sur lesdites erreurs, réelles ou supposées, qu’il convient de faire exister aussi un espace pour la défense, en sorte qu’en finale le procès puisse être considéré comme équitable.
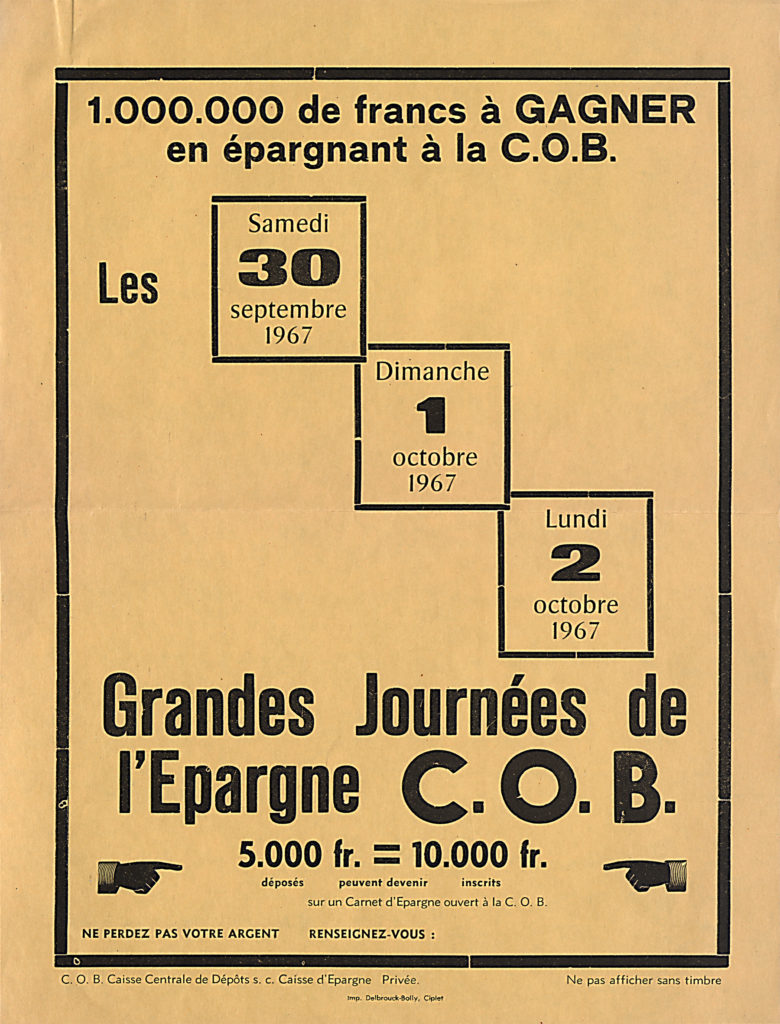
On gardera à l’esprit que le processus de liquidation n’est pas terminé au moment où les présentes lignes sont écrites ; il est retardé notamment parce que des procédures sont toujours en cours devant des tribunaux. Sur certains points d’un dossier particulièrement complexe, la vérité judiciaire doit dès lors encore s’exprimer : il en résulte que le commentaire a le devoir d’être prudent à leur égard.
Tout ceci écrit, il faut bien l’admettre, devenir administrateur ARCO quand on vient du MOC c’est un « choc » tant on est dans des registres différents de ceux qu’on pratique habituellement : on est dans l’animation, l’organisation d’un travail d’éducation permanente, la gestion d’ASBL qui sont comme autant de PME ; voilà qu’on plonge dans le monde de la gestion principalement financière ; on n’y est pas préparé. Certes, les réunions de conseils d’administration ne sont pas vraiment différentes de celles auxquelles on est habitué : autour d’une grande table, avec boissons et biscuits ; ordres du jour un peu (souvent) fastidieux ; grosses documentations fournies ; essentiellement le management à la manœuvre pour s’expliquer devant des administrateurs dont la fonction est principalement d’interlocuteurs questionnant puis validant (ou pas) les propositions qui leur sont faites ; à l’exception de la présidence et de membres du comité de direction, le principe est iedereen spreekt zijn eigen taal zonder vertaling, « chacun parle sa propre langue sans traduction », ce qui signifie concrètement que la majorité du temps de réunion se tient en néerlandais puisque les francophones y pèsent le quart des participants[18]. Même si sa formation universitaire lui avait donné des bases relativement aux modèles macroéconomiques et si les fonctions professionnelles antérieures avaient équipé à la gestion des entreprises, l’auteur s’est senti très démuni : la finance, c’est un tout autre « chapitre » de l’économie ; pour s’y retrouver, il faut des prérequis qui, d’évidence, n’étaient pas maîtrisés. Les premières vacances disponibles, celles de l’été 2006, ont dès lors été mises à profit : pendant plusieurs semaines, le cerveau s’est mis en « mode blocus », vous savez, si vous avez fait des études supérieures, ces périodes exceptionnelles durant lesquelles on est capable d’absorber un volume considérable d’informations et de connaissances nouvelles. Si, au final, on réussit l’examen, c’est comme si on avait accompli une performance athlétique : on en sort épuisé mais heureux. Ce sont quelques milliers de pages spécialisées qui ont pu être parcourues. L’avantage est que, comme on avait huit conseils d’administration derrière soi, on avait pu lister toutes les questions pour lesquelles on souhaitait réponses ; il n’était pas nécessaire de tout lire du début à la fin de ce qu’on avait collationné, mais d’y repérer l’utile et de faire toutes sortes d’allers-retours. Il n’y avait pas d’autre examen que la participation aux conseils à partir du mois de septembre. La satisfaction y a été intense ! Dès ce moment en effet, si on devait être interrogé à l’improviste à la sortie sur ce qui s’était discuté en séance, les décisions prises et leurs raisons, on savait le faire : désormais la compréhension de ce qui s’y passait était avérée ; on pouvait se considérer comme interlocuteur. D’autant qu’on était aidé par une documentation systématique et de qualité.
2008, première séquence de crise
Que s’est-il donc passé en 2008, première séquence de la crise ? La filiale américaine FSA a été directement touchée par l’effondrement du marché immobilier américain et la crise des crédits subprimes.
Les subprimes
Ce terme désigne des prêts immobiliers à des Américains à faibles revenus. Avec l’aide de ce crédit bon marché, les Américains achètent de plus en plus de logements. La loi de l’offre et de la demande joue alors à plein : avec une forte demande, et des constructions nouvelles qui ne suivent pas le rythme, les prix de l’immobilier augmentent. Comme les biens à acquérir deviennent plus chers, les Américains s’endettent d’autant plus fortement que les taux d’intérêts montent eux-aussi (puisqu’il y a du risque qui augmente et que les prêts risqués font l’objet d’une plus grande rémunération du prêteur). Les prêts conclus le sont à taux variables : même les emprunteurs modestes du début de cycle voient grossir les montants à verser au fur et à mesure que grimpent les taux d’intérêt. Arrive le moment où, massivement, ils n’ont plus la capacité de rembourser. Les banques se retrouvent avec un énorme parc immobilier (tous ces logements qui servaient de garantie) qu’elles ne savent revendre à personne (sauf aux enchères, à prix bradés). La banque Lehman Brothers fait faillite en 2008. Les banques ont de nombreuses transactions entre elles (elles se prêtent, s’apportent des garanties les unes aux autres…) : la faillite se répercute dans d’autres banques et, de manière générale, dans toutes les économies occidentales interdépendantes[19].
Y a-t-il matière à reproche à ARCO dans la survenance de la crise de 2008 ? En réalité, ça se joue de l’autre côté de l’Atlantique dans une filiale acquise par le pôle français avant l’entrée d’ARCO dans Dexia. À proprement parler, il n’y pas d’autre responsabilité à lui imputer que celle de n’avoir pu anticiper en 2001 une crise qui ne surviendra aux États-Unis qu’à partir de 2007. De surcroît, dès son entrée en scène, c’est ARCO qui a fait le conflit dans Dexia en sorte de mettre fin à « l’aventurisme » (voir supra : refus de la fusion avec San Paolo IMI). Toujours est-il qu’entre mai et juillet 2008, l’action Dexia perd la moitié de sa valeur. En septembre, Dexia doit trouver d’urgence des liquidités, ce qu’aucun de ses actionnaires principaux n’est en état de faire.
Dans ce contexte vient l’hypothèse d’une scission entre les branches française et belgo-luxembourgeoise de Dexia. Elle est tout à fait crédible : réalisée, elle aurait eu pour effet de sauver la branche belgo-luxembourgeoise ; la bad bank, c’était la branche française, qui avait importé les risques subprimes dans le groupe. Le gouvernement français n’en a pas voulu. À la place, en réunion de crise, sans consultation des conseils d’administration du Groupe ARCO, les trois gouvernements belge, français et luxembourgeois, optent pour une recapitalisation à raison de trois milliards pour la Belgique, trois milliards pour la France, 376 millions pour le Luxembourg. Les trois milliards de la Belgique se répartissent en trois tiers : un à charge de l’autorité fédérale, un autre à charge des Régions, le troisième à se partager entre les actionnaires privés. Ainsi ARCO se voit-il imposer une contribution de 350 millions… qu’il n’a pas. Il est forcé à l’endettement par l’emprunt… auprès de Dexia, mais aussi auprès des organisations sociales : Confédération des syndicats chrétiens (CSC), Mutualités chrétiennes et ACW (le MOC flamand[20]). Avec l’entrée d’actionnaires publics dans le capital de Dexia, le poids d’ARCO y diminue (il passe de 18 à 13 %).
Complémentairement, les États apportent une importante garantie aux banques qui prêteraient à Dexia SA. C’est clair, ça crée du risque pour les États, en particulier la Belgique qui en prend le plus lourd (60,5 %). Mais il faut bien comprendre la pièce dans laquelle on joue. Ce « cadeau » fait l’objet d’une rémunération par Dexia[21] : si la garantie n’est pas actionnée – à ce jour, elle ne l’a pas été – dans l’affaire, l’État « gagne de l’argent » chaque année. La garantie est à durée déterminée (à l’époque jusque 2014, mais ça sera bousculé et aménagé par les événements ultérieurs). Par ailleurs, le montant est un plafond : Dexia n’a pas demandé la garantie à hauteur du plafond. Enfin, l’engagement de l’État (le risque qu’il prend) diminue au fur et à mesure des remboursements des emprunts par la banque.
Pour sortir de tensions et de critiques, les gouvernements décident encore d’un changement à la direction du Groupe. À cette occasion, l’ancien Premier Ministre belge, Jean-Luc Dehaene (CD&V) entre dans le Conseil d’administration de Dexia et en assume la présidence, au côté d’un nouveau CEO français, Pierre Mariani[22].
Entre les deux séquences de crise (2008 et 2011)
Dexia entreprend une restructuration tant au niveau de ses filiales que sur le plan social. Cela porte ses fruits : pendant deux ans, le redressement s’observe, de façon à vrai dire assez spectaculaire. Même l’américaine FSA a réussi à être vendue ! En toute bonne foi, on pouvait penser que, certes, il s’était agi d’un « trou de souris », mais on y était passé !
Complémentairement, dès 2008, ARCO fait un appel à ses coopérateurs : de nouveaux fonds sont souhaitables, qui sont collectés. D’autre part, pour protéger les coopérateurs qui ont plus à voir avec le profil du petit épargnant qu’avec celui du spéculateur capitaliste, le groupe ARCO obtient du gouvernement fédéral que le mécanisme de protection par l’État de la petite épargne soit élargi aux parts de capital investi dans des sociétés coopératives par des personnes physiques, de même d’ailleurs que la protection du capital des sociétés coopératives agréées. Il faut malheureusement attendre le 10 octobre 2011 pour qu’aboutisse la promesse de 2008 ! Dès ce moment, la garantie de l’État a été élargie aux coopérateurs personnes physiques du groupe ARCO et, de manière générale, de tous les groupes coopératifs : ce qui vaut pour ARCO vaut aussi pour les autres[23]. En suite de procédures juridiques, cette garantie sera ultérieurement cassée par le Conseil d’État (2018) : elle n’aura finalement rien été d’autre qu’une virtualité pendant 7 ans.
|
Deux garanties d’État différentes Il convient de bien voir qu’il y deux garanties d’État différentes dans le jeu : l’une pour protéger les prêts de banques à Dexia ; l’autre pour protéger la petite épargne (une « vraie » petite épargne de quelques milliers d’euros, très loin du plafond des 100 000 € garantis pour les carnets d’épargne classiques). La première ne fera que l’objet d’une contestation limitée[24]. La seconde sera violemment attaquée autour de l’argument que la garantie créerait une discrimination à l’égard des actionnaires classiques n’en bénéficiant pas. Cela est à comprendre dans un contexte où Dexia n’était pas la seule banque dans la tourmente : Fortis également, dont l’actionnariat était composé d’un très grand nombre de particuliers dont le réflexe – compréhensible – a été de penser « Pourquoi eux et pas nous ? ». |
Le dossier devient très politique : pour certains acteurs, le blocage d’une solution est aussi l’occasion d’affaiblir des organisations sociales jusque-là particulièrement puissantes en Flandre, ainsi que le parti politique qui se présente comme leur relais (CD&V). Dans le jeu, la N-VA (nationalistes flamands) sera particulièrement déchainée. ARCO ne trouvera pas de réels relais dans le monde politique : aucun parti ne s’est senti concerné, à l’exception du CD&V, cependant fortement affaibli.
Se joue également une bataille sémantique : les adversaires d’ARCO s’acharnent à nommer les coopérateurs comme « actionnaires », semant par le fait même une grande confusion dans l’opinion publique ! Comme si un coopérateur à participation modeste dans un projet à visée sociale était comparable à l’actionnaire visant la maximisation du rendement de ses placements !
2011, seconde séquence de crise : celle des dettes souveraines
À partir de mai 2011, le Groupe Dexia connaît de nouvelles difficultés, nettement plus significatives, cette fois liées à son exposition aux dettes souveraines d’États européens (notamment la Grèce, l’Espagne, l’Italie). Soyons francs, ne faisons pas d’anachronisme : qui aurait pu prévoir des impossibilités de remboursements de dettes contractées par des États européens, qui plus est de la zone euro ? Qui aurait pu considérer qu’il fallait cesser de prêter à des États européens ? Plus précisément, qui aurait pu anticiper des défauts de paiement sur la dette grecque alors que celle-ci représentait moins de 3 % des dettes européennes consolidées[25] ?
Dettes souveraines
La notion de « dettes souveraines » vise les dettes des États (et des entités qui leur sont liées). En l’occurrence, certains États fortement endettés n’ont plus eu la capacité de faire face à leurs échéances de remboursement.
Toujours est-il que la valeur des actions Dexia replonge. Finalement, le groupe est quand même scindé en deux branches, française et belge, la banque luxembourgeoise étant cédée et revendue par ailleurs. En suite de quoi l’État fédéral devient propriétaire de Dexia Banque Belgique et recapitalise (un investissement de quatre milliards[26]). La banque change de nom le 11 juin 2012 pour devenir Belfius Banque. Grâce à cette opération de rachat, l’État devient le bénéficiaire exclusif des dividendes versés par une banque… dont la bonne santé est depuis lors avérée ! Appelons un chat un chat : c’est d’une nationalisation qu’il s’est agi, l’État belge se (re)dotant d’une banque publique. En bout de piste, l’État a récupéré à son profit un outil en réalité rentable. Cet outil, antérieurement, était propriété de partenaires institutionnels dont ARCO et ses 780 000 coopérateurs[27]. Un enchaînement d’événements a conduit en plusieurs étapes, et sans qu’il y ait « complot », à un résultat qu’on peut considérer comme une forme d’expropriation. Si le scénario de 2008 de scission des branches belge et française n’avait pas été bloqué par l’État français, la situation aurait pu être très différente : il est vraisemblable que Dexia Belgique aurait pu traverser la tempête, en restant largement propriété (entre autres) d’une force coopérative. En 2011, gravement fragilisé par l’épisode de 2008, ARCO n’a pu que constater avec dépit qu’il n’avait plus les ressources pour intervenir.
L’opération est validée par la Commission européenne sous réserve d’un plan de restructuration de la banque. La nouvelle société Belfius garde la confiance des pouvoirs locaux, des régions et de bons nombres d’entités institutionnelles. En avril 2012, la banque représente 15 à 20 % du marché belge, avec 818 agences et quelques 5 700 emplois.
Le sort de Dexia
La SA Dexia (la holding) survit en concentrant tout ce qui n’a pas encore été réalisé et les avoirs toxiques. Le régime des garanties d’État mis en place en 2008 (voir supra) est actualisé périodiquement. Le plus important à retenir est que le travail de diminution systématique du bilan de Dexia a pour effet collatéral de progressivement diminuer le risque de devoir actionner la garantie de l’État. En retour, il y a payement d’un intérêt pour le service rendu par l’État : par exemple, le Trésor belge a touché 17 millions en 2019.
Concrètement, le risque est passé d’un niveau de 150 milliards en 2008 (dont la Belgique assumait 60,5 % soient 90 milliards) à 75 milliards pour la décennie qui a commencé au 1er janvier 2022 (et se termine le 31 décembre 2031). La Belgique en assume désormais 53 % : en 2022, le risque maximum (l’hypothèse où Dexia SA ne saurait brusquement plus rien rembourser du tout) était évalué à un peu moins de 40 milliards.
La dissolution de sociétés du Groupe ARCO
Au terme de ces multiples rebondissements, le destin des deux des grands actionnaires belges de Dexia, ARCO et le Holding communal, est scellé par des décisions de dissolution volontaire. Pour ce qui concerne ARCO, la décision tombe le 8 décembre 2011 : les différentes sociétés de collecte des participations des coopérateurs (Arcopar, Arcoplus, Arcosyn) ainsi que la filiale holding des participations en banque et assurance (Arcofin) sont confiées à un collège de liquidateurs. La filiale du groupe pour les activités industrielles (Auxipar) ne prend pas le même chemin : le choix y est de trouver des repreneurs des participations ARCO, en sorte de ne pas menacer les activités et les emplois qui en dépendent (notamment EPC). Les ASBL SOFATO et SYNECO trouveront elles aussi des repreneurs, en sorte que soient poursuivies des activités de tourisme social et de conseils aux acteurs et actrices de l’économie sociale. Autrement écrit : tout n’a pas « plongé » ; ce n’a pas été le pur et simple « sauve qui peut » ; la continuité de tout un pan d’activités a été assurée.
|
Un conseil d’administration de onze jours Dimanche 9 octobre, début d’après-midi, réception d’un coup de téléphone : « Un conseil d’administration conjoint aux sociétés ARCO est convoqué à 15 heures ». Aucun choix : il est évidemment impératif d’en être, d’abandonner ce qui était prévu et de se précipiter. Sur place, l’ambiance est crépusculaire. La tête en est déjà quasi convaincue : il faut dire « stop » ; il n’y a plus de marge pour l’action. Mais dans le ventre, on veut encore y croire : « n’y aurait-il pas, malgré tout, un tout petit passage qu’on pourrait utiliser ? ». Les discussions sont longues, plus abattues que tendues : ce ne sont pas les reproches et critiques des uns aux autres qui sont la dominante, mais la fatigue et la tristesse ainsi que l’évocation de possibles solutions. Des interruptions de séance permettent des débriefings en petits groupes tandis que des vérifications sont faites en sorte de continuer les échanges en pleine connaissance de cause. Dans la soirée, le conseil est mis en continuité : cela veut dire que la réunion n’est pas terminée, mais que chacun.e rentre chez soi. La reprise est fixée au mardi 15h. La consigne est à la plus stricte confidentialité. Les administrateurs qui n’ont pas pu rejoindre le dimanche ne seront pas admis à rejoindre ultérieurement. Et ainsi de suite, le vendredi 14 et le mercredi 19, au total quatre séquences en 11 jours, certaines se terminant très tardivement en soirée. La décision finale est bien de proposer la dissolution volontaire aux AG. Elles sont convoquées le 8 décembre dans une grande salle adaptée à l’ambiance : peu attrayante et mal chauffée, mais bien remplie. Le moment n’est pas agréable ; quelques colères s’expriment mais, dans l’ensemble, cela reste modéré eu égard à l’enjeu. En fin de séance, « la messe est dite », les dissolutions sont votées. Le collège des liquidateurs organise des assemblées annuelles au mois de juin, pour faire rapport. C’est à celle de 2012 que la colère et les agressivités se sont manifestées le plus violemment. Des huissiers ont vérifié que n’entraient que des personnes habilitées ; des vigiles ont sans doute contribué à dissuader d’éventuels gestes inappropriés ; des larmes ont coulé à la tribune, estomaquée par la violence et l’injustice de certains reproches. Depuis lors, le scénario s’est reproduit à l’identique à chaque assemblée jusqu’à la crise COVID[28] : les mêmes montent à l’assaut, avec les mêmes arguments et la même colère, pour entendre les mêmes réponses. Avec chaque fois la même surprise scandalisée des coopérateurs individuels en colère : au moment du vote, le soutien de l’assemblée au collège des liquidateurs est massif alors que l’assistance est majoritairement négative ! C’est évidemment l’effet des votes portés par les institutions, qui restent solidaires[29]. |
|
Des repreneurs L’ASBL SOFATO, gestionnaire d’équipements de tourisme social a été repris par le groupe Corsendonck (2013). La reprise s’est accompagnée d’une convention de collaboration (10 ans) avec la VZW PASAR (structure de tourisme social de beweging.net, l’homologue flamand du MOC) et l’ASBL Loisirs & Vacances (dans le périmètre du MOC). L’ASBL SYNECO a quant à elle été reprise par le MOC (2012). |
L’embrouillamini juridique
En même temps que la liquidation, un véritable embrouillamini de procédures judiciaires s’est enclenché. Sans les passer en revue[30], on peut décomposer les choses entre celles qui concernent les institutions étatiques et européennes d’une part, et celles qui sont à l’initiative de coopérateurs particuliers d’autre part.
Première série : de très longues procédures sont passées par le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle, la Cour de justice de l’Union européenne et la Commission européenne. Après épuisement des recours, les conclusions finales sont tombées en 2018. Vérité judiciaire dite, ce volet est clos. Concrètement, il faut en retenir deux choses. D’une part le Conseil d’État a annulé l’élargissement aux coopérateurs de la protection sur les carnets d’épargne[31]. Effet : les coopérateurs ne récupéreront pas leurs mises via l’État. De son côté, la Commission européenne considère que ledit système de garantie a constitué une aide publique illégale. Le raisonnement est : le bénéfice de la garantie d’État a été utilisé pour attirer de nouvelles souscriptions de coopérateurs ; ce faisant, la concurrence a été faussée sur le marché de la collecte de l’épargne[32]. En conséquence de quoi, l’État belge doit récupérer de l’ordre de 127 millions auprès d’ARCO. Autrement dit, non seulement les coopérateurs ne seront pas aidés par l’État, mais, en outre, une amende européenne va alimenter le Trésor belge ; elle sera ponctionnée sur le produit de la liquidation (diminuant par-là même le montant final à répartir entre coopérateurs).
Deuxième série : des procédures ont été lancées à l’encontre d’ARCO[33] à l’initiative de groupes de coopérateurs pas coordonnés entre eux. Au total, les diverses procédures engagent de l’ordre de 15 à 20 000 coopérateurs (soit, en réalité, une très petite minorité). On a appris qu’une des procédures en appel ne serait pas jugée avant… 2028[34] ! Il est probable que cette agitation ne donne pas beaucoup d’autres résultats probants que de considérablement retarder la clôture de liquidation (qui aurait pu être entreprise à l’issue des jugements tombés : voir série 1).
La situation des coopérateurs personnes physiques n’est dès lors toujours pas réglée au moment d’écrire la présente. Elle ne peut l’être tant que les liquidations ne sont pas clôturées. Il est évidemment exclu que l’entièreté de « la mise » soit retrouvée mais il n’est pas encore dit que, pour autant, rien ne soit retrouvé (en ce cas, ce sera peu) !
|
Les situations concrètes La situation d’un coopérateur n’est pas celle d’un autre. Objectivement, c’est sans doute le plus navrant. Dans une partie des situations, l’investissement a été récupéré, et même souvent plus que récupéré, par les avantages auxquels le coopérateur a eu accès : ainsi, par exemple, être coopérateur ARCO et conclure un prêt hypothécaire auprès de BACOB donnait lieu à une ristourne sur l’intérêt à payer pendant toute la durée du prêt (sur 20 ans, c’est un return significatif). À l’inverse, la grand-mère qui a ouvert des comptes ARCO pour chacun de ses petits-enfants est une authentique victime. |
L’impact sur les organisations sociales
Le MOC et son homologue flamand, ont subi la crise de plein fouet[35]. Au total, pour ce qui concerne le MOC, c’est un tiers des moyens structurels pour l’action politique et le travail d’éducation permanente qui a été perdu[36], avec toutes les nécessités subséquentes de restructuration. Ce pourrait être l’objet d’un autre récit.
La conviction est que, à chacun des moments de cette triste histoire, les conseils d’administration ont pris les décisions les plus rationnelles possibles sur base des informations à disposition. Les conseils ont par ailleurs été excellement documentés au mois le mois par le management, ce qui explique que tous les acteurs impliqués ont endossé collégialement la situation : aucune dissidence fracassante n’a été observée à l’occasion de la décision de mise en liquidation – c’est un indicateur sérieux.
Une crise en deux épisodes rapprochés, avec un entre-deux de redressement, ça fait passer par des montagnes russes émotionnelles ! Pour les administrateurs, chacune des crises est avant tout l’expérience de l’impuissance : en 2008, parce qu’on ne parvient pas à convaincre (on n’a pas le rapport de force pour faire en sorte) que soit appliqué le bon scénario de sortie de crise, la scission des branches belge et française de Dexia ; en outre, on se fait imposer une participation à une recapitalisation qu’on n’a pas les moyens de mener sauf à emprunter (et nous fragiliser) ; en 2011, on n’a tout simplement plus aucun moyen d’action, on ne peut faire qu’enregistrer dans le plus grand dépit. Le seul pouvoir actionnable a été d’éviter le « sauve-qui-peut », ce qui a quand même permis de ne pas étendre la casse là où, en réalité, rien n’était cassé. Depuis la décision de dissolution, on est dans un processus qui prend les allures de l’interminable. Même les plus jeunes du MOC, ou les plus anciens qui n’ont aucune responsabilité dans les événements sont obligés de garder l’ombre d’ARCO dans leur mémoire, précisément parce que chaque nouvelle péripétie judiciaire remet le dossier en lumière et en polémique. Il n’est pas déraisonnable de penser que, lorsque le moment de clôture sera vraiment arrivé, il y ait de nouvelles transactions avec l’État et/ou Belfius autour de la situation des coopérateurs personnes physiques – au vrai, on n’en sait rien, mais il ne fait guère de doute qu’il s’agira d’un ultime moment de réactivation tendue. Ceci pour dire que le traumatisme est grand, régulièrement réactivé, et le sera encore. Objectivement, si ce n’est un facteur de blocage pur et simple, c’est au moins facteur de crainte à se réengager dans des projets d’ambition.
Notes
[1] Avec l’aide d’un ouvrage très documenté qu’on recommandera à tout qui veut en savoir plus sur la période qui court de 1935 à 2005 : VAN DIJCK M., Groupe ARCO. Entreprendre avec du capital coopératif, Leuven-Tielt, KADOC-LANOO, 2005. Aussi KWANTEN G., La moisson de l’entraide. L’histoire des coopératives chrétiennes de 1886 à 1986, Bruxelles-Louvain, FNCC-KADOC, 1995.
[2] Sur La Cité : COENEN M-T., DUMONT J-M., HEINEN J., ROUSSEL L., WYNANTS P., La Cité, 45 années de combat quotidien, Bruxelles, CARHOP-CRISP, 2010.
[3] Sur BACOB : GÉRARD E., PACOLET J., VAN BOUCHAUTE J., VERAGHTERT K., Une coopérative ouvrière devient une banque. L’histoire de BACOB, Tielt, Lannoo, 1995.
[4] Ici on prend l’exemple de la COB, mais en réalité on pouvait obtenir aussi des avantages d’autres coopératives du circuit.
[5] ARCOPLUS a quant à elle repris l’héritage de COPLUS créée à l’époque de la loi dite « Monory Declercq » : entre 1982 et 1985, les achats par des particuliers d’actions dans des entreprises belges ont fait l’objet de déductions fiscales. Les coopératives ont été assimilées : COPLUS a été l’outil d’un recrutement de coopérateurs séduits par l’avantage fiscal.
[6] Sur EPC : CARHOP, De l’EPC à Familia, 100 ans d’une coopérative guidée par ses valeurs, Bruxelles-Ciney, EPC-CARHOP, 2019.
[7] Liste non exhaustive.
[8] En fait, les francophones représentent 14 % des coopérateurs qui, ensemble pèsent 12 % du capital. Dire « 13 » c’est inexact mais une façon de ne pas trancher sur la valeur prise comme référence !
[9] En 1995, il y a eu une tentative qui n’a pu aboutir avec la SNCI (Société nationale de crédit à l’industrie, « la petite usine bleue »).
[10] Également les filiales de Paribas aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg.
[11] Une société cotée en bourse depuis 1991, liée à la Caisse de dépôts et consignations de l’État français.
[12] Comme pour ARCO, avec Dexia on « ramasse » des sociétés différentes, notamment une holding et une banque.
[13] On a résumé à très gros traits un ensemble d’opérations qui comportent des aspects techniques hautement complexes. Le cas échéant, on y trouvera les détails dans Maarten Van Dijck, déjà cité. L’opération Dexia s’est par ailleurs traduite par des rationalisations : dans certains endroits, les agences BACOB et anciennement Crédit Communal étaient en concurrence, donc surnuméraires dans la nouvelle organisation. Les employé.e.s BACOB étaient tous salariés d’une même entreprise tandis que ceux du Crédit Communal relevaient d’autant d’employeurs franchisés qu’il y avait d’agences : il y a eu tensions sur les statuts.
[14] On parle « d’actionnaire de référence ».
[15] ARCOSYN était une plus petite société du Groupe, à fonction essentiellement technique. Le cas échéant, information disponible dans Maarten Van Dijck, déjà cité.
[16] La fonction d’administrateur à SYNECO était antérieure : dès 1995.
[17] GOVAERT S., Le dossier ARCO, Bruxelles, CRISP, 2017 (Courrier hebdomadaire, n° 2361-2362).
[18] Situation pour ARCOPAR en 2005. Elle était un peu plus favorable à ARCOFIN. En tout état de cause, le poids des francophones, quoique toujours minoritaire, était plus important dans les instances de décision que celui qui aurait été justifié s’il avait consisté à équivaloir à l’apport en coopérateurs et/ou en fonds.
[19] On n’a repris ici qu’un bref explicatif de « l’équation de base » d’un dossier qui comprend d’autres aspects.
[20] Le MOC (francophone et germanophone) n’avait, quant à lui, pas les reins assez solides pour prêter.
[21] Dans le jargon : fee.
[22] Ils ont remplacé le duo Pierre Richard (Français, président)-Axel Miller (Belge, CEO).
[23] Pour tout dire, Ethias a bénéficié plus rapidement de la garantie pour ses produits d’assurance-vie avec rendement garanti. Pour ce type de produit et cette société, ça s’est débloqué dès fin 2008.
[24] Outre les échanges parlementaires chauds entre majorité et opposition, une procédure a été lancée par deux parlementaires (une Écolo, une Groen). Sans succès.
[25] Ce qui veut dire : le problème à gérer aurait en réalité pu être mineur si les statuts des institutions européennes l’avaient permis et surtout si la volonté politique de le traiter au niveau européen avait existé.
[26] Comme l’action ne vaut quasiment plus rien, c’est la recapitalisation qui coûte à l’État, tandis que les anciens actionnaires ne touchent qu’en fonction de la valeur presqu’à zéro de leurs participations.
[27] Des chiffres différents ont circulé sur le nombre de coopérateurs. C’est assez normal : par définition, ça bouge tout le temps ! Quand le chiffre « 780 000 » est cité, il réfère à l’addition des coopérateurs de trois sociétés : ARCOPAR (640 000), ARCOFIN (108 000) et ARCOPLUS (32 000). Certains exposés ne réfèrent qu’à une partie : en ce cas, c’est le plus souvent d’ARCOPAR qu’il s’agit. S’il s’agit de compter le nombre de personnes qui possèdent des participations, 780 000 est une surestimation, car on peut être une même personne et avoir pris des participations dans plus d’une des sociétés.
[28] Notre mandat MOC s’étant terminé en novembre 2020, on ne sait pas témoigner de ce qui s’est passé ensuite.
[29] Le principe de décision en coopérative est « un membre = une voix ». Les statuts peuvent cependant y déroger en réintroduisant le principe « une part = une voix ». Mais c’est circonscrit : aucun porteur de parts ne peut disposer de plus de 10 % des voix. Un unique acteur est dans l’impossibilité d’avoir, à lui seul, la majorité.
[30] Le lecteur intéressé peut en trouver la description précise dans les rapports périodiques que le collège des liquidateurs met à disposition, en même temps d’ailleurs que les comptes et bilans annuels. C’est transparent et se trouve à l’adresse https://www.groeparco.be/fr.
[31] 10 janvier 2018.
[32] 7 décembre 2018.
[33] Une procédure a aussi été introduite à Anvers, qui a cité Belfius.
[34] La Libre Belgique, 10 octobre 2023.
[35] Bien sûr aussi la CSC et la Mutualité chrétienne, mais pas dans le même schéma que celui exposé ici.
[36] Si on élargit le périmètre aux AID, c’est de l’ordre de 15 % des moyens structurels qui ont été perdus. Mais l’option de gestion a été de ne pas impacter les AID dans la mesure où l’ensemble des ressources « ARCO + Dexia » finançait exclusivement le travail politique et d’éducation permanente. Enregistrons que l’impact a été nettement supérieur chez l’homologue flamand dont l’organisation financière était beaucoup plus dépendante des ressources Dexia.
Pour citer cet article
GEORIS P., « ARCO : récit d’une chute », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°22 : L’économie sociale en Mouvement(s), décembre 2023, mis en ligne le 20 décembre 2023, https://www.carhop.be/revuescarhop/


