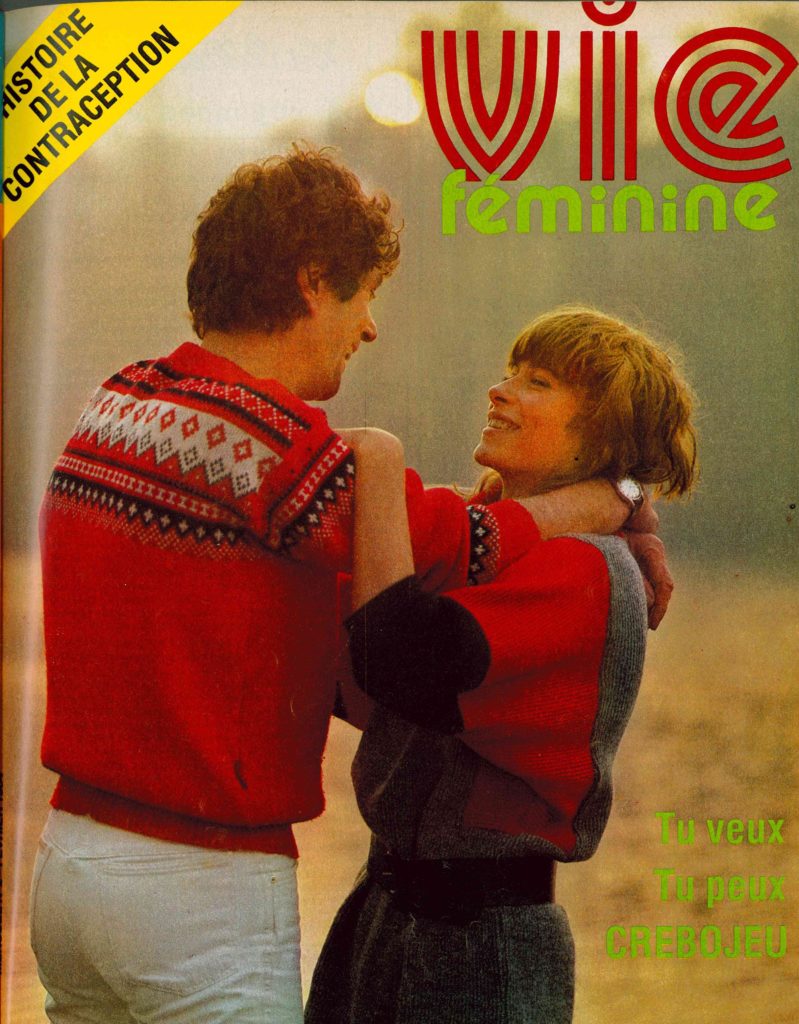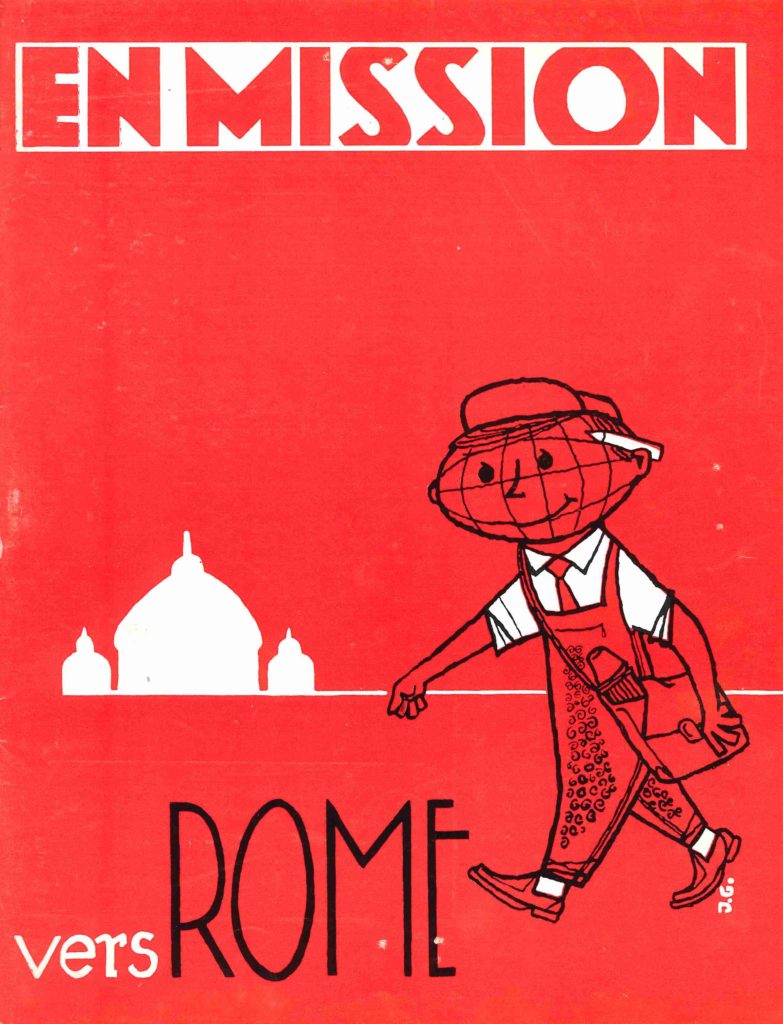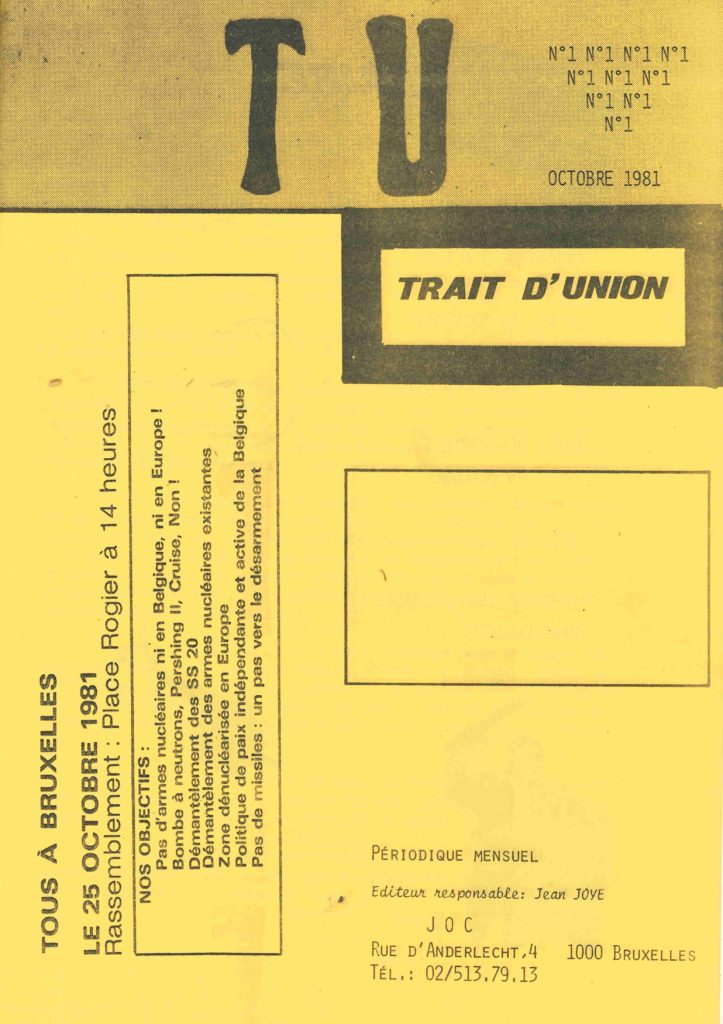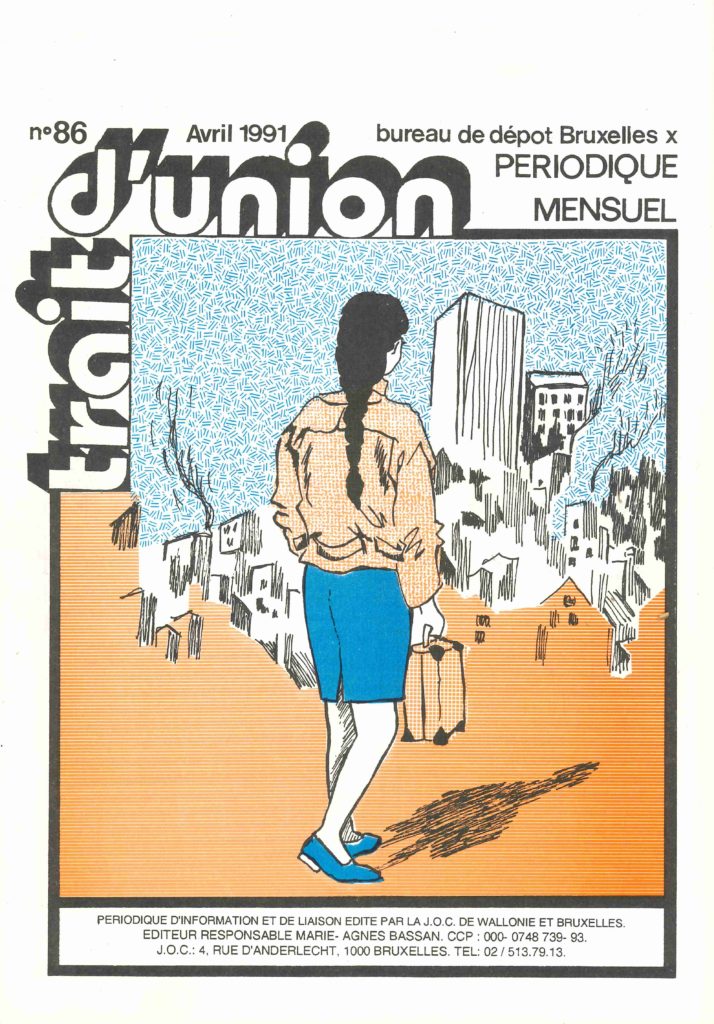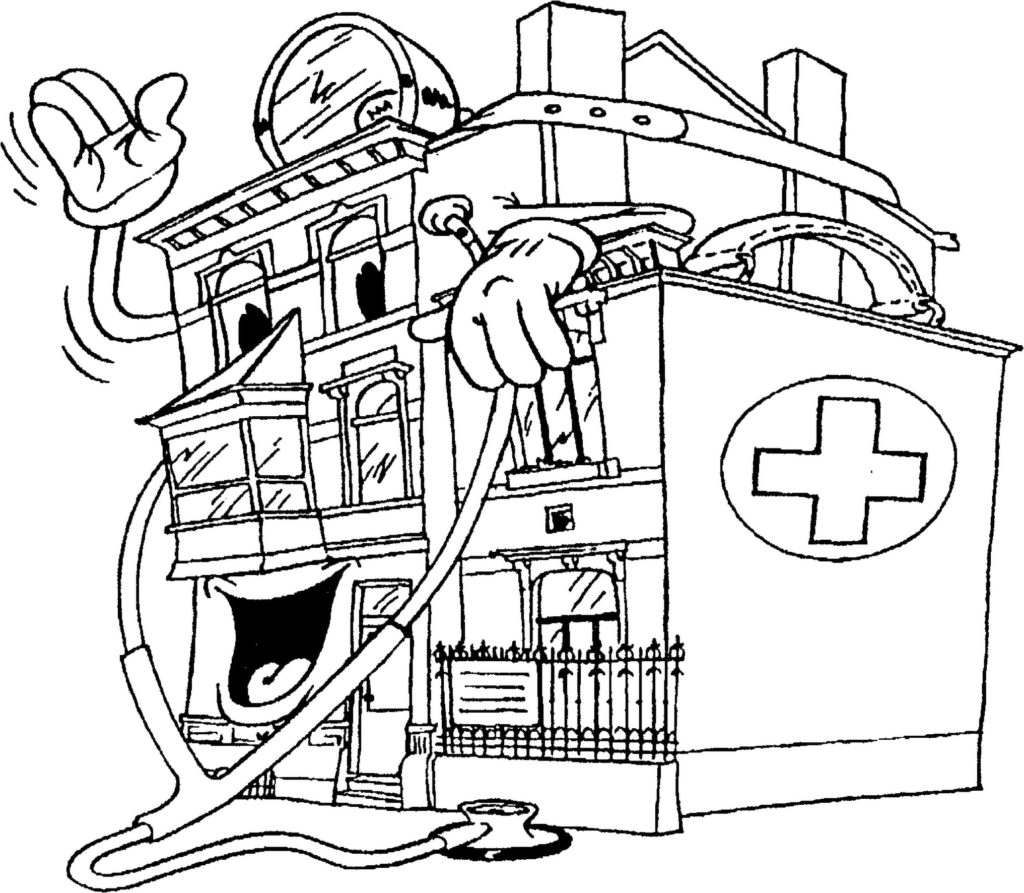
Catégorie : Périodique
Edito
Soyez riches, vous vivrez plus longtemps et en meilleure santé ! Quant aux plus précarisés… À gros traits, il s’agit là du principal constat d’une étude de la Mutualité chrétienne, parue le 23 mai dernier[1]. Les facteurs sont divers et variés : accès différencié à l’information sur les soins de santé, part des soins médicaux dans les revenus des ménages, accentuation de la pénibilité des conditions de travail, impact des métiers exercés sur l’invalidité, environnement social, etc.[2]. Autant de facteurs sur lesquels une politique de santé purement curative et inscrite dans la marchandisation des services collectifs les plus élémentaires ne peut agir. À l’autre bout du spectre, depuis plus de 40 ans, les maisons médicales repensent le droit à la santé et les stratégies collectives à mener. En choisissant les territoires où elles s’ancrent, en travaillant avec leur patientèle les facteurs impactant leur santé, en tissant leur action dans un réseau associatif aux multiples ramifications, en se coalisant, y compris avec d’autres secteurs qui influencent directement ou indirectement la santé des patient.e.s, en cassant les freins à l’accès à une médecine préventive, autrement moins coûteuse, les maisons médicales font le choix politique d’un droit à la santé pour tous et toutes. Au travers des articles de ce numéro de Dynamiques, plongez-vous dans le quotidien de quelques maisons médicales, dans leurs spécificités, mais aussi dans ce qui les relie, entre elles, mais aussi avec leur patientèle.
Bonne lecture !
[1] La Mutualité complète ce constat avec des pistes d’actions à mener pour détruire cette logique.
[2] BURGRAFF é., « Quand la pauvreté rend malade », Le Soir, 23 mai 2025.
Introduction au dossier
Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)
Aujourd’hui, dans un contexte de poussée du néolibéralisme, de défiance croissante envers les institutions, de montée en puissance de l’extrême droite et de la stigmatisation des migrant.e.s et des allocataires sociaux, les initiatives se multiplient pour défendre la solidarité et les droits humains. Mais comment agir efficacement ? Dans un texte mobilisateur publié en 2025 par la Fondation Ceci n’est pas une crise, le militant et communicant politique Jérôme Van Ruychevelt Ebstein constate en effet une « déconnexion croissante entre les organisations de gauche et les classes populaires qu’elles veulent représenter »[1], une déconnexion qu’il attribue notamment à la disparition progressive selon lui, durant le dernier quart du 20e siècle, d’une série d’organisations ouvrières de terrain qui, depuis le 19e siècle, avaient inlassablement agi pour rassembler, échanger sur les dures conditions d’existence, conscientiser politiquement et mobiliser pour une société plus juste et solidaire. Ce « maillage social », qui allait du café au syndicat, en passant par la coopérative, la mutualité, le club sportif, la fanfare ou la troupe de théâtre, « nourrissait les combats des organisations qui devaient traduire politiquement les problématiques des gens » ; elles « façonnaient un rapport au monde (…) notre manière d’interpréter la société »[2]. Outre une refonte des narratifs de gauche, ce militant plaide dès lors pour la (re)multiplication des espaces de rencontre et de mobilisation des milieux populaires, et il présente les maisons médicales comme « un excellent point d’entrée pour ce genre de démarche »[3].
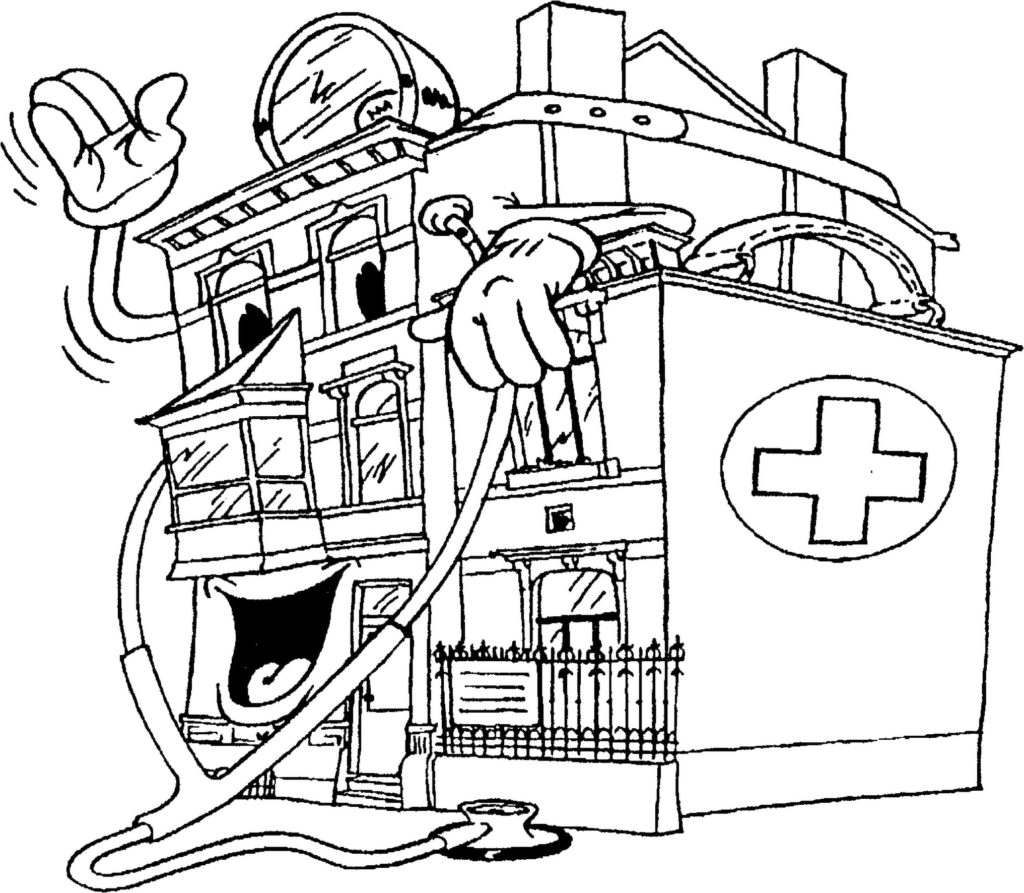
Dans une période qualifiée de « critique », marquée par la marchandisation des services publics, la destruction de l’État social et la dissolution des liens sociaux et des cultures du vivre-ensemble, le Mouvement ouvrier chrétien s’interroge aussi, durant sa Semaine sociale en 2024, sur les « formes plurielles de résistance qui, si elles ne permettent pas de faire dérailler ce train fou, ont la capacité de poser de nouveaux rails »[4]. Là aussi, les maisons médicales, parce qu’elles développent une médecine de proximité à vocation sociale, figurent parmi les quelques initiatives mises à l’honneur[5]. Fortes de leurs 300 000 patient.e.s, les 140 maisons médicales de Wallonie et de Bruxelles représentent en effet un véritable potentiel de transformation sociale.
Nées au début des années 1970, dans la foulée des mouvements contestataires des années 1960 et en réaction à la médecine marchande et hospitalière, les maisons médicales développent en effet depuis plus cinquante ans une médecine sociale de première ligne qui vise à l’émancipation de leurs patient.e.s, avec une attention particulière pour les personnes précarisées et marginalisées. C’est cette facette de leur histoire que ce présent numéro de Dynamiques entend mettre en exergue.
Soigner les personnes précarisées et marginalisées
Les pionniers et pionnières des maisons médicales se nourrissent notamment des théories du Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM) qui, fondé en 1964, entend défaire les relations hiérarchiques et marchandes dans le monde médical. Dès la fin des années 1960, dans le dessein d’offrir une médecine de première ligne efficace et accessible, quelle que soit la condition sociale de la patientèle, le GERM promeut le modèle théorique du Centre de santé intégré (CSI) bientôt repris par les maisons médicales[6]. Il porte aussi une attention particulière aux populations précarisées et marginalisées qui suscitaient jusqu’alors peu d’intérêt dans les milieux médicaux. En 1975, il publie un dossier sur les personnes du quart-monde, annonçant d’emblée dans son introduction :
« Il s’agit, dans l’immédiat, d’approcher un des milieux les plus délaissés et ignorés, en tout cas le plus aliéné et « étranger » de notre société de surabondance médicale, pharmaceutique, hospitalière, scolaire, universitaire, etc. : celui des exclus »[7].
Un an plus tard en 1976, il se penche sur la situation sanitaire des personnes migrantes qui, en plus de la pauvreté, subissent les épreuves de l’exil[8]. Au-delà des différences, comme « la santé des migrants est plus l’affaire de classe que de culture »[9], le GERM établit des convergences dans les vécus des personnes migrantes et du quart-monde : les privations multiples qui affectent leur santé physique et mentale, et les contrastes culturels qui influencent la perception du corps, la capacité à sentir et à accepter la maladie, à décrire les symptômes et à comprendre le langage des professionnels de la santé. Il s’ensuit que :
« les travailleurs les plus démunis, mal logés, mal nourris, employés dans les conditions les plus malsaines et en prise avec des problèmes d’usure physique et mentale d’une époque pour nous révolue, demeurent en marge des institutions médicales modernes »[10].
Sensible à la deuxième vague féministe qui réclame haut et fort l’égalité et la levée des tabous sur le corps des femmes, le GERM cherche aussi à identifier, durant les années 1970, l’impact du corps et des rôles sociaux féminins sur la santé physique et mentale des femmes, leur accès aux soins médicaux et leurs relations avec le corps médical. Car :
« Le manque d’intérêt, quand il s’agit des maladies, pour ce que vit la femme, et plus généralement le manque d’intérêt pour les problèmes spécifiquement féminins, nous a frappé. Il est temps que cela change »[11].
Des maisons médicales pour soigner et transformer le monde
Au tournant des années 1970, des étudiant.e.s et des travailleurs et travailleuses de la santé s’intéressent aux théories du GERM. Souvent reliés par l’amitié, très engagés socialement, situés à gauche voire à l’extrême gauche politiquement, et bien convaincus de leur capacité à transformer le monde, ils décident de passer à l’action. Ils choisissent un quartier où s’établir et fondent les premières maisons médicales : d’abord à Tournai (Le Vieux Chemin d’Ère, 1972), à Molenbeek (Norman Béthune, 1972), à Seraing (Bautista Van Schowen, 1974). Au fil des ans, une mosaïque d’initiatives riches et très variées se construit, « au point qu’on peut se dire qu’il n’y a pas deux maisons médicales semblables dans leurs apparences extérieures, même si leurs objectifs généraux concordent »[12]. Cette variété montre la grande souplesse des maisons médicales, leur capacité à construire de multiples synergies et à s’adapter aux nécessités locales et aux réalités de terrain.
Même si elles agissent de manière spontanée et autonome, les maisons médicales partagent d’évidentes convergences avec le GERM. Chacune à leur manière, elles adoptent le modèle du CSI. Pluridisciplinaires, agissant en autogestion, prodiguant des soins globaux, continus et intégrés, elles montrent une sensibilité forte aux besoins des quartiers et de leurs habitant.e.s et se préoccupent d’emblée des personnes du quart-monde, des personnes issues de l’immigration, des femmes et d’autres personnes vulnérables. Pour défendre collectivement leur philosophie de soins auprès des autorités publiques, une trentaine de maisons médicales décident en 1979 de s’assembler en une Fédération des maisons médicales. Souvent en collaboration avec le GERM, c’est ensemble qu’elles défendent à présent le modèle du CSI et, fortes de leurs pratiques de terrain, elles enrichissent la connaissance sur la santé et l’accès aux soins des populations précarisées et marginalisés[13].
Les maisons médicales se construisent donc en opposition avec la médecine libérale et marchande et s’érigent en espaces de revendications et de transformation politique. En 1997, Pierre Drielsma, qui s’implique à la fois à la Maison Bautista Van Schowen à Seraing et à la Fédération des maisons médicales, écrit avec fougue dans un article intitulé « Pour la guerre sociale ! » :
« Le Modèle marchand vise non seulement à l’hégémonie, mais plus encore au monopole de la pensée. C’est la fameuse pensée unique, en ce qu’elle prétend à l’impossibilité de penser une autre vie, un autre mode de fonctionnement social. (…) Historiquement, les maisons médicales se sont toujours trouvées du côté des petits. Il y a urgence à fournir des armes contre le Moloch’ Marchand »[14].
Trente ans plus tard, les maisons médicales restent des lieux de résistance qui entendent à présent servir de point d’appui pour lutter contre les extrémismes. C’est le message que la secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, Fanny Dubois, vient d’adresser aux patient.e.s et aux travailleurs et travailleuses des maisons médicales, aux autorités politiques et aux citoyen.ne.s :
« Osons le dialogue mutuel, car la division est notre pire ennemie. Ouvrons nos maisons médicales vers l’extérieur, à la découverte de l’autre, de celui ou de celle qui va bousculer les « entre soi » pour faire vivre la démocratie. Ouvrons nos cœurs aux liens de soins pour les protéger de la culture comptable qui transforme l’humain en un chiffre dénué de sa subjectivité. Résistons aux logiques qui poussent à l’individualisme, à rompre nos collectifs, à rendre nos rapports sociaux marchands. Ces autres histoires de rencontre avec l’altérité que nous tissons au quotidien fabriquent l’avenir de l’histoire de l’humanité, indispensable pour l’avenir de nos enfants et du vivant »[15].
Au menu de ce Dynamique
Sans occulter l’ancrage ancien de la médecine sociale, un premier numéro de Dynamiques, paru en décembre 2024, était revenu sur la création du mouvement des maisons médicales, leur projet politique et leur constitution en organisation fédérative, la Fédération des maisons médicales[16]. Cette fois, l’objectif est de mettre en exergue des initiatives inspirantes de terrain, jeunes et moins jeunes, situées en Wallonie et à Bruxelles, toutes singulières, mais partageant des caractéristiques communes qui les démarquent radicalement de la médecine libérale et privée: le terreau de l’engagement, l’ancrage dans un quartier, la volonté d’assurer une médecine de première ligne globale, continue et intégrée, accessible à tous et toutes, mais aussi celle de défaire les hiérarchies par l’autogestion et de travailler, via l’émancipation de leur patientèle, à une refonte beaucoup plus profonde de la société.
Dans un premier article, Julien Tondeur nous mène à Marchienne-Docherie dans l’entité de Charleroi, un quartier populaire et ouvrier en proie à la désindustrialisation. En 1974, des jeunes médecins épris de justice sociale s’y installent, bien décidés à y pratiquer une médecine sociale et émancipatrice. Ils fondent une Boutique de droit, un lieu d’expérimentation sociale qui offre différents services et qui mobilise les techniques du Mouvement d’animation de base pour conscientiser et émanciper les habitant.e.s du quartier. Ils y dispensent aussi des soins médicaux, à l’origine de la Maison médicale La Glaise. Outre l’ancrage militant, Julien Tondeur raconte les interactions fortes entre l’équipe médicale et les habitant.e.s du quartier, ainsi que les défis de l’institutionnalisation et du renouvellement des équipes pour la continuité du projet politique.
Avec la Maison médicale du Nord, c’est dans un autre quartier précarisé que nous convie Marie-Thérèse Coenen, un quartier situé aux alentours de la Gare du Nord à Bruxelles, qui concentre une forte proportion de populations immigrées vivant dans des conditions très difficiles. C’est dans ce contexte que des soignant.e.s impliqués dans d’autres projets socio-médicaux, décident de fonder une maison médicale. Pour répondre aux multiples problèmes sociaux de la patientèle, ils s’organisent en collaboration étroite avec l’association Services sociaux des quartiers, tandis que dans un contexte multiculturel, ils pensent et adaptent leurs pratiques médicales à la sensibilité et aux besoins de santé de patient.e.s confrontés à l’exil et au déracinement culturel.
Dawinka Laureys nous rapporte le témoignage du docteur Pierre Drielsma qui s’investit pendant plus de quarante ans à la Maison médicale Bautista Van Schowen à Seraing, et à la Fédération des maisons médicales où il défend le paiement au forfait. Outre ses racines post-soixante-huitardes, il raconte la volonté émancipatrice d’une Maison médicale installée au cœur d’une localité industrielle et ouvrière, qui a l’originalité de mettre sur pied une coopérative de patient.e.s. Son témoignage montre aussi l’envers du décor, comme les revers de l’implication de la patientèle, de l’autogestion et de l’égalité salariale.
Avec la Maison médicale du Maelbeek fondée à Ettebeek (Bruxelles) en 1976, c’est au genre que nous convie Claudine Marissal. Dans une période où les violences contre les femmes sont encore largement minimisées, y compris dans le monde médical, la Maison médicale du Maelbeek construit une collaboration étroite avec le Collectif pour femmes battues, une association féministe qui gère le premier refuge dédié aux femmes victimes de violences familiales. L’équipe est socialement très engagée, et prendre soin des personnes les plus exclues, avec toute la prudence et la délicatesse que leur fragilité réclame, s’inscrit pleinement dans ses conceptions de la médecine.
Quelques décennies plus tard, au tournant du 21e siècle, c’est aussi le genre qui pousse l’Entr’aide des Marolles à Bruxelles à initier un projet de santé communautaire pour améliorer le bien-être mental d’hommes isolés et précarisés, parfois dans l’errance, qui restent à l’écart des services médico-sociaux. C’est en favorisant le lien social et l’estime de soi et en les associant progressivement à des activités collectives du quartier, que le projet Hommes des Marolles entend agir sur leur santé mentale. Avec l’Entr’aide des Marolles, Claudine Marissal montre aussi la capacité d’adaptation d’une association médico-sociale fondée dans l’entre-deux-guerres[17], aux nouvelles conceptions de la médecine et de l’action sociale, jusqu’à s’intégrer dans le mouvement des maisons médicales.
Avec la Maison médicale Les Arsouilles fondée en 2000 dans le quartier populaire Saint-Nicolas à Namur, Édith Lepage pointe aussi l’importance des activités de santé communautaire pour améliorer l’état sanitaire. Après avoir rappelé les textes des organisations internationales promouvant ces pratiques, elle explique leur mise en œuvre aux Arsouilles, dans un quartier populaire délaissé souffrant de l’absence d’infrastructures et de logements dégradés, à l’origine d’un état dépressif collectif contre lequel la Maison médicale entend agir. C’est pourquoi, dès le début des années 2000, l’équipe initie un vaste projet citoyen de réhabilitation du quartier, en interaction étroite avec les habitant.e.s et les associations de terrain. De diverses manières, elle veille aussi à impliquer la patientèle dans l’organisation de la Maison médicale, pour en faire des acteurs et actrices à part entière de leur santé.
Avec la Maison médicale de Médecine pour le Peuple fondée en 1999 à La Louvière, Camille Vanbersy nous plonge dans une médecine contestataire à vocation révolutionnaire. Elle montre en effet comment le projet politique communiste de Médecine pour le Peuple, présenté dans le précédent numéro de Dynamiques[18], prend forme dans une localité post-industrielle. Pour Médecine pour le Peuple, le droit à la santé implique une réforme en profondeur de la société. C’est pourquoi, avec le soutien de sa patientèle, la Maison médicale se confronte à l’Ordre des médecins. Elle documente aussi les problèmes sanitaires et sociaux et se mobilise pour défendre collectivement les droits sociaux ou le pouvoir d’achat de la patientèle.
Enfin, pour conclure sur une vision politique, François Welter a recueilli les propos de Fanny Dubois, la secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, sur les enjeux et des maisons médicales. Elle évoque notamment leur implantation territoriale, la mixité sociale de leur patientèle et le financement au forfait pour soutenir la solidarité. Elle n’élude pas les menaces des politiques néolibérales pour les soins de santé, insistant sur l’importance primordiale d’une protection sociale forte et de la concertation sociale pour assurer la sécurité collective. En conclusion, François Welter rappelle qu’en travaillant à la transformation sociale, les maisons médicales font partie intégrante du processus d’éducation permanente.
Au terme de ces deux numéros de Dynamiques consacrés aux maisons médicales, constatons humblement que nous n’avons dévoilé que quelques facettes d’une riche histoire d’engagements. Souvent partis de presque rien, les pionniers et pionnières ont réussi à lancer un mouvement qui réunit d’aujourd’hui 140 maisons médicales et une Fédération qui défend leur projet politique. Cette histoire montre la force du oser agir, espérons qu’elle serve de levier pour de nouveaux engagements.
Notes
[1] VAN RUYCHEVELT EBSTEIN J., Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ? Le cas de la Belgique francophone : comprendre les échecs et reconstruire des récits qui gagnent la bataille culturelle, Fondation Ceci n’est pas une crise, 2025, https://cecinestpasunecrise.org/wp-content/uploads/2025/03/Pourquoi-les-narratifs-de-gauche-ne-touchent-plus-les-classes-populaires_VdefWeb.pdf.
[2] Ibidem, p. 12.
[3] Ibidem, p. 38.
[4] 101e Semaine sociale du MOC. Quels services publics et associatifs depuis nos lieux de vie, demain ?, revue Politique, collection Politique, n° 6, 2025, p. 8.
[5] THIÉMARD C., NAVEAU, B., « Diagnostic et territoire », 101e Semaine sociale du MOC…, p. 58-62.
[6] Sur l’histoire du GERM et son influence sur les maisons médicales : POUCET T., VAN DORMAEL M., « 1964-1990 : le GERM pour un système de santé solidaire, » et MORMONT M. et ROLAND M., « Maisons médicales, semailles et germinations », Politiques, n° 101, septembre 2017, p. 28-37, https://www.revuepolitique.be/wp-content/uploads/2017/11/Pour-une-gauche-me%CC%81dicale.pdf; HENDRICK A. & MOREAU J.L., « Esquisse historique de la Fédération des maisons médicales », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25, décembre 2024, www.carhop.be.
[7] MOERMAN F., « Présentation : les exclus… », GERM : lettre d’information, n° 87, avril 1975, p. 3.
[8] « La santé des migrants », GERM : lettre d’information, n° 94, janvier 1976.
[9] MEESTERS J., « Santé des migrants ou santé des ouvriers ? », GERM : lettre d’information, n° 94, janvier 1976, p. 25.
[10] Extrait de : de VOS van STEENWIJK A.A., La provocation sous-prolétarienne, Sciences et services, 1972. Cité dans GALAND P. (Dr), « Santé et Quart-monde », GERM : lettre d’information, n° 87, avril 1975, p. 33.
[11] « La femme, objet de santé publique », GERM : lettre d’information, n° 99, juin 1976, p. 3.
[12] « Ces maisons médicales qui ont 10 ans et plus…, Actualité Santé, une publication du GERM, n° 56, novembre 1983, p. 3.
[13] À partir des années 1980, des articles paraissent régulièrement sur les personnes précarisées, les personnes immigrées et les femmes dans les revues du GERM et de la Fédération des maisons médicales.
[14] DRIELSMA P., « Pour la guerre sociale ! (éléments pour une stratégie politique) », Courrier, périodique de la Fédération des Maisons médicales et Collectifs de santé francophone, n° 7, février 1997, p. 5-6.
[15] Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones, Rapport d’activités 2024, p. 7, mis en ligne en 2025, https://www.maisonmedicale.org/wp-content/uploads/2025/05/rapport-annuel-2024.pdf.
[16] Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25 : Les maisons médicales. Le droit à la santé pour tous et toutes !, mis en ligne le 18 décembre 2024, www.carhop.be.
[17] Sur la création de l’Entr’aide en 1925 et son évolution jusqu’aux années 1970 : MARISSAL C. « Soigner pour évangéliser ? L’Entr’aide des travailleuses (1925-années 1960) », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25, décembre 2024, www.carhop.be.
[18] Sur la création et le projet politique de Médecine pour le Peuple : COENEN M.-Th. « Médecine pour le Peuple : des maisons médicales luttent pour le droit à la santé », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25, décembre 2024, www.carhop.be.
Pour citer cet article
Marrisal C., « Introduction au dossier », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 26 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes ! Panorama d’initiatives inspirantes, mai 2025, mis en ligne le 28 mai 2025, https://www.carhop.be/revuecarhop/
« S’englaiser » à Marchienne-Docherie : d’une boutique populaire à une Maison médicale
Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)
Introduction
En 1975, de jeunes étudiant.e.s en médecine imprégné.e.s de l’idéal post-1968 et de ses luttes sociales, s’installent au cœur du quartier populaire et industriel de Marchienne-Docherie dans la région de Charleroi. Ils y ouvrent la Boutique populaire La Glaise, bientôt un point névralgique du quartier, aux activités sociales aussi diverses que foisonnantes : consultations médicales bien sûr, mais aussi consultations psychologiques, boutique de droit, animations de jeunes, point d’information de quartier, soutien aux populations immigrées, etc. S’appuyant sur les références théoriques et pratiques que sont le Mouvement d’animation de base (MAB) et la pédagogie de Paulo Freire, cette Boutique populaire donne naissance quelques années plus tard à la Maison médicale La Glaise, toujours active aujourd’hui.
Cet article revient sur cette histoire riche, variée et engagée, qui souffle bientôt ses 50 bougies, en mettant l’accent sur l’ancrage militant des jeunes médecins à l’origine de la Maison médicale, leur projet politique, leurs références théoriques et leurs méthodes pour soigner, conscientiser et émanciper des habitant.e.s d’un quartier ouvrier en proie à la désindustrialisation. Outre des articles de revue et quelques documents d’archives de la Fédération des maisons médicales (FMM), trois témoignages ont servi à sa rédaction : Jacques Charles, Monique Boulad et Thérèse Delattre ont accepté de se prêter au jeu de l’interview[1]. Leurs souvenirs forment l’ossature de ce texte.
Des pionnier.e.s ancré.e.s dans l’idéal post-1968
L’histoire de la Maison médicale La Glaise s’inscrit dans une dynamique de transformation sociale initiée à la suite des années 1960 et des événements de Mai 1968 en particulier. La médecine, comme de nombreux secteurs professionnels, est alors traversée par une remise en question profonde des modèles établis[2]. L’univers de la santé des années 1960 est dominé par un puissant courant de médecins conservateurs. En 1964, prenant le contrepied de ce dernier, un groupe de médecins hospitaliers progressistes met sur pied le Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM), un collectif qui porte une conception radicalement différente des soins de santé[3]. Inspiré.e.s par les critiques formulées par des collectifs tels que le GERM, de jeunes médecins et militant.e.s réfléchissent à une pratique médicale alternative, en rupture avec l’exercice libéral traditionnel de la médecine et plus proche des réalités des populations marginalisées.
C’est dans ce contexte que Xavier Rousseaux et Jacques Charles, jeunes étudiants carolorégiens à la faculté de médecine de Louvain, affinent, lors de leurs contacts avec le GERM, leur réflexion sur les pratiques de santé en médecine générale et développent un intérêt pour les maisons médicales. Après avoir étudié les initiatives existantes à Tournai, Molenbeek et Seraing, ils ressortent convaincus de l’importance de tenter l’expérience à Charleroi, dans le quartier de Marchienne-Docherie qui cumule les facteurs d’exclusion et de pauvreté et dans lequel la densité médicale est très faible. En 1974, ils s’installent dans le quartier afin d’en analyser plus précisément les besoins.
La Docherie, une colline entourée de terrils
Marchienne-Docherie, souvent abrégé en La Docherie ou plus familièrement « La Doche », est un quartier de Marchienne-au-Pont, une des 15 sections de la ville de Charleroi. Situé en périphérie, il s’inscrit dans la longue tradition industrielle de la région, marquée par l’exploitation du charbon, de la sidérurgie et du verre. Le hameau se peuple à partir de 1840, en parallèle au développement industriel et des puits d’extraction miniers qui s’ouvrent sur son espace. En 1853, 721 habitant.e.s y sont recensé.e.s alors qu’en 1893 il y en a plus de 6 000, démontrant la grande attractivité de la région[4]. À partir des années 1950, la crise industrielle s’installe. La fermeture des charbonnages et la restructuration des industries métallurgiques entraînent un effondrement de l’emploi et une paupérisation croissante de la population. Dans les années 1970 et 1980, ce phénomène s’accélère, laissant place à un paysage urbain marqué par la désindustrialisation, le chômage massif et l’exode des familles les plus aisées. Le quartier se transforme en un territoire fragilisé, où l’accès aux services de base se complique, notamment en matière de santé et de protection sociale.

Soigner dans un quartier majoritairement immigré : la Maison médicale du Nord à Schaerbeek
Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)
La Maison médicale du Nord (MMN) est le fruit d’une interaction entre un territoire, le quartier Nord à Bruxelles, le groupe de réflexion Culture et développement et des jeunes, un médecin et des paramédicaux qui s’interrogent sur le sens de leur engagement professionnel.
Au début des années 1970, le quartier Nord, situé entre le canal, les alentours de la gare du Nord jusqu’à Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, fait l’objet d’un projet immobilier pharaonique qui va entraîner la destruction de plusieurs quartiers et le déplacement d’une grande partie de la population. En 1970, les habitants sont majoritairement des familles immigrées vivant dans des conditions précaires. Elles y côtoient une population belge vieillissante qui n’a pas les moyens de partir. Quelques intellectuels s’y installent, animés d’un « vouloir vivre ensemble » plus juste.
C’est dans ce contexte social instable que des soignant.e.s décident de créer une maison médicale. Cette analyse revient sur la création et l’organisation de ce projet innovant, les liens qui se tissent et la mise en œuvre de la pluridisciplinarité et de l’autogestion. Elle met aussi en exergue la manière dont l’équipe répond aux besoins d’une patientèle multiculturelle et immigrée[1].

Les prémisses : la section schaerbeekoise de Culture et développement
Sœur hospitalière et infirmière à La Croix jaune et blanche (CJ&B), Nadine Schelstraete se forme à la pédagogie de libération de Paulo Freire[3], introduite en Belgique par Jef Ulburghs[4]. Elle vit dans le Groupe communautaire au numéro 168, rue Verte à Schaerbeek[5]. Participant aux nombreuses initiatives émergentes dans cette localité bruxelloise, elle lance en 1974 le groupe Communauté et développement, section du mouvement Culture et développement lancé par Jef Ulburghs. Ce groupe se divise selon trois thématiques : le troisième âge, la scolarité des immigré.e.s et les besoins de santé.
Colette Scheenaert participe à la réflexion sur les soins de santé. Kinésithérapeute, en attente de partir à Goma (Congo), elle est animatrice au Service de santé mentale La Gerbe à Schaerbeek : « Nous souhaitions aborder l’accès aux soins dans le quartier. Nous avons invité Jef Ulburghs qui nous a fait travailler sur la connaissance des entités du quartier et sur les besoins de santé, sur ce qu’il fallait faire. C’est là que j’ai croisé Bernard »[6]. Jeunes diplômés en médecine en 1974, Bernard Vercruysse et son épouse, Myriam Provost, réfléchissent à leur orientation professionnelle. Myriam travaille dans un hôpital à Namur et Bernard assure bénévolement une consultation à la Free clinic d’Ixelles, où il croise Brigitte Dohmen, psychologue, membre du groupe Santé, qui l’invite à rejoindre l’initiative schaerbeekoise. « Ce groupe », écrit-il, « rêve d’une autre approche de la santé. Le travail se ferait en équipe, sorte de mini-clinique intégrant préventif, curatif, éducation à la santé, autoformation entre les patients et création de réseaux de solidarité entre les habitants. Le principe de base est l’autogestion. »[7] Bernard, Colette, Nadine décident d’ouvrir une maison médicale qui s’adresse à tous et à toutes, dans le quartier.
1975, la Maison médicale ouvre ses portes dans un quartier majoritairement immigré
En septembre 1975, Bernard commence ses consultations au numéro 93 de la rue Dupont. « Nadine et Colette travaillaient déjà dans le quartier », précise-t-il, « moi, j’étais le nouveau. »[8] Il prend contact, via le groupe Santé, avec deux « leaders » de la communauté turque qui apprécient l’installation d’un médecin « social » dans le quartier : « Cela a certainement joué pour mon image dans cette communauté »[9]. Colette s’installe comme kinésithérapeute dans le sous-sol et Nadine aménage, avec le soutien financier de la CJ&B, un dispensaire. « Dès le départ, on a fonctionné en trilogie et en autogestion. »[10] L’initiative est innovante ; il s’agit d’une des premières maisons médicales en Belgique et dans la capitale.
Médecins indépendants de première ligne, Bernard Vercruysse consulte beaucoup et tard le soir, Myriam Provost prend en charge deux demi-journées de consultations par semaine. Jean Fontaine les rejoint en 1977, remplacé par Paul De Munck en 1982. Leur patientèle s’étend rapidement. Les trois infirmières, Brigitte Installé, Nadine Schelstraete et Maggy Payen[11], sont employées par La CJ&B qui assure leurs prestations, fixe leur agenda, verse une subvention pour le dispensaire et prend en charge le temps des réunions. Également indépendants, les kinésithérapeutes s’adaptent aux spécificités de la patientèle. « Au début », se souvient Colette, « nous avons fait beaucoup de soins à domicile. Cela n’a pas duré longtemps, car rapidement, je ne pouvais soigner que les femmes turques ou marocaines. Les hommes ne voulaient pas que je les soigne. Ils voulaient bien des massages, ce que je ne voulais pas faire. Loin d’être anodine, cette situation a posé beaucoup de questions. »[12] Clément Loix, kinésithérapeute, s’occupera désormais des hommes. En 1979, Luc Lenel le remplace. Colette, observant le mal-être des femmes du quartier, se forme à la méthode Mézières[13] et adapte sa pratique aux soins de groupe. Comme la MMN maintient les soins de kiné individuels, elle rejoint en 1981 le planning familial Josaphat où elle travaille avec des groupes de femmes migrantes, sans toutefois couper les ponts avec la MMN.
L’équipe de la MMN s’agrandit, quand les moyens le permettent, avec l’arrivée d’une secrétaire et d’un diététicien en 1982 et d’une dentiste en 1986. La MMN est également un lieu de stage pour des étudiant.e.s (médecins, infirmières, assistant sociaux), des médecins en recyclage ou des visiteurs étrangers.

Le 9 février 1978, l’équipe réunie en assemblée générale[14] adopte les statuts de l’association sans but lucratif (ASBL) Maison médicale du Nord. L’article 3 en fixe les objectifs : « Améliorer les conditions de santé et de bien-être au niveau d’un quartier, en se basant sur les besoins et désirs spécifiques des habitants, tout en respectant le contexte socioculturel de chacun. Pour atteindre ce but, elle emploie entre autres les moyens suivants : 1. un travail d’équipe médico-social au niveau des soins préventifs et curatifs ; 2. une collaboration avec des groupes formels et/ou informels travaillant dans le quartier ou tout autre moyen qu’elle jugera utile pour atteindre ce but. »[15] Sont nommés administrateurs, Clément Loix, président, Myriam Provost, secrétaire, et Maryrose [sic] Warichet[16]. Le siège social, d’abord situé à la rue Dupont, se déplace le 13 juillet 1993 dans une maison rénovée, au numéro 10, rue des Palais à Schaerbeek.
En 1985, la MMN s’affilie à la Fédération des maisons médicales. En 1995, elle est reconnue dans le cadre du Décret du 29 mars 1993 de la Communauté française relatif à l’agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée. Elle bénéficie d’une subvention de 400 000 francs belges de la Commission communautaire francophone (COCOF), soit 20 % de son budget, pour assurer une mission de prévention, l’accueil et l’organisation d’un secrétariat. Elle s’équipe de l’outil informatique nécessaire pour répondre aux critères d’évaluation de la COCOF, avec une base de données qui permet une approche quantitative et objective de la patientèle et qui sera très utile lors du passage au forfait.
L’indispensable volet social
Confrontée aux multiples problèmes sociaux de sa patientèle, l’équipe sollicite très vite l’appui de l’ASBL Services sociaux des quartiers 1030 (SSQ 1030) et une collaboration étroite s’engage entre les deux projets[17]. Marie-Rose Warichet-Misson, assistante sociale à l’ASBL, évoque cet épisode. « En 1978, Bernard m’a téléphoné. Il avait créé une maison médicale avec une équipe pluridisciplinaire et souhaitait une assistante sociale déjà « présente » dans le quartier (…) J’ai trouvé cela intéressant, j’ai dit oui et ai rejoint cette équipe… à temps partiel. »[18] Les SSQ 1030 acceptent de détacher du temps de travail d’une, voire de plusieurs de leurs assistantes sociales, et cela pendant plus de 20 ans. Leur philosophie du travail social est en adéquation avec celle de la MMN : « Viser l’autonomie du patient, à savoir écouter et entendre la demande, aider à trouver les solutions, accompagner et expliquer comment se débrouiller… »[19] Les patient.e.s de la MMN s’adressent à la permanence sociale des SSQ 1030, et les assistantes sociales participent aux réunions de l’équipe médicale, y amenant notamment la préoccupation des personnes âgées[20]. Bernard Vercruysse devient en 1977, membre de l’ASBL SSQ 1030.
Pour améliorer les problèmes de communication entre l’équipe médicale et les personnes immigrées maîtrisant mal le français, une autre assistante sociale est sollicitée, Marie Bezerdjan, libanaise, employée au centre d’aide aux personnes Brabantia créé en 1974 et situé au numéro 43, rue de la Charité à Saint-Josse-ten-Noode. Plus tard, les médecins feront appel à un service externe pour préserver la confidentialité de la consultation.

Lors des visites à domicile, l’équipe rencontre des situations extrêmement difficiles tant au niveau de l’hygiène des patient.e.s que du contexte de vie. Une aide familiale s’avère indispensable. Au départ, elle est la seule à intervenir auprès des patient.e.s de la MMN, mais comme ses tâches sont particulièrement lourdes, la MMN signe une convention avec un service d’aide, ce qui permet de mobiliser plusieurs travailleuses en fonction des besoins.
Depuis 1993, la MMN dispose à la rue des Palais d’une belle salle d’attente où les assistantes sociales proposent un accueil individualisé, l’information et des animations en santé communautaire.
Construire du sens : analyser des cas et réfléchir en équipe
Le rôle du conseil d’administration (CA) et de l’assemblée générale (AG) de la MMN est relativement limité. L’AG entérine les orientations, le CA gère le volet administratif et les relations avec les autorités ; le cœur stratégique de l’association, c’est l’équipe et le mode d’organisation, l’autogestion.
La cohérence de l’équipe se construit lors des temps collectifs. La réunion hebdomadaire du jeudi midi réunit l’équipe interne (indépendants) et externe (assistantes sociales, infirmières, aides familiales). C’est un moment d’échange d’informations, de concertation et d’ajustement de l’agenda. Deux fois par mois, l’équipe se retrouve en soirée : l’une, dédiée à l’étude de cas de patient.e.s qui réclament un éclairage pluridisciplinaire ; l’autre, consacrée au projet Maison médicale. À cela s’ajoutent, si nécessaire, des week-ends de réflexions et d’ajustement. « Cette implication était exigeante », souligne Marie-Rose, travailleuse sociale à la MMN, « mais j’ai apprécié d’être dans une équipe pluridisciplinaire pour analyser les situations et partager chaque semaine, les questions autour d’une table. C’était un plus pour tous (…) On avait un pôle de médecins très dominant, un pôle kiné qui avait aussi son mot à dire, et nous, les extérieurs, on essayait d’influencer, de faire contrepoids. Je défendais l’idée de travailler en cogestion. J’étais attentive que la parole de chacun soit entendue de la même façon. »[22]

L’équipe noue aussi de nombreux liens : les médecins s’investissent dans les associations professionnelles tandis que l’équipe est présente dans les associations locales, avec un programme de prévention à la santé. Ainsi, elle anime en 1980 une émission hebdomadaire à Radio Panik sur la santé[23].
S’adapter à la multiculturalité de la patientèle

Confrontée à des plaintes récurrentes d’une patientèle, notamment immigrée, que la thérapie curative semble impossible à apaiser, l’équipe fait appel dès 1980 à Antoine (Toon) Gailly, spécialiste des liens entre culture et migration. Il est psychologue au Centrum voor Welzijnswerk de Laeken (CW Laeken) et propose une approche anthropologique des plaintes atypiques. Bernard Vercruysse en souligne l’intérêt : « L’approche anthropologique mobilisée décode comment des souffrances existentielles ou sociales peuvent s’exprimer par des signes extérieurs ou des symptomatologies physiques parfois très codifiées : femme « ouverte » ou « fermée », voilée ou non, bon ou mauvais mariage (…) Cela nous a permis d’être plus à l’aise avec ces plaintes parfois bizarres. [Toon] nous a appris la modestie et la tolérance. La part de l’être en face de nous qui nous échappe complètement est immense chez tous nos patients. »[24]

Constatant une surreprésentation des femmes diabétiques dans leur patientèle et une certaine indifférence à adopter de bonnes pratiques, l’équipe lance, avec l’aide d’un diététicien, Hassan Katib, un groupe de parole de femmes diabétiques. Elles connaissent leur pathologie, mais sont plutôt dans la non-acceptation de la maladie. La balle est donc dans le camp des soignant.e.s[25]. Le diabète occulte aussi un autre problème, l’obésité. Intéressée par le sujet, Karin De Vriendt[26], chercheuse en anthropologie et collaboratrice au CW Laeken, mène, en étroite collaboration avec la MMN, une enquête sur la signification culturelle de l’obésité chez les femmes turques et présente les résultats à l’assemblée générale de mars 1986[27]. « La lecture de ce travail », signale Bernard, « m’a définitivement guéri de la priorité absolue de faire maigrir les obèses, tant les signifiances multiples de cette obésité sont d’une importance majeure pour la personne (sociologique, familiale, communautaire, sexuelle…). La patiente elle-même n’en est souvent pas consciente, la stigmatiser sur son poids, peut, dans ce contexte, être lourd de conséquences. »[28]

Constatant une situation de mal-être dans les familles immigrées, l’équipe décide en 1995 de mener une recherche-action sur le lien parental avec une focale spécifique sur les pères dans la communauté musulmane. Pascale Degryse[29] pilote l’enquête par questionnaire, mène des entretiens semi-directifs et programme des rencontres entre l’équipe et une institutrice, une assistante sociale, un juge de paix, une ilotière, un imam. Ce qui peut apparaître comme une démission parentale n’est pas propre aux seuls parents immigrés, mais est une conséquence de leur situation de précarité sociale et de déracinement culturel. L’État, la Justice, l’avocat, l’école peuvent rappeler la norme, mais ne peuvent suppléer à tous les manques. Davantage d’écoute et de dialogue entre les différents acteurs serait sans doute une piste de solution pour atteindre un mieux-être[30].
La pratique réflexive régulière amène aussi l’équipe à aborder la tension psychologique qui peut se poser entre les patient.e.s et les soignant.e.s sur le terrain. Lina Balestière, psychothérapeute et psychanalyste au Centre de guidance et de formation de l’Université catholique de Louvain à Woluwe-Saint-Lambert, entame une fois par mois une supervision/formation consacrée aux situations apportées par l’équipe, mais, constate Bernard Vercruysse, « c’est aussi le bien-être et les motivations de l’équipe soignante qui sont interrogés »[31].
L’expertise des membres de la MMN est reconnue. Paul De Munck participe au groupe de réflexion sur les problèmes psychiatriques des patients immigrés au CW Laeken[32]. Bernard Vercruysse intervient sur la question de santé des immigré.e.s et sur la gestion de la plainte dans la consultation transculturelle à l’Université catholique de Louvain. Il participe, avec Maggy Payen, à la Commission de la culture portant sur les personnes âgées, une commission installée au sein de l’administration du Ministère de la Culture française (aujourd’hui Fédération Wallonie-Bruxelles)[33].
Le forfait, pour mieux atteindre les objectifs de la MMN
Au départ, le budget de la MMN se limite aux frais encourus par l’ASBL. Les indépendants versent une participation au prorata de leurs honoraires : 20 % pour le kiné, 23 % (Paul) et 57 % (Bernard et Myriam)[34]. Ces entrées couvrent 90 % des frais de la MMN. Le solde est couvert par des cotisations versées par chaque membre de l’équipe comme contribution aux coûts de formation et aux diverses affiliations de la MMN, comme par exemple la cotisation à la Fédération des maisons médicales.

Un des fils rouges de la Maison médicale est le respect de l’autonomie du patient qui peut choisir son propre réseau de soignants (infirmièr.e, kiné, médecin traitant, …) ou l’offre de soins de la MMN. L’assemblée générale de 1985 se penche sur cette question et distingue les patients externes qui n’usent que d’un seul service, des internes qui font appel à au moins deux services de la MMN. Trois quarts des patients qui fréquentent le dispensaire ou les permanences sociales sont attachés à la Maison médicale, un quart sont externes. En kinésithérapie, c’est l’inverse. Luc Lenel, kinésithérapeute, s’inquiète du déséquilibre qu’il constate dans sa patientèle : est-ce sa pratique qui n’est pas suffisamment adaptée au public ou l’effet dissuasif du ticket modérateur qui éloigne la patientèle trop précaire ?[36] Cette question reste pendante et joue dans le choix d’adopter le système de maison médicale au forfait.
À la MMN, le patient paie chaque acte au prestataire de soins et l’accès au service social ne lui coûte rien[37]. Une partie importante des consultations et visites se font au tiers payant avec ou sans perception du ticket modérateur. Cette liberté laissée au soignant questionne : pourquoi certaines consultations et pas d’autres ? Quels sont les critères retenus ? Le système au forfait ne serait-il pas une solution d’équité ? À partir de 1997, l’équipe consacre beaucoup d’énergie à examiner ses avantages et ses limites[38]. D’un côté, il y a la gratuité des soins de base pour les patients, la sécurité budgétaire, la sortie d’une sorte de productivisme. Le forfait remet le patient au centre des préoccupations de l’équipe pour coordonner les soins et les besoins sociaux. Le forfait, c’est aussi une forme de solidarité entre les bien-portants et ceux qui nécessitent davantage de soins, l’intervention mutuelliste étant calculée par affilié.e. De l’autre côté, le forfait signe la perte du libre choix du patient et une limitation de son autonomie, ce qui peut être un frein d’ordre socioculturel : la MMN remarque que sa patientèle migrante consulte couramment, en même temps, un ou deux autres médecins et le service d’urgence d’un hôpital, en fonction de ses attentes et de ses besoins propres. Comment la convaincre de se limiter à la seule MMN ?
En réalité, le risque de voir la population du quartier se détourner de la MMN semble minime. Un sondage réalisé en 1993-1994 démontre que 60 % des patients sont favorables au forfait tandis que 9 % ne le sont pas et que 31 % s’interrogent. En 1997, la MMN a quelque 3 600 dossiers ouverts. Même si un tiers de la patientèle s’en détourne, il restera 3 093 patients, ce qui fait une estimation budgétaire de 32 645 596 francs belges[39], nettement mieux que les recettes via la médecine à l’acte. Le passage au forfait interroge le projet de maison médicale. Réservés, les médecins veulent que leurs revenus soient garantis et que la liberté du patient soit préservée. Après réflexion, ils finissent par donner leur accord. La MMN passe au forfait le 1er avril 2000, ouvrant la voie à une dynamique nouvelle autour d’un noyau de base et d’une équipe fortement renouvelée[40].
Une expérience réussie
Entre l’utopie telle que débattue dans le groupe Santé de Schaerbeek en 1974 et le tournant de l’an 2000, la MMN reste fidèle à ses options de base : une implantation dans un quartier populaire, auprès d’une population majoritairement migrante, qui évolue au fil des vagues migratoires mais dont les caractéristiques sont les mêmes : précarité, difficultés d’adaptation, déracinement et multiples fidélités, ce qui reste lourd à porter au quotidien. L’équipe met le patient au centre de ses préoccupations, en respectant sa liberté comme acteur de sa propre guérison, en l’invitant par une coéducation à sauvegarder sa santé, voire à accepter son état si c’est son souhait. La MMN prend sa place dans le tissu associatif schaerbeekois et elle reste partenaire dans de nombreuses initiatives qui émergent après 2000.
Notes
[1] Pour retracer la genèse de la Maison médicale du Nord, nous nous sommes appuyées principalement sur un mémoire rédigé par Bernard Vercruysse au moment de son départ à la retraite en 2015. VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, tapuscrit, s.l., [2015], n.p., ainsi que sur les dossiers se rapportant à la MMN et couvrant la période de 1978 à 2000 environ, présents dans le fonds d’archives des Services sociaux de quartiers-1030 (SSQ 1030), lequel a fait l’objet d’un relevé par le CARHOP : Relevé du fonds SSQ 1030 et UL, Bruxelles, septembre 2024.
[2] « Équipe d’animation communautaire du quartier Nord », Courrier : périodique de la FMM et collectifs de santé, n°82, juin 1993, p. 3.
[3] FREIRE P. (1921-1997), La pédagogie des opprimés, s.l., Édition portugaise en 1968, traduction française : Éditions Maspero, 1974.
[4] Jozeph (dit Jef) Ulburghs (1922-2010), prêtre de l’Évêché de Liège puis au Limbourg, lance en 1969 un mouvement d’éducation populaire, les Wereldscholen, ainsi que le mouvement Culture et développement.
[5] BEDO J. et alii, Aventures fraternelles… ou Chronique de la vie des quartiers dans les années 70-80 à Schaerbeek, s.l., octobre 2016, p. 47.
[6] Entretien de Colette Scheenaert par Marie-Thérèse Coenen, Woluwe-Saint-Lambert, 4 février 2025.
[7] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 2.
[8] Ibidem, chapitre 1.
[9] Idem.
[10] Entretien de Colette Scheenaert.
[11] Elle est infirmière à la CJ&B, membre du Groupe communautaire de la rue Verte, voir BEDO J., Aventures fraternelles…, p. 47-52.
[12] Entretien de Colette Scheenaert.
[13] Méthode mise au point par la kinésithérapeute Françoise Mézières : en 1947, elle introduit la notion de chaînes musculaires et propose une rééducation globale qui considère l’être humain dans son ensemble. Au-delà de son action curative, cette méthode a vocation éducative et préventive. Elle restaure l’équilibre du système neurovégétatif, réharmonise le schéma corporel et favorise la prise de conscience des somatisations. Voir Association méziériste internationale de kinésithérapie (AMIK), https://methode-mezieres.fr/méthode-mezieres, page consultée le 24 mars 2025.
[14] Marie Bezerdjan, Brigitte Installé, Clément Loix, Myriam Provost, Nadine Schelstraete, Colette Scheenaert, Maggy Uytenbroeck-Payen, Bernard Vercruysse, Maryrose [sic] Warichet-Misson. Annexes au Moniteur belge, 20 avril 1978, p. 1479.
[15] Annexes du Moniteur belge, 20 avril 1978, p. 1479-1480.
[16] L’AG du 23 février 1984 révise certains articles. Sont nommés administrateurs Maryrose Warichet (présidente), Myriam Provost (secrétaire) et Luc Lenel. Annexes au Moniteur belge, 18 avril 1985, p. 2057.
[17] L’ASBL SSQ 1030 est lancée en 1973 par Paul Lauwers, à partir des secrétariats sociaux des paroisses. Elle est reconnue comme centre de service social par l’arrêté royal du 13 juin 1974. Elle dispose d’une permanence sociale, au numéro 45, rue Van Schoor. Elle développe des actions spécialisées : travail de quartier, logement, scolarité… Elle est à la base de réseaux : le Développement social de quartier, la Coordination sociale avec la commune et le CPAS, etc. Les archives de l’ASBL ont fait l’objet d’un relevé par le CARHOP. Voir aussi MACHIELS C., L’évolution du sens du travail social. Une rencontre avec Marie-Christine Renson, assistante sociale aux Services sociaux des quartiers 1030, CARHOP, Bruxelles, 2019.
[18] Entretien de Marie-Rose Warichet-Misson par Marie-Thérèse Coenen, Woluwe-Saint-Lambert, 4 février 2025.
[19] Fonds SSQ 1030 et UL, n°31, rapport d’activités 1979, p. 6.
[20] Équipe de la Maison médicale du Nord, « Projet « personnes âgées » », Santé conjuguée, n°10, octobre 1999, p. 63-65.
[21] « Formation d’interprètes immigrées en milieu médico-social », Courrier de la Fédération des maisons médicales, n°32, juin 1986.
[22] Entretien Marie-Rose Warichet-Misson.
[23] Dr. DE KEUSER, Dr VERCRUYSSE B., « La Fédération des associations des médecins généralistes de Bruxelles en action », Bruxelles Santé, n°3, septembre 1996, p. 11.
[24] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 4 ; VERCRUYSSE B., « Des plaintes extrêmement atypiques… L’expérience d’une Maison médicale immergée dans un quartier à forte densité de patients turcs », Santé conjuguée, n°7, janvier 1999, p. 35-38.
[25] L’équipe de la Maison médicale du Nord, « Groupe de parole de femmes diabétiques », Santé conjuguée, n°10, octobre 1999, p. 68.
[26] Voir DE VRIENDT K., Mijn hoofd kan mijn lichaam niet meer dragen. Een onderzoek naar de betekenis van de zwaarlijkvigheid binnen het klachtenpatroon van Turkse vrouwen, Leuven-Amerfoort, ACCO-Amersfoort, 1989, 121 p.
[27] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, rapport d’activité de la MMN présenté à l’assemblée générale du 27 février 1986.
[28] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 4.
[29] Pascale Degryse est assistante sociale stagiaire entre 1992 et 1993. Son rapport de stage a pour sujet : Coordination des soins à domicile. Expérience d’une année de collaboration entre la Maison médicale du Nord et les Services sociaux des quartiers 1030, octobre 1992-octobre 1993.
[30] Fonds SSQ 1030 et UL, n°19-1, note de Pascale Degryse présentée à la réunion de la MMN, 5 janvier 1995.
[31] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 4.
[32] LEMAN J., GAILLY A., Thérapies interculturelles : l’interaction soignant-soigné dans un contexte multiculturel et interdisciplinaire, Bruxelles, De Boeck Université, 1991.
[33] Fonds SSQ 1930 et UL, n°19-3, procès-verbal de l’assemblée générale de la MMN du 28 février 1985.
[34] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, procès-verbal du conseil d’administration de la MMN du 24 octobre 1985.
[35] News : périodique de la Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones, n°9, octobre 1997.
[36] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, procès-verbal de l’assemblée générale de la MMN du 28 février 1985.
[37] « Une médecine à la dimension du quartier : la Maison médicale présentée par un de ses membres », Le Courrier de Schaerbeek-Saint-Josse, n°2, avril 1981, p. 2.
[38] Fonds SSQ 1030 et UL, n°17, compte-rendu de la journée de la MMN consacrée entièrement à la redéfinition du projet MMN, état des lieux, changement attendu et apport du passage au forfait ou non, du dimanche 14 septembre 1997.
[39] Fonds SSQ 1030 et UL, n°19-2, réunion de la MMN sur le forfait, juillet 1997.
[40] VERCRUYSSE B., La Maison médicale du Nord, chapitre 8.
Pour citer cet article
Coenen M.-Th., « Soigner dans un quartier majoritairement immigré : la Maison médicale du Nord à Schaerbeek », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 26 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes ! Panorama d’initiatives inspirantes, mai 2025, mis en ligne le 28 mai 2025, https://www.carhop.be/revuecarhop/
La Maison médicale Bautista Van Schowen à Seraing : témoignage du docteur Pierre Drielsma
Propos entre autres recueillis par Dawinka Laureys (historienne, IHOES asbl)
À partir de 1981, Pierre Drielsma s’implique activement à Maison médicale Bautista Van Schowen à Seraing (BVS) et à la Fédération des maisons médicales (FMM)[1]. Il a confié ses archives à l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale de Seraing (IHOES). Féru de mémoire orale, ce centre d’archives privées a choisi, à l’occasion de cet article, de recueillir les propos de Pierre Drielsma sur son parcours de vie et son engagement dans le mouvement des maisons médicales. Des étudiant.e.s en histoire de l’ULg l’ont interrogé sur sa jeunesse, sa formation, sa pratique médicale à l’étranger et les aspects médicaux, sociaux et organisationnels du travail en maison médicale, tandis que Dawinka Laureys l’a questionné sur la création, les spécificités et l’évolution de BVS, mais aussi sur les défis actuels des maisons médicales[2]. Elle nous livre ici différents extraits de ces deux entretiens, qui témoignent de l’expérience du docteur Drielsma à la BVS. Pour plus de fluidité, des modifications de forme ont été apportées, en respectant le fond des propos.

La Maison médicale Bautista Van Schowen[3] voit le jour en février 1974 à Seraing[4]. Première du genre en région liégeoise, elle remet « en question l’image d’une médecine technique toute puissante » et défend « une approche holistique de la santé, la non-hiérarchie, l’autonomie et la participation des patients »[5]. Elle porte le nom d’un médecin chilien, militant révolutionnaire assassiné sous Pinochet en 1973. Elle s’enracine dans le mouvement de contestation de Mai 1968 et dans les travaux du Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM). Occupant le territoire de « l’ancien Seraing »[6], sa patientèle représente moins de 2 000 personnes au départ et plus de 4 000 actuellement. L’une des caractéristiques de ce centre de santé intégré est de fonctionner en autogestion. En 1980, une coopérative de patients s’y constitue. La même année, BVS fait partie des membres fondateurs de la Fédération des maisons médicales. En 1984, elle adopte le financement au forfait, une première pour une maison médicale. Longtemps, elle pratique l’égalité salariale de ses travailleurs et travailleuses, au nombre de huit en 1977 et de 34 aujourd’hui.
|
Brève biographie de Pierre Drielsma Pierre Drielsma est né à Liège le 28 janvier 1952. Voulant se lancer dans la recherche, il entreprend d’abord des études de biologie à l’Université de Liège. Enfant de Mai 68, soucieux de faire correspondre sa carrière professionnelle avec un combat politique ancré à gauche, il s’oriente ensuite vers des études de médecine à l’Université libre de Bruxelles, discipline plus « concrète » qui lui permettra de pratiquer son métier en milieu populaire et d’appliquer sur le terrain le changement social radical qu’il appelle de ses vœux. En octobre 1981, son diplôme en poche, il est engagé au centre de santé intégré Bautista Van Schowen à Seraing. Il y porte une vision holistique de la médecine, consistant à dépasser la seule relation thérapeutique pour s’intéresser au patient dans sa globalité. Pierre Drielsma est également l’un des pionniers de la conquête du paiement au forfait en maisons médicales. Après 39 ans à BVS, il passe à la Maison médicale de Jemeppe-sur-Meuse et au Centre médical des Marêts à Seraing. Outre son travail de praticien, Pierre Drielsma est actif au sein de diverses institutions ou commissions en lien avec la santé, notamment dans le Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM), dont il a été le dernier président à partir de 1993 ; à la Fédération des maisons médicales (FMM) dont il rejoint l’organe d’administration en 2023, après plusieurs décennies passées dans diverses de ses instances (cellule politique, bureau stratégique, etc.) ; à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ; à la Commission d’agrément des Associations de santé intégrées (ASI) de la Région wallonne ; au Groupement belge des omnipraticiens (GBO) ; ainsi qu’à l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AVIQ). |
Soigner les femmes violentées : la Maison médicale du Maelbeek collabore avec le Collectif pour femmes battues
Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)
À partir des années 1960, dans une période de profonde remise en cause des relations d’autorité, les initiatives se multiplient pour défaire les hiérarchies et émanciper les personnes souffrant d’oppression. Parties prenantes de ce mouvement contestataire, les maisons médicales entendent favoriser, par le biais des soins médicaux, l’émancipation des populations précarisées. La Maison médicale du Maelbeek nous en offre un exemple éloquent. Dès sa création en 1976, elle construit de riches collaborations avec des organisations qui défendent les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables. Elle établit notamment une synergie étroite avec l’ASBL Le Pivot, une association qui construit de multiples projets avec les familles frappées de grande pauvreté. Elle tisse aussi une collaboration durable avec le Collectif pour femmes battues, une association féministe qui gère le premier refuge dédié aux femmes violentées[1].
Dans une période où les violences faites aux femmes sont encore largement minimisées, cette collaboration est pionnière et c’est pourquoi nous avons choisi de l’investiguer. Quelles sont ses racines, sa concrétisation et ses avantages pour les femmes en détresse ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers (deux médecins qui se sont activement impliquées au Refuge durant une quarantaine d’années), Marie-Pascale Minet (infirmière à la Maison médicale, également intervenante au Refuge)[2] et Odette Simon (co-directrice du Collectif pour femmes battues pendant 25 ans)[3]. Complétés par quelques archives conservées à la Maison médicale, leurs substantiels témoignages racontent la dynamique de l’engagement. Ils révèlent aussi la richesse des activités déployées en maisons médicales ; une richesse que notre angle d’approche, les soins aux femmes violentées, ne fera qu’esquisser[4].
La Maison médicale du Maelbeek
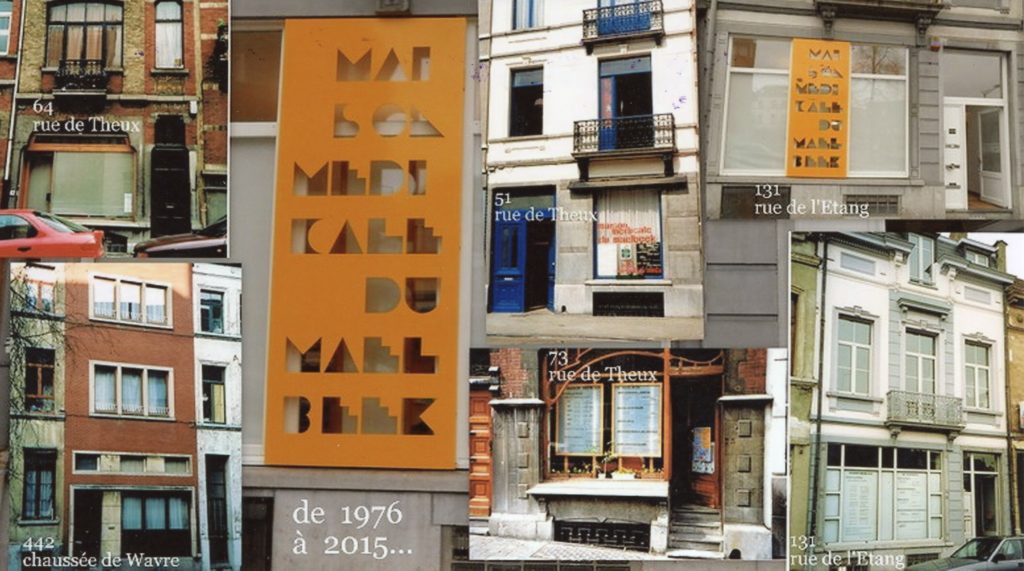
La création de la Maison médicale du Maelbeek remonte à 1976, quand quelques ami.e.s fraichement diplômé.e.s en médecine (ou en passe de l’être) décident d’exercer dans le quartier de la place Jourdan à Etterbeek, un quartier bruxellois qui concentre alors une population frappée de grande pauvreté. Dans le sillage de Mai 68, ils s’installent dans une maison communautaire et organisent les consultations médicales au rez-de-chaussée, dans une relation poreuse avec leurs espaces de vie, car ils souhaitent garder leurs portes « toujours ouvertes pour les patients et familles du quartier »[5]. À l’origine, l’équipe médicale se compose de deux médecins généralistes. Elle se renforce et s’interdisciplinarise rapidement avec l’arrivée en 1977 d’une infirmière, d’une kinésithérapeute, de deux nouveaux médecins et, plus tard, d’une assistante sociale.
En 1978, l’initiative s’institutionnalise et l’ASBL Promotion santé est créée. Une charte constitutive de la Maison médicale est alors rédigée, qui indique clairement sa volonté de « lutter contre tout ce qui entretient les inégalités sociales, raciales, sexuelles et culturelles devant la santé » et de travailler pour le « droit à la santé pour les personnes les plus exclues »[6]. Pour l’équipe, qui s’appuie sur les recommandations de la conférence de l’Organisation mondiale de la santé tenue la même année à Alma-Ata (URSS), soigner dépasse largement le cadre d’une consultation médicale individuelle. Pour être en bonne santé, les personnes doivent disposer de leurs droits fondamentaux, avoir une bonne estime d’elles-mêmes et être bien intégrées dans la société. Les patient.e.s doivent donc être appréhendés à la fois dans leur dimension physique, psychique et sociale, avec une large attention pour leur autonomie.


C’est pourquoi, dès l’origine, les consultations médicales se doublent de projets dits « communautaires » qui prendront au fil des ans des formes variées, comme des sorties au parc, des activités sportives, des cours de cuisine, la création d’espaces de paroles et de réseaux d’entraide ou la mise sur pied d’un service Garde d’enfants malades à domicile. En 1982, la Maison médicale du Maelbeek s’affilie à la nouvelle Fédération des maisons médicales.
Le terreau de l’engagement
La jeune équipe est socialement engagée. Le cofondateur de la Maison médicale, Luc Colinet, raconte avoir été marqué par Hélder Câmara, un évêque catholique brésilien qui militait pour les droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté. Il fréquentait aussi ATD Quart Monde, une association créée en France par le prêtre catholique Joseph Wrezinski pour combattre la grande pauvreté, et qui s’implante à Bruxelles au début des années 1970[7]. Professeur dans l’enseignement secondaire, Luc Colinet décide d’étudier la médecine pour partir en coopération au développement, avant de choisir de se consacrer aux patients précarisés en Belgique[8]. Anne-Françoise Dille se souvient avoir été bouleversée par les événements de Mai 68 qui la décident à s’« engager pour un autre monde »[9]. Durant ses études de médecine, elle s’active dans les assemblées étudiantes et adhère aux idées de gauche, voire d’extrême gauche. Bénédicte Roegiers raconte avoir grandi dans un « terreau familial avec une attention portée aux personnes qui ont moins de chance que nous »[10]. À l’école secondaire, des professeures lui font découvrir l’ASBL Rasquinet, une association fondée en 1972 à Schaerbeek et qui organise des animations sportives et culturelles, puis une école de devoirs pour les jeunes du quartier populaire Josaphat[11]. Durant ses études de médecine, elle se souvient aussi avoir été marquée par la personnalité de Jean Carpentier, un médecin communiste poursuivi en France pour avoir promu l’éducation sexuelle à l’école, et qui aurait « embarqué des générations de soignants dans sa rébellion à la fois joyeuse, clairvoyante, habile, se méfiant des institutions mais jouant avec elles, à la fois franc-tireur et fédérateur »[12].
Durant leurs études à l’Université de Louvain, ces trois futur.e.s médecins s’intéressent déjà au Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM) qui, fondé en 1964, conteste les hiérarchies dans le monde médical et propose différentes voies pour démocratiser l’accès aux soins médicaux, comme la création de centres de santé intégrés qui préfigurent les maisons médicales. Cette nouvelle manière de concevoir la médecine, pluridisciplinaire, émancipatrice et en phase avec les conditions de vie de la patientèle, correspond pleinement à leurs aspirations. Au terme de leurs études, Luc Colinet et Anne-Françoise Dille s’impliquent immédiatement dans la création de la Maison médicale du Maelbeek. Bénédicte Roegiers les rejoint en 1983, après avoir co-fondé une maison médicale à la rue de l’Enseignement à Bruxelles[13]. Marie-Pascale Mine, qui raconte avoir été baignée dans une culture familiale qui la portait à prendre soin des autres et s’être investie dans des chantiers d’ATD Quart Monde, rejoint l’équipe en 1988. Variés, les chemins de l’engagement, qui se conjuguent à des liens d’amitié, les conduisent donc au même projet.
Le Collectif pour femmes battues

Le Collectif pour femmes battues se construit aussi sur le socle de l’engagement, celui du féminisme de la seconde vague qui, dans les années 1970, conteste bruyamment le patriarcat et les inégalités qui frappent les femmes dans tous les domaines de la société[14]. Les militantes dénoncent aussi les violences physiques et sexuelles et la passivité des autorités publiques qui laissent les victimes sans moyen. En 1976, elles organisent à Bruxelles un Tribunal international des crimes contre les femmes qui réunit près de 2 000 participantes du monde entier[15]. Quelques mois plus tard, s’inspirant d’initiatives d’Erin Pizzey[16] en Angleterre, des militantes décident de créer des refuges où les femmes victimes de violences familiales pourront provisoirement trouver un toit, de l’aide et la sécurité. En 1977, l’ASBL Collectif pour femmes battues est fondée pour assurer « l’apaisement de la souffrance des femmes qui sont sérieusement ou régulièrement menacées ou maltraitées par leur (ex-)mari ou par d’autres hommes avec qui elles vivent ou vivaient, ainsi que l’aide à leurs enfants »[17]. Un premier refuge ouvre ses portes dans le grenier d’un bâtiment vétuste situé rue du Trône à Bruxelles, pas loin de la Maison médicale du Maelbeek.

Durant les premières années, le Refuge survit grâce à des dons privés et à l’investissement de militantes bénévoles. Au tournant des années 1970, au terme de vifs débats, il s’ouvre à la professionnalisation et aux reconnaissances des autorités publiques qui garantissent des subsides plus récurrents. C’est à ce moment qu’Odette Simon arrive au Collectif. Interrogée sur les racines de son engagement, elle raconte un milieu familial porté sur les soins aux autres (son père médecin soignait des patients du CPAS), des professeures qui l’ont éveillée au féminisme et la volonté, en entrant au Collectif, de s’engager pour les droits des femmes[19].
La rencontre
La sensibilité de la Maison médicale aux populations précarisées favorise la rencontre avec le Collectif pour femmes battues. Elle se produit en 1977, quand la sœur d’un médecin qui intervient au Refuge, demande à Anne-Françoise Dille si la Maison médicale pourrait participer aux soins. C’est le départ d’une longue collaboration toujours actuelle. « Cela s’est installé comme ça (…) on répondait de manière ponctuelle à des demandes, essentiellement des visites au Refuge (…) Petit à petit, notre collaboration, qui se passait bien, est devenue une évidence ; quand il y avait une demande médicale au Refuge, on s’adressait à la Maison médicale et, de fil en aiguille, on est devenus les référents du Refuge »[20].

Alors qu’à cette époque, les violences faites aux femmes restent encore largement taboues et que la lutte ne fait que s’amorcer, cet investissement (parfois bénévole) s’inscrit pleinement dans la philosophie de la Maison médicale et il reçoit immédiatement le soutien de l’équipe : « travailler en maison médicale, c’est un état d’esprit, c’est une envie de travailler ensemble, de travailler dans un quartier bien défini, avec une sensibilité à certaines souffrances d’une partie de la population dont faisaient partie les violences faites aux femmes »[21]. Bénédicte Roegiers confirme : « dans l’équipe, en tout cas au niveau des médecins, ce qui m’a toujours émerveillée, c’est que tout le monde y allait avec autant de bienveillance, de patience, d’envie de vraiment prendre soin de la personne »[22]. Pour Marie-Pascale Minet, « Il y avait cette volonté commune d’aborder autrement les populations en souffrance (…) C’est un mouvement qui dépasse largement la médecine générale et les projets mêmes d’une maison médicale, c’est un vrai projet de société »[23].
Une synergie au bénéfice des femmes en détresse
Pour plusieurs raisons, le Collectif pour femmes battues trouve avantage à collaborer avec l’équipe de la Maison médicale. Les médecins acceptent de dresser des certificats constatant les blessures, un acte très appréciable à une époque où la violence familiale n’est pas encore reconnue et où beaucoup de confrères rechignent à ces constats. « Vous étiez vraiment très précieuses aussi pour cela », se souvient Odette Simon[24]. Il y a aussi l’avantage des permanences, car un médecin peut être appelé à tout moment, même la nuit et le week-end, par exemple, quand des femmes font de fortes crises d’angoisse à soulager sans tarder. La confiance qui se construit au fil du temps est aussi très précieuse : le Collectif peut compter sur la qualité et la continuité des soins, mais aussi sur la discrétion de l’équipe qui est consciente que l’adresse du Refuge doit rester secrète et qu’elle doit agir en toute prudence. Au départ, les soins sont donnés au Refuge puis, dans les années 1990, les femmes commencent aussi à être reçues aux consultations de la Maison médicale. Elles y sont directement orientées par le Collectif (sans passer par le Refuge), ou elles y poursuivent leurs soins après leur sortie du Refuge.

Soigner avec délicatesse
Soigner les femmes violentées réclame beaucoup de tact et d’empathie. Comme le rappelle Odette Simon, « non seulement il y avait la violence qui venait de se produire, mais il y avait souvent aussi un long passé de violences, parfois dès l’enfance »[25], un passé traumatique qui peut laisser des traces durables dans la perception des corps. Les médecins doivent dès lors gagner la confiance de la personne « pour qu’elle accepte d’ouvrir son cœur et de se laisser examiner, pour qu’elle se livre un petit peu sur ce qui s’est passé, qu’elle nous autorise à l’examiner, à la toucher parfois. (…) que la personne accepte de se laisser examiner par quelqu’un qui était bienveillant, mais qui pouvait rappeler la personne violente qui avait été à la source de ses blessures »[26]. Une acceptation qui réclame un long travail de réappropriation : « c’est toute la réconciliation, au-delà de la première prise en charge, avec le fait d’accepter que quelqu’un l’aide dans la prise en charge de sa santé, l’aide à aller mieux, l’aide pour son bien-être … » [27]. Les militantes du Collectif et les médecins sont aussi d’accord de ne pas psychologiser et surmédicaliser le problème des violences. Pour les militantes, « une femme opprimée n’est pas une femme à soigner. (…) La vraie raison réside dans le fait que les hommes veulent être supérieurs aux femmes et maintiennent leurs pouvoirs en les traitant avec violence »[28]. Pour les médecins, « Il y a un grand souci de ne pas médicaliser à outrance les situations ; la globalité de la santé n’est pas un vain mot. »[29]

Les avantages d’une équipe pluridisciplinaire
La pluridisciplinarité de l’équipe de la Maison médicale est aussi un avantage, car tous les intervenant.e.s (infirmière, kinésithérapeute, psychothérapeute) apportent leur contribution. Les médecins ne sont pas seul.e.s face à des situations lourdes à gérer, aussi sur le plan émotionnel et, comme pour leurs autres patient.e.s, les cas complexes sont discutés en équipe pour obtenir un éclairage différent. La Maison médicale adapte aussi ses activités de santé communautaire à la situation particulière des femmes violentées. À partir de 2000, des réunions-santé sont organisées au Refuge, durant la soirée, quand les enfants sont au lit et que les femmes sont disponibles pour échanger. Comme les autres patient.e.s de la Maison médicale, ces femmes connaissent mal leur corps, leur cycle menstruel, la contraception, et elles s’interrogent aussi sur la santé et l’éducation de leurs enfants.

Comme « le pouvoir sur soi passe aussi par la connaissance de son corps »[31], Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers, qui s’investissent beaucoup au Refuge et qui ont la confiance des femmes, répondent durant ces soirées à leurs questions et favorisent le dialogue : « c’était un échange, cela n’avait rien de haut vers le bas, les femmes nous posaient des questions et on leur répondait, on apportait parfois des petits prospectus qu’elles pouvaient lire. (…) c’était tellement enrichissant, parce que là aussi, elles avaient confiance, elles se dévoilaient un petit peu, elles partageaient entre elles leurs soucis de santé et nous, on essayait d’y répondre (…) C’était vraiment un très beau partage qui a continué pendant plusieurs années »[32]. Les interventions de l’équipe médicale sont très appréciées, tant par les femmes que par l’équipe du Collectif. Pour Odette Simon, « Les échos étaient magnifiques, toujours, et les femmes étaient enchantées »[33]. Pour sceller davantage la collaboration, Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers entrent en 2003 dans l’Assemblée générale de l’association, rebaptisée depuis 1993 Centre de prévention des violences conjugales et familiales.
Dépister les violences au sein de la patientèle
Très sensibilisée à la problématique des violences, l’équipe de la Maison médicale s’attèle à déceler les situations préoccupantes au sein de sa propre patientèle, auprès de femmes qui ne se plaignent peut-être de rien, mais dont l’attitude laisse supposer des violences. Ce dépistage réclame aussi du tact et de la délicatesse, dans le choix des mots, la manière de poser les questions, selon la présence éventuelle du partenaire violent, selon la culture de la patiente, en prenant le temps nécessaire au dévoilement. Toujours sans brusquer, une aide est proposée qui peut aller jusqu’à la sécurisation de la personne si elle est en danger. Les femmes sont alors prioritairement orientées vers le Collectif, qui lui aussi agit dans le respect de la volonté de la personne. Comme en témoigne Odette Simon, « c’était accompagner quelle que soit la décision de la personne. Même si elle continuait à se faire frapper, tout ce que moi je pouvais lui dire, c’est « je suis inquiète, j’ai peur pour ta vie, j’ai peur pour ton intégrité, mais je ne peux pas le faire à ta place, à toi de voir, et au cas où, voici les possibilités.» Et puis, à un moment, elles finissaient par partir, mais parfois, ça prenait trois voire quatre ans »[34].
En l’absence de formation durant leurs études et dans une période où, répétons-le, la lutte contre les violences faites aux femmes ne fait que débuter, les médecins de la Maison médicale se forment sur le tas. Anne-Françoise Dille et Bénédicte Roegiers se nourrissent aussi d’échanges avec l’équipe du Collectif et, à partir des années 1990, de formations que celle-ci organise pour les professionnels médico-sociaux. Au fil du temps, elles-mêmes commencent à participer à des activités de sensibilisation à la prévention, l’accueil et les soins aux victimes. En 2013, Bénédicte Roegiers rédige ainsi un article « Violence conjugale, le soignant doit-il s’engager ? » pour la revue Medi-sphère destinée aux médecins généralistes[35].
Autres engagements
Cette sensibilité particulière pousse aussi l’équipe à collaborer avec d’autres organismes d’hébergement de femmes esseulées, précarisées ou violentées. À la demande du CPAS de Bruxelles, Chantal Hoornaert puis Bénédicte Roegiers se rendent chaque semaine au Home Victor Du Pré, un centre d’hébergement d’urgence bruxellois qui, depuis la fin du 19e siècle, accueille des femmes sans abri éventuellement accompagnées de leurs enfants, qui souffrent de misère extrême ou qui fuient des violences familiales[36]. Les médecins de la Maison médicale deviennent aussi les médecins référents de la maison maternelle Trois Pommiers à Etterbeek, qui accueille des femmes enceintes ou des mères esseulées qui font face à des problèmes sociaux, une séparation difficile ou des violences.

La Maison médicale, qui porte une attention particulière aux personnes immigrées, réfugiées ou sans papiers, collabore régulièrement avec des organisations qui défendent leurs droits[37]. En 2020, « une nouvelle aventure humaine a commencé »[38] : en pleine crise du Covid, elle met un bâtiment qu’elle possède rue de Haerne à Etterbeek, où ses activités seront bientôt transférées, à disposition du projet Sister’s House de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Durant dix mois, et avec le soutien de l’équipe et de bénévoles, près de 150 femmes migrantes y trouveront un toit et la sécurité[39].
« Ce sont des histoires humaines et d’engagements »[40]
Dans cette contribution, nous avons mis l’accent sur l’aide apportée aux femmes victimes de violences, ce qui n’est qu’une des multiples facettes des activités de la Maison médicale du Maelbeek. Cet angle d’approche permet de mettre clairement en perspective une dynamique de l’engagement qui, quoi qu’en disent les initiatrices, n’avait rien d’évident. La collaboration se construit alors que les violences faites aux femmes sont encore largement minimisées et que les lieux d’accueil restent dérisoires. Ni les militantes du Collectif, ni l’équipe médicale n’y sont formées. Engagées et résolues à agir, elles apprennent sur le tas et s’investissent sans compter, avec peu de moyens, sinon la ferme volonté de prendre soin des personnes les plus exclues dont font partie les femmes violentées.
Anne-Françoise Dille évoque « une force de mobilisation assez extraordinaire »[41], Bénédicte Roegiers le « terreau de l’engagement » et une « solidarité fondamentale » entre des associations « qui vivaient de bouts de ficelle ». Elle parle aussi de « la découverte d’un monde différent, tout cela avec d’autres personnes qui étaient dans le même mouvement et qui avaient la même envie de découvrir, d’être utiles ». Elle ajoute aussi la question du sens qui se nourrit de « la relation avec la personne qui est en demande d’aide » ; « je parlais du terreau et je parle du sens et je pense que si j’ai ces deux éléments-là, pour moi cela suffit à nourrir la militance (…) pour garder le sens, je ferais presque n’importe quoi ». Marie-Pascale Minet insiste aussi sur le mot « lutte », des « luttes où chacun s’est approprié sa part, avec des collaborations ». Elle parle de la « création de liens » et de la force de l’« intuitif », de « l’idée que c’est évident que c’est vers ça qu’il faut aller, même s’il n’y a pas de protocole, il n’y a pas de formation, il n’y a rien qui est établi », « cela a été construit collectivement, petit à petit, avec chaque fois, au centre, la personne en souffrance, la personne en besoin d’aide ou d’écoute ».
Aujourd’hui, cette lutte a partiellement abouti. Même si les violences persistent, les politiques de prévention et d’accompagnement des femmes violentées se sont multipliées, avec le soutien des autorités publiques. Ces engagements pionniers y ont forcément contribué, participant d’un mouvement de conscientisation qui a progressivement abouti à un changement sur le plan collectif.
Notes
[1] En 1993, le Collectif pour femmes battues devient le Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Ci-après : le Collectif.
[2] En 1976, Anne-Françoise Dille est cofondatrice de la Maison médicale du Maelbeek. Elle y exerce comme médecin généraliste de 1977 à 2019 ; Bénédicte Roegiers est médecin généraliste à la Maison médicale du Maelbeek de 1983 à 2023 ; Marie-Pascale Minet y est infirmière de 1988 à décembre 2024. En 2020, elle a rejoint le Bureau politique de la Fédération des maisons médicales.
[3] Odette Simon entre au Collectif en 1981 et y devient conseillère conjugale et psychothérapeute. En 2025, elle fait toujours partie de l’Assemblée générale.
[4] L’interview d’Anne-Françoise Dille, Bénédicte Roegiers, Marie-Pascale Minet et Odette Simon s’est déroulée le 31 janvier 2025 à la Maison médicale du Maelbeek à Etterbeek. Ci-après : Interview du 31/1/2025. Cet article se nourrit aussi d’une interview de Luc Colinet, médecin fondateur de la Maison médicale du Maelbeek, réalisée par Marie-Pascale Minet et Jérémie Dernier le 4 octobre 2023 et conservée à la Maison médicale du Maelbeek (ci-après : Entretien Luc Colinet, 2023). Il se base en outre sur diverses sources écrites, notamment des rapports d’activités conservés à la Maison médicale du Maelbeek.
[5] Archives Anne-Françoise Dille, document « Promotion Santé asbl. Maison médicale du Maelbeek. Ligne du temps (interne) en vue du Congrès FMM de février 2006 », septembre 2005.
[6] Archives Anne-Françoise Dille. « Promotion santé asbl. Idéologie de base », [1993].
[7] Sur l’histoire de cette association : BRODIEZ-DOLINO A., ATD Quart Monde, une histoire transnationale, PUF, 2025.
[8] Entretien Luc Colinet, 2023.
[9] DILLE A.-F., interview du 31/1/2025.
[10] ROEGIERS B., interview du 31/1/2025.
[11] « Rasquinet ASBL 50 ans », https://www.rasquinet.org/w/historique/, page consultée le 20 février 2025.
[12] VOSSEM D. et PRÉVOST M., « Hommage à Jean Carpentier », Santé conjuguée, n°69, décembre 2014, https://www.maisonmedicale.org/hommage-a-jean-carpentier/, page consultée le 20 février 2025.
[13] « Bref historique des locaux de la maison médicale Enseignement » dans 2024, une année de transition, https://mmenseignement.be/wp-content/uploads/2024/01/JOURNAL-TRANSITION-OK.pdf, page consultée le 20 février 2025.
[14] Sur l’histoire du Collectif pour femmes battues, voir : THIRY M., Violences conjugales : évolutions d’une lutte, Bruxelles, éditions Labor, 2004.
[15] GILLES V., Le Tribunal international des crimes contre les femmes de 1976 : une critique toujours actuelle de notre système juridique, CVFE, 2024, https://www.cvfe.be/images/eduperm/Publications/Le%20Tribunal%20international%201976%20une%20critique%20toujours%20actuelle%20de%20notre%20systeme%20juridique%201.pdf, page consultée le 22 février 2025.
[16] Erin Pizzey est une militante anglaise qui, au début des années 1970, participe à Londres à la création des premiers refuges pour femmes battues. En 1975, des féministes bruxelloises l’invitent à venir présenter ces initiatives pionnières et inspirantes. THIRY M., Violences conjugales…, p. 35-36.
[17] Cité dans THIRY M., Violences conjugales…, p. 41.
[18] « Où en sont les refuges pour femmes battues? », Actualité Santé, une publication du GERM, n°11, mars 1979, p. 8-10.
[19] SIMON O., interview du 31/1/2025.
[20] DILLE A.-F., interview du 31/1/2025.
[21] Idem.
[22] ROEGIERS B., interview du 31/1/2025.
[23] MINET M.-P., interview du 31/1/2025.
[24] SIMON O., interview du 31/1/2025.
[25] Idem.
[26] ROEGIERS B., interview du 31/1/2025.
[27] Idem.
[28] THIRY M., Violences conjugales…, p. 54-55.
[29] Archives Maison médicale du Maelbeek, document « Projet Rapport annuel 2011 », 2012, p. 18.
[30] ROEGIERS B., « Réunion-santé, un pléonasme ? », Santé conjugée, 1999, p. 34.
[31] DILLE A.-F., interview du 31/1/2025.
[32] ROEGIERS B., interview du 31/1/2025.
[33] SIMON O., interview du 31/1/2025.
[34] SIMON O., interview du 31/1/2025.
[35] ROEGIERS B., « Violence conjugale : le médecin doit-il s’engager ? », Médi-sphère, n° 415, 30 mai 2013, p. 30-31.
[36] MARISSAL C., L’Œuvre de l’hospitalité de Bruxelles. Un siècle d’histoire 1886-1986, Université libre de Bruxelles, mémoire inédit en Histoire contemporaine, 1991.
[37] En 2009, Anne-Françoise Dille et Chantal Hoornaert (également médecin généraliste dans l’équipe du Maelbeek) co-signeront un article dénonçant la pénible condition des personnes sans papiers et ses graves conséquences pour leur santé physique et mentale : ALALUF V., WUIDAR M.-J., HOORNAERT C., DILLE A.-F. et al., « Santé des sans-papiers : réaction d’un ensemble de soignants de maisons médicales à Bruxelles », Santé conjuguée, n°48, avril 2009.
[38] Archives Maison médicale du Maelbeek, document « RA 2020 finale », p. 32.
[39] KASSOU M., « La Sister’s House fête ses 5 ans », https://www.bxlrefugees.be/2023/11/03/5ans-sh/, page consultée le 10 février 2025.
[40] ROEGIERS B., interview du 31/1/2025.
[41] Toutes les citations de ce paragraphe sont issues de l’interview du 31/1/2025.
Pour citer cet article
Marrisal C., « Soigner les femmes violentées : la Maison médicale du Maelbeek collabore avec le Collectif pour femmes battues », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 26 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes ! Panorama d’initiatives inspirantes, mai 2025, mis en ligne le 28 mai 2025, https://www.carhop.be/revuecarhop/
Agir pour le bien-être mental d’hommes précarisés : un projet de l’Entr’aide des Marolles à Bruxelles
Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)
Introduction
Dans le dernier numéro de Dynamiques consacré aux maisons médicales, nous avons relaté la création et les premières années de vie de l’Entraide des travailleuses, un centre médico-social fondé en 1925 dans le quartier populaire des Marolles à Bruxelles. Dès 1931, cette association commence à prodiguer des soins médicaux pluridisciplinaires, à la fois préventifs et curatifs, à des milliers de familles précarisées, tandis que son service social travaille à l’amélioration de leurs conditions de vie[1]. Dans ce premier récit, nous avons montré l’ancrage ancien de la médecine sociale. Nous l’avons arrêté au seuil des années 1970, quand une nouvelle génération de maisons médicales s’apprête à reformuler les conceptions sociales de la médecine. L’histoire de l’Entr’aide ne s’arrête pas pour autant, mais elle s’adapte à un contexte renouvelé. En 2004, elle opte même pour un nouveau nom, Entr’aide des Marolles, qui efface son origine féminine.

Dans cet article, nous revenons brièvement sur l’évolution de l’Entr’aide des années 1970 à nos jours. Ensuite, parmi toutes les possibilités qui s’offrent à nous – car l’histoire de cette association est riche –, nous choisissons de mettre en exergue un projet initié en 2005, les Hommes des Marolles, qui vise l’amélioration du bien-être mental d’hommes isolés et précarisés. Ce projet est intéressant à plus d’un titre. Il correspond aux actions de santé communautaire développées en maisons médicales qui, conformément à la Déclaration d’Alma-Ata de l’Organisation mondiale de la santé (URSS, 1978), visent à la fois le bien-être physique, mental et social, car la santé est « un état de complet bien-être et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité »[2]. Le projet Hommes des Marolles montre aussi, au seuil du 21e siècle, l’émergence d’une nouvelle attention au genre dans les pratiques médico-sociales, auquel les théoricien.ne.s et les pédagogues du travail social commencent seulement à s’intéresser[3]. Enfin, ce projet est aussi original parce qu’il vise spécifiquement des hommes éloignés des dispositifs sociaux. Il indique également la réactivité précoce du monde associatif à une nouvelle préoccupation du secteur social, et son aptitude à imaginer des pratiques en phase avec les besoins des bénéficiaires.
L’évolution organisationnelle de l’Entr’aide en quelques mots
En 1974, la fondatrice et cheville ouvrière de l’Entr’aide des travailleuses, Thérèse Robyns de Schnedauer, décède. Si sa mémoire reste longtemps très présente dans l’association, son décès mène au changement. Dans ses nouveaux statuts publiés en 1974, l’Entr’aide redéfinit ses objectifs. Elle vise désormais « un travail psycho-médicosocial par la création de consultations spécialisées (…) et une action individualisée en vue d’informer et d’éduquer les membres des familles, aussi bien les parents que les enfants, tant au niveau conjugal que parental »[4]. La dimension moralisatrice n’est plus énoncée et, dans un contexte de dépilarisation de la société qui atténue fortement les sentiments d’appartenance à un pilier philosophique[5], les références à l’apostolat chrétien s’effacent également.
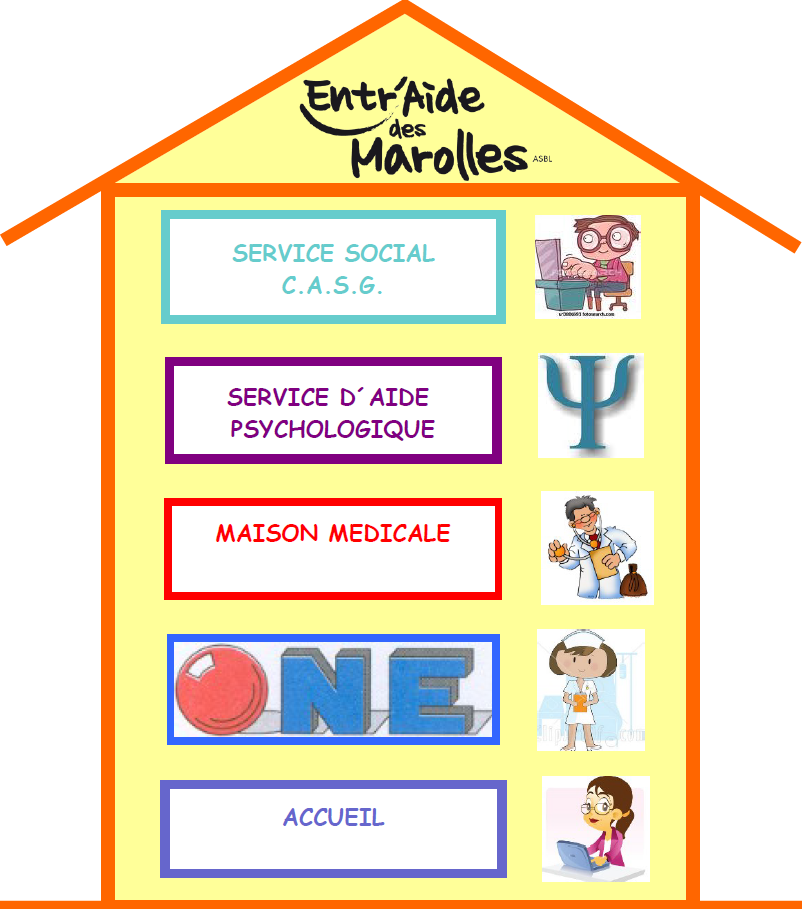
L’Entr’aide s’adapte aussi à l’évolution des sources de financement. À l’origine, elle reposait surtout sur les investissements bénévoles et les dons privés. Même si l’éclatement des subsides complique la cohésion de ses activités pluridisciplinaires[6], l’association ne cesse ensuite de saisir les opportunités de financement des autorités publiques pour consolider son assise, une tactique pragmatique toujours d’actualité. Aujourd’hui, elle abrite des consultations pour femmes enceintes et jeunes enfants de l’Office de la naissance et de l’enfance, son service social est l’un des neuf Centres d’action sociale globale bruxellois agréés par la Commission communautaire française (CASG, depuis 1997), ses services médicaux sont devenus Maison médicale (depuis 2011) et son Service d’aide psychologique, Service de santé mentale (depuis 2024). Elle organise aussi des cours d’alphabétisation pour les adultes, notamment pour les personnes primo-arrivantes. En 2025, ce sont près de 90 personnes – médecins, infirmières, kinésithérapeutes, travailleuses et travailleurs sociaux, psychologues, formateurs et formatrices, personnel administratif et d’entretien, accueillant.es, etc., femmes et hommes, rémunérés ou bénévoles – qui s’y activent[7].
Soigner des femmes et des hommes précarisés, belges et immigrés
Dans les années 1970, le Groupe d’étude pour la réforme de la médecine (GERM), qui conteste la médecine traditionnelle et nourrit la nouvelle génération des maisons médicales, souligne l’impact de la condition sociale sur la santé et l’accès aux soins médicaux. Il s’intéresse aux personnes du quart-monde[8] et aux personnes migrantes[9] qui souffrent de privations multiples. Réactif à la nouvelle vague féministe qui dénonce les inégalités basées sur le sexe, il s’intéresse aussi à l’impact du genre sur l’accès des femmes aux soins médicaux[10]. Dès les années 1980, ces points d’attention sont repris par la nouvelle Fédération des maisons médicales. L’Entr’aide des travailleuses, qui dispense depuis des décennies des soins à des populations précarisées, s’inscrit dans cette évolution. Des personnes immigrées sont en effet nombreuses à venir s’établir dans le quartier des Marolles et dès les années 1980, l’Entr’aide constate que ses bénéficiaires sont pour moitié des personnes du quart-monde belge, et pour l’autre moitié des personnes immigrées principalement originaires du Maghreb[11]. Belges et immigré.e.s cumulent des difficultés similaires (problèmes administratifs, financiers ou de logement), mais les immigré.e.s souffrent en outre de problèmes spécifiques liés à l’exil.
L’Entr’aide s’adapte aux nouveaux profils de ses bénéficiaires. Ses travailleuses sociales se forment à la multiculturalité et de nouvelles activités d’autonomisation et d’intégration sociale sont organisées (cours d’alphabétisation, de calcul, de gymnastique ou de cuisine). Au tournant des années 1990, l’association commence à organiser des activités pour le bien-être des femmes, en particulier celui des femmes immigrées. Elle constate en effet que les confusions d’identité qui résultent de l’exil, les conflits de génération, les mariages arrangés, la violence conjugale ou les désirs d’émancipation, provoquent de graves souffrances qui altèrent leur santé mentale[12]. En 2002, un groupe Bien-être est mis sur pied à l’initiative de l’équipe médicale. Une infirmière, des travailleuses sociales et des kinés proposent aux femmes d’une quinzaine de nationalités, diverses activités pour briser leur solitude, échanger, connaître et activer leur corps et améliorer leur santé physique, sociale et mentale[13]. Ce groupe existe toujours aujourd’hui.
|
Extrait du Rapport du Service d’aide psychologique de l’Entraide, 2011[14]. « Nous observons un nombre accru de personnes en souffrance qui vivent dans une précarité multiple (sociale, financière, professionnelle, logement, droit de séjour, …). Ces personnes, ces familles, qu’elles soient belges ou étrangères, n’arrivent plus à vivre de façon décente et se retrouvent progressivement dans un processus d’exclusion. Le nombre de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques lourds est également en augmentation, souvent en relation avec un phénomène d’exclusion sociale, une rupture de liens ou une insécurité administrative ». |
L’Entr’aide ne porte pas seulement attention à la souffrance des femmes. Dans les années 2000, elle constate une précarisation croissante de ses bénéficiaires masculins, certains vivant même dans l’errance. Elle souligne « devoir gérer des situations de plus en plus complexes, liées au contexte de précarité rencontré par les sans-abris, les migrants, les clandestins, les primo-arrivants, etc. »[15]. C’est dans ce contexte que le groupe Hommes des Marolles est créé.
Les Arsouilles, une maison médicale de quartier
Edith Lepage (Étudiante en master en Histoire, UCL)
« Ma motivation quand j’ai choisi la médecine générale, c’était d’accompagner les personnes que j’allais soigner dans une meilleure maîtrise de leur santé ».
Françoise Laboureur
« La sensation qu’ont les gens d’avoir prise sur leur existence et de partager leurs préoccupations avec les voisins, ça a un effet extrêmement bénéfique. C’est là qu’on voit le lien avec la santé des habitants ».
Pierre Brasseur.
Le modèle des maisons médicales nait à la fin des années 1960 dans le but de proposer une alternative au modèle des soins de santé de l’époque. Les maisons médicales s’opposent à « l’hospitalocentrisme »[1] alors en vogue, et souhaitent offrir une meilleure accessibilité aux soins de santé primaires. Au niveau international, la conférence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 1978 à Alma Ata met également en avant cet objectif en invitant les différents pays participants à mettre en place les structures nécessaires pour y parvenir. Lors de cette conférence, la santé est définie comme un état de bien-être physique, mais également mental et social, au-delà de l’absence de maladie.[2]
Par ailleurs, la charte d’Ottawa en 1986, fait suite à la conférence d’Alma Ata. Par la charte d’Ottawa, l’OMS fonde le courant de la « promotion de la santé » en réponse au constat que l’état de santé global des populations ne s’améliore pas proportionnellement à l’amélioration de l’offre et de la qualité des soins. Et ce, d’autant moins que l’on se retrouve bas dans l’échelle sociale. Il faut agir sur d’autres causes qui déterminent la santé et échappent à l’action des dispositifs médicaux et des actions de santé publique. La charte d’Ottawa, en l’occurrence, va plus loin et prévoit la « participation des citoyens à l’élaboration et la mise en œuvre de différentes stratégies en vue d’atteindre une meilleure santé ». La charte propose différents moyens de participation dont l’approche communautaire. « L’action communautaire tire (…) son fondement dans l’affirmation que les problèmes sociaux sont de nature collective et qu’ils doivent faire l’objet de solutions collectives. »[3] Elle est composée de différents domaines tels que des acteurs (citoyen.ne.s, décideurs et décideuses politiques, acteurs et actrices du communautaire), des espaces d’intervention privilégiés (une population vulnérable, un quartier, etc.), des finalités (amélioration de la santé et du bien-être, prévention, développement local, etc.), des méthodes (enquêtes, analyses, etc.) et des valeurs clés (justice sociale, engagement politique, etc.).[4]
En somme, la santé communautaire apparaît comme l’outil parfaitement adapté aux méthodes et aux valeurs promues par les maisons médicales. En effet, au fur et à mesure de leur développement, les maisons médicales ont intégré des principes fondamentaux, parmi lesquels on retrouve la globalité (soigner le patient en prenant en compte l’environnement économique, social, culturel, etc.), l’intégration (c’est-à-dire le fait d’articuler l’aspect curatif et l’aspect préventif, au travers d’activités qui reprennent ces aspects au sein d’un même service, ou d’une coordination entre plusieurs services), la continuité (implique que toutes les informations pour soigner le patient soient disponibles aux personnel médical) et l’accessibilité (l’accès aux soins d’un point de vue financier, géographique, dans de bonnes conditions : aménagements, horaires, personnel d’accueil, compréhension des informations…).[5]
Pour autant, chaque maison médicale est née d’un projet et d’un constat qui lui est propre. Une maison médicale ne ressemble pas à une autre. Cet article a pour but de retracer l’histoire de la maison médicale « Les Arsouilles », à Namur, et de souligner deux de ses caractéristiques : son ancrage territorial et son travail en santé communautaire.
L’interview de Françoise Laboureur et Pierre Brasseur, médecins fondateurs de la Maison médicale, constitue la source principale de cet article. Elle est complétée par les archives de la Fédération des maisons médicales, conservées au CARHOP, la revue Feuille de chou de la Maison médicale des Arsouilles, et d’autres articles sur le sujet.
Une maison médicale en devenir
Implantée dans le quartier Saint-Nicolas à Namur, la Maison médicale Les Arsouilles est créée en 2000 et trouve son origine dans une association de plusieurs médecins généralistes et d’une psychologue, fondée cinq ans plus tôt, dont font partie Pierre Brasseur et Françoise Laboureur. L’intérêt du docteur Laboureur pour la pratique en maison médicale remonte à ses études lorsqu’elle réalise, avec deux autres étudiantes, le projet d’une maison médicale comme travail de fin d’études. Celui-ci est à l’origine de la première maison médicale de Namur à Bomel, créée en 1994. C’est dans le cadre de ce travail qu’elle rencontre le médecin Pierre Brasseur.
À l’époque, Pierre Brasseur travaille en cabinet privé, mais a également développé un intérêt pour les maisons médicales lors de ses études universitaires, dans les années 1970. Il rappelle que l’apparition des premières maisons médicales s’accompagne du développement de centres de santé mentale et plannings familiaux. Ces collectifs s’inscrivent « dans un courant alternatif face à la médecine libérale, soutenant une approche pluridisciplinaire et participative, plus à l’écoute des patients ».[6] Pierre Brasseur raconte : « Mon stage dans une maison médicale très ancrée dans son quartier a été déterminant. Ce modèle m’attirait d’emblée dès ma sortie des études de médecine. »[7]
Lorsqu’il ouvre son cabinet privé à Namur en 1985, Pierre Brasseur rêve déjà depuis longtemps de créer une maison médicale, et plus particulièrement dans le quartier Saint-Nicolas. Ce quartier, dit aussi « quartier des Arsouilles », est un quartier populaire du centre de Namur composé d’une population précarisée et multiculturelle.[8] Nombre d’associations et d’organisations sociales s’y installent également.
Depuis le début du 20e siècle, la place l’Ilon, à l’entrée du quartier Saint-Nicolas, est l’endroit où se sont implantées les organisations constitutives du Mouvement ouvrier chrétien (CSC, Mutualités chrétiennes, Vie Féminine…), ainsi que des associations du pilier chrétien (ex : Centre de formation Cardijn – CEFOC), avant que certaines ne s’implantent ailleurs.[9] S’installe également une association très importante pour le quartier, le Cinex. Celui-ci est fondé en 1923 par les œuvres paroissiales de Saint-Nicolas et est devenu la maison de quartier.[10] On peut le constater, le quartier Saint-Nicolas n’est pas exempt de vie associative, lorsque la Maison médicale apparait. Cependant, ces associations ne sont pas nécessairement dirigées vers la vie de quartier. Celles liées au MOC couvrent un territoire bien plus grand que le quartier Saint-Nicolas, et seulement quelques associations, telles que l’école de devoirs et le Cinex se préoccupent du quartier en tant que tel.

« Il suffisait de pousser la porte », vers la création de la maison médicale
Installé depuis 1985, Pierre Brasseur occupe un cabinet au premier étage d’une maison, sur la place l’Ilon. En 1995, le Fonds du logement lui donne l’opportunité de louer un rez-de-chaussée pour créer une association de médecins dont Françoise Laboureur fait partie, avec un autre médecin généraliste et une psychologue. À l’époque, la coopérative « Fonds du logement » est propriétaire de plusieurs bâtiments qu’elle souhaite louer pour des services et non plus pour des commerces. Le Fonds du logement, dont la Ligue des familles nombreuses est le référent, s’occupe de l’octroi de crédits sociaux, de la rénovation immobilière, du soutien aux associations, etc. Les transformations du local seront aux frais de la coopérative et selon les besoins des médecins.[11] « Ils avaient déjà une intuition, qui est aussi révélée maintenant dans la lutte contre la gentrification. Il ne suffit pas de lutter contre une hausse des loyers pour que les habitants restent dans un quartier, il faut aussi des services. »[12], explique le docteur Laboureur.
L’impact des caractéristiques des nouveaux locaux surprend les médecins. Contrairement au cabinet privé du Dr. Brasseur situé au premier étage, les locaux de l’associations de médecins sont plus accessibles. Il suffit de pousser la porte pour entrer dans la salle d’attente. Ce rez-de-chaussée a permis aux habitant.e.s du quartier d’entrer directement en contact avec un médecin. Notamment, des primo-arrivants (la communauté albanaise ou bengali), mais aussi des patients envoyés par le CPAS passent le pas de la porte. Pierre Brasseur explique : « la manière dont les gens ont investi notre cabinet nous a permis de prendre conscience de la dimension sociale de notre clientèle, des barrières qu’il y avait pour qu’elle puisse s’adresser à nous et de toute une série de problématiques liées au fait d’habiter ce quartier ».[13]
Ainsi, franchir le pas vers la constitution en maison médicale apparait comme une évidence. À cette fin, l’équipe est accompagnée par la Fédération des maisons médicales qui a mis à sa disposition un travailleur pendant un an pour les aider à constituer leur dossier, en vue de recevoir l’agrément comme maison médicale. Il est approuvé par l’assemblée générale de la Fédération en 2000, la Maison médicale ouvre ses portes peu de temps après. Dès la constitution de son dossier, la maison médicale des Arsouilles a insisté sur sa spécificité : son ancrage dans le quartier.[14]Aujourd’hui elle est constituée de 23 travailleurs : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, assistants sociaux, accueillantes, coordinatrice et une travailleuse en santé communautaire.
Lien entre maison médicale et quartier : une spécificité des Arsouilles
« C’était un quartier de relégation »[15] explique le docteur Laboureur. Le logement n’y était pas cher, et souvent en mauvais état, de ce fait, les gens y habitaient très peu de temps et partaient dès qu’ils le pouvaient. Dès lors, la vie du quartier et l’identité de celui-ci était au point mort.[16] Afin de redynamiser le quartier Saint-Nicolas, la Maison médicale réalise divers projets en santé communautaire. La santé communautaire est une démarche qui consiste à impliquer un groupe de personnes pour qu’elles redeviennent actrices de leur santé. « Nous on y croit très fort à cette action globale car on se rend compte combien la santé psychologique est influencée favorablement par toute cette dynamique » expliquent les deux médecins. L’inclusion des habitants dans le travail de l’équipe médicale intervient à plusieurs niveaux. En 2010, les patients sont invités à donner leur avis à propos du changement de local.[17] Certains font partie de l’AG de la Maison, d’autres participent également à l’écriture de la Feuille de chou, la petite revue de la Maison médicale, etc. Celle-ci apparait en 2011 et a pour objectif de partager des conseils en matière de santé et de qualité de vie. On y retrouve des articles médicaux, mais également des appels à une marche mensuelle (devenue hebdomadaire depuis septembre 2024), des recettes de cuisine, des actualités sur le quartier et la Maison médicale, etc. Cette revue permet également à la Maison médicale de rappeler à ses usagers son fonctionnement, ses règles et ses changements. C’est un moyen de rapprocher l’équipe médicale des habitant.e.s et patient.e.s du quartier. Les habitants s’investissent petit à petit dans le quartier au travers d’autres projets communautaires tels que le P’tit Kawa, un café hebdomadaire partagé à même la rue, le potager communautaire Les Herbes folles, etc.

Focus sur un projet de santé communautaire : Coquelicot
Un des premiers projets de santé communautaire de la Maison médicale est le projet Coquelicot. En 2003, la Maison médicale réalise deux constats. D’une part, l’état de santé physique des patients est très mauvais. Le nombre de patients porteurs de problématiques complexes augmente (pathologies somatiques chroniques chez des patient.e.s de plus en plus jeunes, pathologies psychiatriques, addictions, rupture de liens sociaux et familiaux, etc.).[18] D’autre part, l’état du logement est inquiétant et l’environnement urbain dans le quartier est très dégradé. Les logements sont délabrés et insalubres. Il y a une absence totale d’infrastructures urbaines telles que des aires de jeux, des poubelles, des bancs publics, etc. Tout cela participe à une sorte d’état dépressif collectif qui empêche les habitant.e.s de se soucier correctement de leur santé, observe la Maison médicale.[19]
Forte de ces constats, l’équipe médicale décide de tenter une approche plus communautaire, afin de résoudre ces différents problèmes. Dans un premier temps, elle mobilise les associations et pouvoirs publics afin de discuter de l’avenir du quartier. À sa grande surprise, quantité de monde répond à son appel. « Dans la salle du Cinex, c’était bondé (…), même la police était venue » raconte Pierre Brasseur. La situation du quartier en « intéresse donc plus d’un ». En 2005, la Maison médicale démarre le projet Logement, santé et développement quartier Saint-Nicolas financé par la Communauté française. Cela débute par une enquête longue et minutieuse auprès des habitant.e.s du quartier. L’équipe médicale se rend directement au contact de ces derniers et prend le temps de discuter avec eux du quartier, du logement, de leur état de santé, et de l’impact des premiers sur le dernier.[20]
Un premier résultat se présente. Les habitant.e.s semblent motivés à se mobiliser autour des problématiques liées à la vie sociale et associative dans le quartier. « Le fait de demander leur avis aux habitants a eu déjà un premier impact »[21], raconte Françoise Laboureur. Dans un second temps, des groupes de travail se mettent en place. Ils rassemblent des habitant.e.s, représentant.e.s d’associations et pouvoirs publics. Ils élaborent des réflexions autour de thèmes tels que l’interculturalité, le logement, le vivre ensemble, etc.[22]

Tout au long de ce projet, la Maison médicale tient le rôle central, dans le but de continuer à promouvoir la santé. À terme, elle souhaite prendre un rôle plus secondaire. À cette fin, et pour consolider la mobilisation naissante, il devient nécessaire de créer un organe de concertation de quartier. Cet organe sera chargé de récolter les avis et les besoins des différents acteurs du quartier Saint-Nicolas, de soutenir les projets et d’« assurer, dans la durée, l’existence de lieux d’expression et d’écoute, ainsi qu’une vigilance sur la situation globale du quartier. »[23] Par ailleurs, il est important que les habitant.e.s du quartier prennent leur place dans ce nouveau dispositif. Ils seront dès lors, représentés par un comité d’habitants. En conclusion de ce long processus, l’asbl Coquelicot (Concertation-quartier-lien-coordination) nait en 2009. Il s’agit d’une structure permettant de consulter les acteurs du quartier (habitants, associations, pouvoirs publics, maison médicale, etc.) à propos des problématiques que les habitants peuvent rencontrer et de concrétiser des actions. Par exemple, en 2023, les habitants du quartier Saint-Nicolas se sont opposés à la création d’un « hub de dépôt » (hangar de stock de marchandises) par la ville dans le quartier au travers d’une lettre destinée à la ville. Les habitant.e.s ont également obtenu la piétonnisation de la rue Ponty, au cœur du quartier et dont l’angle est occupé par l’asbl Cinex (maison de quartier).[24] La mise en place de Coquelicot permet à la Maison médicale de se recentrer sur son métier principal d’acteur de la santé tout en restant un acteur du quartier.

Un enjeu actuel : la gentrification
La question qui préoccupe la Maison médicale depuis deux ans est le problème de la gentrification dans le quartier Saint-Nicolas. La gentrification est « un processus par lequel des jeunes ménages rachètent et réhabilitent d’anciens bâtiments dans des quartiers populaires ».[25] Cela s’illustre par l’opération de redynamisation du quartier Saint-Nicolas. Celle-ci s’inscrit dans une remise à neuf de la ville de Namur au travers des différents travaux (extension du piétonnier, rénovation de la salle de spectacle Grand manège, construction du palais de justice, etc.). À présent on parle du quartier Saint-Nicolas comme un quartier « plein de potentiel ».[26] Les loyers sont de plus en plus élevés, obligeant une partie des habitant.e.s à quitter leur logement, et une nouvelle population plus aisée s’installe dans le quartier. Par ailleurs, la spéculation immobilière, qui ne vise pas nécessairement à réhabiliter les logements et à y loger des personnes, soutient cette gentrification. « Il y a une dimension de perte de maitrise et de peur » de la part des habitant.e.s.[27] C’est pourquoi la Maison médicale mène des campagne d’affichage afin de sensibiliser la population à la question. Ces affiches sont réalisées dans le cadre d’activités en santé communautaire lors d’un atelier de sérigraphie.
L’équipe organise également des conférences, notamment avec Mathieu Van Criekingen, géographe à l’ULB, ainsi qu’une conférence gesticulée avec Sarah De Laet sur le thème de la spéculation, afin que les habitants comprennent et puissent poser leurs questions relatives à cette problématique. La Maison médicale et les habitant.e.s sont pleinement acteurs de cette lutte et interpellent la commune, ainsi que le CPAS qui possède une série de bâtiments dans la rue. Cette implication des habitant.e.s vise à établir une pression sur les pouvoirs publics pour les sensibiliser à générer une action de leur part.[28]
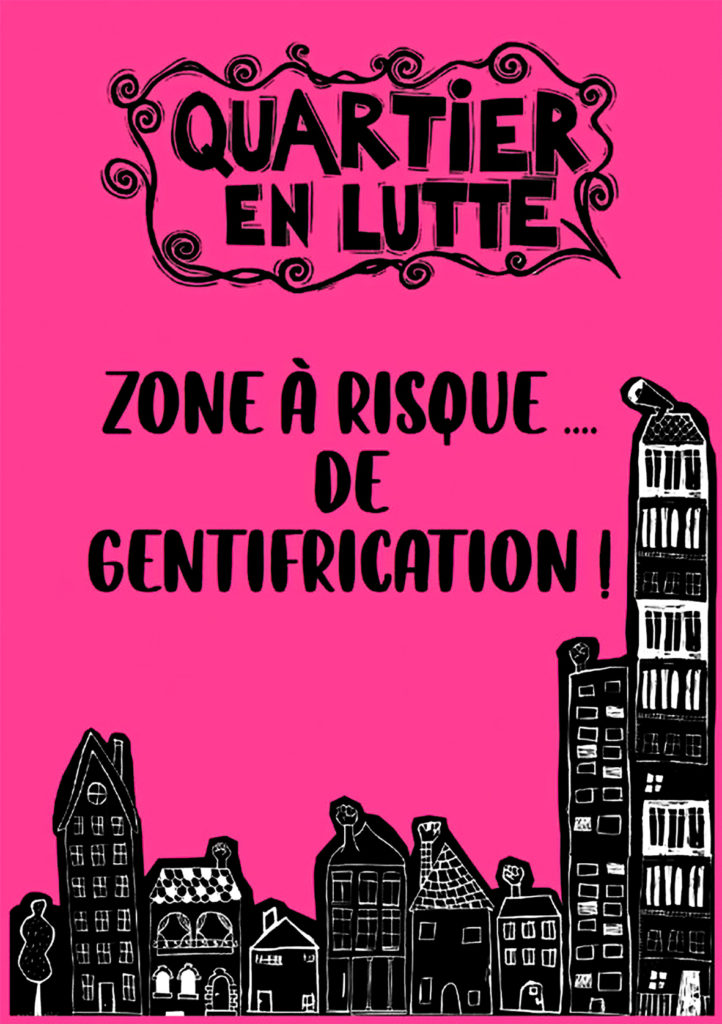
Conclusion
« La santé communautaire se distingue par un rapport au social marqué par la participation et l’insertion dans une démarche de développement » expliquent les auteurs de l’étude de 2012 sur la notion de « santé communautaire » et « santé publique ».[29] Le but est de permettre aux individus de prendre conscience de leur capacité à « faire face aux situations difficiles, clé pour le maintien de la santé mentale ». Ceci caractérise une des missions que la Maison médicale Les Arsouilles s’est donnée en s’installant dans le quartier Saint-Nicolas. En effet, Pierre Brasseur explique qu’une dynamique de démocratie directe est enclenchée dans le quartier depuis plusieurs années. La mise en place d’une dynamique de santé communautaire dans le quartier a permis aux habitant.e.s de se sentir écoutés et de réaliser ce qu’ils étaient capables de faire.
Cette évolution vers une démocratie directe et une activité intense de quartier sont assez spécifiques au quartier Saint-Nicolas, la Maison médicale et, surtout, l’asbl Coquelicot étant d’ailleurs souvent citées en exemple.[30] Cependant, cette participation des habitants à la vie de leur quartier a également le revers de sa médaille. Le docteur Brasseur explique qu’on sent également qu’une telle vie de quartier pourrait déplaire dans les administrations et les lieux de décisions politiques. Le hub n’est pas le seul point auquel les habitants se sont opposés. Les habitants se mobilisent régulièrement en faveur ou en opposition de projets défendus par la ville et ayant un impact sur le quartier. « Je trouve qu’il y a un vrai enjeu là, on a enclenché quelque chose et il faut que les gens continuent de s’en emparer et que ça continue de se structurer. »[31], explique Pierre Brasseur. Il continue en disant « Il faut aussi que ce soit entendu par les autorités communales ».[32]
On le voit, l’action de la Maison médicale des Arsouilles dépasse de loin l’acte médical. L’équipe se place dans une approche globale qui prend en compte la santé physique et mentale des habitants, mais également leur environnement économique, social et de logement. En effet, se préoccuper de l’habitat et de la santé psychologique des habitants permet à ceux-ci de retrouver un lien social. Françoise Laboureur résume ainsi « Ça aide les gens aussi à mieux se soigner, parce que quand on retrouve du lien social on retrouve du goût à la vie. ça aide à prendre soin de soi. »[33]

Notes
[1] « L’hospitalocentrisme » est un système dans lequel l’hôpital occupe la place centrale dans l’organisation des soins de santé. Cela signifie qu’il s’occupe également des soins de première ligne, fonction normalement exercée par les médecins généralistes. Cette organisation des soins de santé se développe au cours des années 1960, lorsque les technologies médicales (imagerie médicale, etc.) et les connaissances en maladies infectieuses se développent. Mais l’hospitalocentrisme tend à « déshumaniser les rapports entre patients et médecins » et à disperser les savoirs médicaux au travers de la spécialisation « à outrance » des soignants. Le développement des maladies chroniques (cancer, dépression, diabète, etc.) remet en cause le système de soins centré sur l’hôpital pour redonner une place au médecin généraliste. L’opposition à l’hospitalocentrisme est une des positions défendues par la Fédération des maisons médicales. Hendrick A. et Moreau J-L., De A à Z. Histoire(s) du mouvement des maisons médicales, Bruxelles, Hayez, 2022, p. 55.
[2] Fettuci D., « Parcours d’une intégration », Magazine C4, n°230, octobre 2017, p. 10. ; Motamed S., « Qu’est- ce que la santé communautaire ? Un exemple d’une approche participative et multisectorielle dans une commune du Canton de Genève, en Suisse », L’Information psychiatrie, vol. 91, n° 7, 2015, p. 563. ; OMS Déclaration d’Alma Ata, Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional de l’Europe, 1978, Déclaration d’Alma-Ata, page consultée le 23 novembre 2024.
[3] Morel J., « L’approche communautaire de la santé : une des stratégies d’intervention sur les déterminants socio-économiques », Santé communautaire, n° 40, avril 2007, p. 75-76.
[4] Jourdan D., O’Neil M., Dupéré S. et Stirling J., « Quarante ans après, où en est la santé communautaire ? », Santé publique, vol. 24, n° 2, p. 166-169.
[5] Roland M., et Mormont M., « 1945-1990 : maisons médicales, semailles et germination », Politique, n° 101, septembre 2017, mise en ligne le 22 décembre 2022, 1945-1990 : maisons médicales, semailles et germination – Politique , page consultée le 12 octobre 2024.
[6] Delperdange L., « Corps non soumis », Secouez-vous les idées, Juin/Juillet/Août 2019, CESEP asbl, Nivelles, p. 19. ; Fettuci D., « Parcours … », p. 8-10.
[7] Delperdange L., « Corps … », p. 19.
[8] Carhop, « Interview Françoise Laboureur et Pierre Brasseur » par Edith Lepage et François Welter, 14 octobre 2024 ; Corbeau N., « Au cœur de l’ancien quartier des Tanneurs L’hôtel « Les Tanneurs de Namur » a conservé l’âme des tanneries, malgré une vraie rénovation Namur à la Belle Epoque », Le Soir, mise en ligne le 7 août 2003, https://www.lesoir.be/art/au-coeur-de-l-ancien-quartier-des-tanneurs-l-hotel-les-_t-20030807-Z0NE92.html, page consultée le 20 octobre 2024. Cependant, le quartier, dit aussi quartier des Arsouilles, connaît une vie de folklore développée, notamment lors des fêtes de Wallonie pendant lesquelles on enterre « l’Arsouille », c’est-à-dire la « petite canaille », qui marque la fin des festivités. Comité central de Wallonie, Quartier des Arsouilles, https://www.fetesdewallonie.be/quartier/quartier-des-arsouilles/, page consultée le 23 octobre 2024.
[9] Dresse R., L’Ilon : histoire du Mouvement ouvrier chrétien à Namur (1850-1980), Namur, Carhop, 2004, p. 52-184.
[10] Fobe G., « Namur : le Cinex fête ses 100 ans », RTBF, mis en ligne le 6 novembre 2023, https://www.rtbf.be/article/namur-le-cinex-fete-ses-100-ans-11282516, page consultée le 30 octobre 2024.
[11] Fonds du logement de Wallonie, Les régies des quartiers, https://www.flw.be/associations-regiesdesquartiers/, page consultée le 09 octobre 2024.
[12] Carhop, « Interview Françoise Laboureur et Pierre Brasseur » par Edith Lepage et François Welter, 14 octobre 2024.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem.
[17] Carhop, fonds de la Fédération des maisons médicales, n° 291, Dossier concernant la mise en œuvre de la réforme relative aux associations de santé intégrée (décret ASI). Plans d’action déposés par les maisons médicales, Les Arsouilles (Namur), 2010-2012, p. 12.
[18] CARHOP, fonds de la Fédération des maisons médicales, n° 291, Dossier concernant la mise en œuvre de la réforme relative aux associations de santé intégrée… p. 7 ; Mormont, M., « Les Arsouilles : de la santé communautaire à la cohésion sociale », Alter Echos, n° 297, mis en ligne le 19 juin 2010, Les Arsouilles : de la santé communautaire à la cohésion sociale – Alter Echos, page consultée le 10 octobre 2024.
[19] Baudot E., Brasseur, P. et Delvaux M., « La santé communautaire, un long fleuve tranquille ? Développement d’une dynamique de quartier », Santé conjugée, n°49, juillet 2009, p.67.
[20] Carhop, « Interview Françoise Laboureur et Pierre Brasseur » par Edith Lepage et François Welter, 14 octobre 2024.
[21] Ibidem.
[22] Baudot E., Brasseur, P. et Delvaux M., « La santé communautaire … », p. 68.
[23] Ibidem.
[24] Ovyn E. « La rue Ponty va devenir piétonne ? Pourquoi ? Comment ? Mais d’où vient cette idée ? » Feuille de chou, des Arsouilles en santé, avril-mai-juin 2022, p. 7-9.
[25] Winandy N., « Le quartier Saint-Nicolas à Namur – Gentrification et Résistance citoyenne », Action Vivre ensemble, mis en ligne le 27 février 2024, Le quartier Saint-Nicolas à Namur – Gentrification et Résistance citoyenne – Action Vivre Ensemble, page consultée le 12 octobre 2024.
[26] Carhop, « Interview Françoise Laboureur et Pierre Brasseur » par Edith Lepage et François Welter, 14 octobre 2024.
[27] Ibidem.
[28]Ibidem.
[29] Jourdan D., O’Neil M., Dupéré S. et Stirling J., « Quarante ans après … », p. 165-178.
[30] Carhop, « Interview Françoise Laboureur et Pierre Brasseur » par Edith Lepage et François Welter, 14 octobre 2024.
[31] Ibidem.
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
Lepage E., « Les Arsouilles , une maison médicale de quartier », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 26 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes ! Panorama d’initiatives inspirantes, mai 2025, mis en ligne le 28 mai 2025, https://www.carhop.be/revuecarhop/
Soigner et défendre les droits de la patientèle : la Maison médicale de Médecine pour le Peuple à La Louvière
Camille Vanbersy (historienne, CARHOP asbl)
Dans la mosaïque des maisons médicales fondées dans les années 1970, Médecine pour le Peuple occupe une place particulière. Comme l’a montré un premier article publié dans Dynamiques en décembre 2024[1], ces maisons médicales s’implantent dans des localités industrielles où, initiées par des médecins communistes, elles dispensent des soins gratuits à des populations précarisées et défendent collectivement des travailleurs et travailleuses frappés de maladies professionnelles. Bientôt ralliées au Parti du travail de Belgique (PTB-PvdA), elles remettent profondément en cause la médecine privée et subissent de graves sanctions de la part de l’Ordre des médecins. Initiée en Flandre, Médecine pour le Peuple s’est étendue en Wallonie et à Bruxelles, avec les maisons médicales de Schaerbeek (1992), Marcinelle (1996), Molenbeek (1998) et enfin La Louvière en 1999.
C’est sur cette « jeune » Maison médicale logée au cœur de la cité des Loups que porte cet article, qui montre comment le projet politique de Médecine pour le Peuple prend forme sur le terrain, y compris dans son opposition à l’Ordre des médecins. Pour identifier ses spécificités et ses enjeux, nous avons rencontré les médecins Jan Harm Keijzer et Elisa Munoz Gomez[2]. Jan Harm Keijzer est le fondateur de la Maison médicale. Avant d’emménager dans la région du Centre, il a travaillé plusieurs années à Haïti puis a exercé pendant huit ans à la Maison médicale de Médecine pour le Peuple de Lommel. Originaire de Bruxelles, Elisa Munoz Gomez a débuté sa carrière à la Maison médicale de Médecine pour le Peuple de Marcinelle. Depuis quatre ans, elle est responsable de la Maison médicale de La Louvière.
La création de la Maison médicale de La Louvière
En 1999, pour répondre aux besoins des ouvriers et ouvrières des industries louviéroises et leur proposer une médecine gratuite, le PTB demande à Jan Harm Keijzer d’ouvrir une nouvelle maison médicale à La Louvière. Il l’établit dans l’ancienne salle de boxe du café Le Ring situé à la rue de Bouvy, à deux pas du centre-ville, dans un bâtiment vétuste et trop étroit qui sera rénové à plusieurs reprises pour répondre à ses nouvelles fonctions. À l’origine, la consultation comptait un seul médecin mais aujourd’hui, la Maison médicale comprend trois cabinets de consultation pour la médecine générale, les soins infirmiers et les consultations psychologiques, ainsi qu’une salle des fêtes pour des activités communautaires. Cinq médecins, deux infirmières, un psychologue, trois accueillantes et une technicienne de surface s’y activent, et des patient.e.s bénévoles viennent aussi en appui, s’occupant du courrier, de la mise en ordre hebdomadaire des stocks de médicaments, de réparations au bâtiment, etc. Bien que la Maison médicale dépende du PTB, les membres de l’équipe n’y sont pas tous affiliés mais, comme l’explique Jan Harm Keijzer, tous et toutes ont :
« en eux, cette fibre sociale et solidaire (…), le refus de l’injustice [et la volonté] de s’engager pour améliorer la situation et apporter une autre manière de soigner »[3].

Les conflits avec l’Ordre des médecins
Dès l’ouverture de la Maison médicale, les problèmes débutent avec l’Ordre des médecins qui accuse depuis les années 1970 les maisons médicales de concurrence déloyale envers les praticiens privés. La fête d’inauguration de la Maison louviéroise est ainsi assimilée à de la publicité illégale et l’Ordre des médecins, selon une tactique éprouvée depuis de longues années contre d’autres praticiens, assigne devant sa chambre disciplinaire, puis devant les tribunaux, les médecins louviérois accusés de pratiquer une médecine gratuite.
Les médecins sont condamnés, mais reçoivent un beau soutien de leur patientèle. Des pétitions sont lancées et des autobus sont affrétés pour les soutenir en nombre lors de leurs convocations devant l’Ordre des médecins et les tribunaux. La patientèle se mobilise aussi pour faire barrage aux saisies de biens. Jan Harm Keijzer se souvient :
« il y avait ici, à l’accueil, une accueillante bénévole âgée de 76 ans à ce moment-là, et sur ses deux béquilles, elle a dit « il faudra me passer sur le corps pour entrer » »[4].
Des barricades d’objets et de meubles sont dressées pour s’opposer aux saisies des huissiers de justice. La Maison médicale peut également compter sur le soutien des syndicats louviérois :
« On a été reçu à la réunion du SETCA ici à La Louvière, et ils nous ont promis qu’au moindre problème, on pouvait faire appel à eux et qu’ils étaient prêts à se mobiliser immédiatement pour empêcher toute prise de meubles et cela, c’est très impressionnant, car on sent toute la force des syndicats »[5].
Aujourd’hui les relations avec l’Ordre des médecins se sont apaisées et la Maison médicale peut se concentrer sur ses missions premières : soigner la patientèle.
La Fédération des maisons médicales (FMM) : le collectif pour la santé pour tous et toutes !
François Welter (historien, CARHOP asbl)
Au terme de ce double numéro consacré aux maisons médicales, le temps est venu de s’interroger sur les défis contemporains auxquels est confronté le secteur. À cet égard, le Mémorandum pour les élections de 2024, publié par la Fédération des maisons médicales (FMM), c’est-à-dire la fédération professionnelle représentant notamment le secteur auprès des pouvoirs publics, reste une boussole précieuse qui indique les priorités des maisons médicales[1]. Les revendications sont nombreuses et concernent différents niveaux de pouvoir, du communal à l’européen, en passant par le fédéral, le communautaire et le régional.
Pour éclairer ces défis contemporains, le CARHOP a rencontré la secrétaire générale de la FMM, Fanny Dubois, qui nous a expliqué le fondement et la raison d’être des maisons médicales, leur rôle fondamental pour la démocratisation de l’accès aux soins de santé, mais aussi la nécessité de défendre des mécanismes de solidarité forts (la Sécurité sociale) pour lutter contre la menace des politiques néo-libérales. La présente analyse n’a donc aucune prétention à rapporter de façon exhaustive les priorités de la FMM ; elle n’en pose que quelques jalons[2].
|
Portrait : Fanny Dubois en quelques mots Sociologue et aide-soignante à l’hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles, Fanny Dubois étudie les conditions de travail des aides-soignantes, en étant au cœur du métier. Elle analyse alors l’institution hospitalière depuis un métier situé au bas de l’échelle barémique, tellement invisibilisé, et pourtant intense[3]. En croisant les savoirs pratiques et théoriques, elle prend conscience de l’utilité de faire évoluer le système de santé et d’y contribuer. En 2012, elle complète cette approche de terrain en rejoignant Solidaris, la mutualité socialiste. Elle y appréhende les enjeux du système de santé belge et de la Sécurité sociale, qui contribuent à la redistribution et au large accès aux soins de santé. Elle se confronte aussi aux rapports de force entre les différentes professions de soin, leurs syndicats et les mutuelles, avec, pointe-t-elle, des oubliés : les patient.e.s. C’est donc porteuse d’un solide bagage pratique et théorique que Fanny Dubois rejoint en 2019 la FMM. |
Les patient.e.s, des acteurs à part entière de la santé individuelle et collective
Pour les maisons médicales, les patient.e.s sont partie prenante des processus à mener et des décisions à prendre qui engagent leur santé, pour ce qui concerne à la fois les facettes curatives et préventives, individuelles et collectives. C’est pourquoi, depuis plus de quarante ans, les maisons médicales déploient des actions de santé communautaire.
Dès les années 1960, sur l’exemple des expériences menées en Amérique latine et dans les pays anglo-saxons, le Groupe d’étude pour une réforme de la médecine (GERM) milite pour que l’individu et la communauté soient partie prenante des décisions sur les questions de santé, sur base d’une information la plus complète possible. La santé est un enjeu de lutte sociale, dès lors qu’elle considère les conditions de travail, l’environnement, l’alimentation ou le niveau culturel des patient.e.s comme des déterminants de leur état de santé. La FMM stipule dans sa Charte de 2006 que les maisons médicales doivent « favoriser l’émergence d’une prise de conscience critique des citoyens vis-à-vis des mécanismes qui président à l’organisation des systèmes de santé et des politiques sociales »[4]. L’impulsion vient aussi des organisations internationales. En 1986, l’Organisation mondiale de la santé définit la santé communautaire dans la Charte d’Ottawa ; l’année suivante, le Secrétariat européen des pratiques de santé communautaire est installé. En Belgique, en 1989, la FMM lance une recherche-action sur le rôle des centres de santé intégrés (CSI) en santé communautaire, puis sur l’éducation en prévention[5].

Aujourd’hui encore, la santé communautaire est mobilisée comme outil collectif et global de la santé, tant du point de vue institutionnel que dans la pratique quotidienne des maisons médicales. Selon Fanny Dubois, « Une maison médicale, c’est une ASBL, donc une structure sans but lucratif dans laquelle un collectif de soignants décide de réfléchir en intelligence collective à un projet de santé pour les patients qui s’inscriront dans leur maison médicale. (…). C’est un peu comme une communauté de patients autour de la maison médicale. Dans ce collectif, l’idée est d’essayer de construire un lien de confiance avec les patients. Quand vous êtes patient, soigné en maison médicale, vous acceptez de vous inscrire à la maison médicale pour justement assurer cette continuité des soins »[6].
Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes !
Edito
Quelle médecine voulons-nous ? Des grands centres hospitaliers? Des médecins généralistes accablés par le travail dans un désert médical? Des soins médicaux réservés à ceux et celles qui ont les moyens de les payer? Il existe des mondes de différence en matière de services à la patientèle, en termes d’approches médicales et humaines et de moyens matériels. Par leurs spécificités, les maisons médicales participent à la démocratisation de la médecine. Elles en repensent l’accès, les approches disciplinaires, les publics, etc., à travers ce numéro, plongez-vous dans leur histoire, avec, au cœur de leurs préoccupations : la santé pour toutes et tous ! Disons-le d’emblée, ce numéro en appelle déjà un autre, qui sera publié en mars 2025 et sera consacré aux expériences de terrain.
Bonne lecture !
Introduction au dossier : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes !
Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)
En Belgique, l’assurance maladie-invalidité obligatoire introduite en décembre 1944 pour les travailleurs et travailleuses salarié.e.s, et étendue par la suite à d’autres catégories de la population, a nettement démocratisé l’accès aux soins de santé. Pourtant, aujourd’hui encore, cet accès reste inégalitaire. Alors que les personnes les plus riches n’ont aucune difficulté à se faire soigner, les personnes aux revenus les plus faibles sont obligées de renoncer à des soins médicaux en raison de leur coût. D’après une étude récemment commanditée par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, « cet écart entre les individus avec les revenus les plus bas et les plus élevés est parmi les plus marqués de l’Union européenne »[1], une situation qui se détériore depuis une dizaine d’années en raison de la paupérisation de la population. Il en résulte que « la population vulnérable, qui a le plus besoin de soins de santé, est aussi la plus exposée aux risques de renoncement ou de report des soins de santé et de dégradation de l’état de santé. »[2] Parmi les obstacles à l’accès aux soins, l’étude pointe les frais médicaux qui, pour différentes raisons (conditions d’assurance, rémunération à l’acte des prestataires de soins, suppléments d’honoraires…), ne sont pas couverts par l’assurance maladie-invalidité et que les patients doivent donc débourser pour se faire soigner. Elle recommande dès lors des mesures pour garantir « l’égalité d’accès aux soins et protéger les patients contre les frais excessifs »[3]. Aujourd’hui, une nouvelle enquête de l’Institut Solidaris (le centre d’études et de sondages de la mutualité socialiste Solidaris) confirme une nouvelle fois les inégalités : 41% des Belges francophones déclarent avoir renoncé à un soin médical en 2024[4].
Le droit à la santé, un droit humain fondamental !
Le droit à la santé est pourtant un droit humain fondamental pour vivre dans la dignité, qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains de 1948, puis repris dans d’autres traités internationaux et dans la Constitution belge (art. 23). L’Organisation mondiale de la santé souligne d’ailleurs que « les pays ont l’obligation légale d’élaborer et de mettre en œuvre des lois et des politiques qui garantissent un accès universel à des services de santé qui soient de qualité et s’attaquent aux causes profondes des disparités en matière de santé, notamment la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination »[5]. Cependant, dans une période de restrictions des financements publics, l’investissement dans les soins de santé est l’objet de tensions récurrentes qui font craindre une nouvelle dégradation des droits à la santé des patients.e.s les plus précarisés. C’est pourquoi la société civile monte aux créneaux pour dénoncer le désinvestissement de l’État, la marchandisation croissante des soins médicaux et le développement d’une médecine à deux vitesses. Elle réclame au contraire une sécurité sociale forte et des soins de qualité, centrés sur les besoins et les droits des patient.e.s, quels que soient leur condition sociale[6].
Les maisons médicales : des expériences innovantes et inspirantes
Cette situation tendue invite à s’interroger sur l’organisation des soins de santé et sur les améliorations possibles. Elle invite aussi à porter le regard sur des initiatives innovantes et inspirantes du passé. Les maisons médicales en font partie. Nées à partir des années 1970, elles s’intègrent dans un mouvement contestataire en réaction à des grèves de médecins qui défendaient leurs intérêts professionnels, mais aussi dans la foulée des idées de Mai 68. Des médecins, des infirmièr.e.s et d’autres prestataires de soins, dénoncent le corporatisme des médecins et les relations de pouvoir qui imprègnent l’exercice de la médecine. Ils rêvent d’une autre médecine, centrée sur les besoins des patient.e.s, avec une attention particulière pour les populations précarisées et vulnérables. Pour soigner efficacement, ils réclament aussi une prise en charge intégrée des malades et la prise en compte de leurs conditions de vie (cadre de vie, situation professionnelle et familiale, (non)accès aux droits). Il s’agit aussi d’associer étroitement les patient.e.s, en tant que sujets, à la construction de soins de santé efficaces, et de renforcer la médecine de première ligne pour en faire à la fois un outil de prévention et de soins, et un lieu d’intégration sociale.
Ces nouvelles orientations mènent à la création de centres de soins dénommés « maisons médicales » qui, chacun à leur manière, essaient de mettre en pratique une médecine de proximité à vocation sociale. À la fin des années 1970, des maisons médicales unissent leurs efforts pour défendre plus efficacement leurs revendications et leur modèle de soins et, en 1980, elles fondent la Fédération des maisons médicales qui luttera sans relâche pour une médecine accessible à tous et à toutes, dans le respect des besoins et des droits des patients. Aujourd’hui, cette Fédération regroupe 133 maisons médicales qui dispensent des soins à environ 300 000 patient.e.s wallons et bruxellois. Toujours agissante, la Fédération défend une médecine alternative à contre-courant de la gestion néo-libérale des soins médicaux.
Le défi de la transmission
Le projet militant des maisons médicales sera au cœur de deux numéros de Dynamiques. Encore trop largement inexploré, le sujet est riche et, comme le dévoilent les archives de la Fédération des maisons médicales confiées au Carhop en 2022, il permet d’envisager des thématiques aussi variées que l’interdisciplinarité des soins, les difficultés particulières de la patientèle (personnes à faibles revenus, femmes, migrant.e.s), l’humanisation des relations entre soignant.e.s et patient.e.s, l’expérience de l’autogestion, la co-construction de projets avec la patientèle, mais aussi les conflits avec les syndicats de médecins, les revendications auprès des autorités publiques et les acquis pour une médecine alternative[7].
Sortir de l’ombre ces initiatives inspirantes répond aussi au souhait de la Fédération des maisons médicales. À l’occasion de la commémoration de ses 40 ans en 2022, Sophie Bodarwé, chargée de projets à la Fédération, soulignait en effet l’importance pour les nouveaux travailleurs et travailleuses des maisons médicales, de connaître l’histoire de ce mouvement. L’histoire sert en effet de « levier de formation »[8] pour faire prendre conscience aux nouveaux travailleurs et travailleuses qu’ils s’inscrivent dans un projet collectif, politique et militant. Elle contribue au « défi de transmission, d’appropriation, défi pour trouver sa place. (…) Se souvenir de ce que les anciens ont mis au cœur de leurs luttes permet une vision à la fois large (le temps dans sa durée) et ciblée (l’objet de la lutte). (…) Gageons que les luttes et les succès actuels seront les normes de demain. »[9]
Au menu de Dynamiques
L’histoire des maisons médicales est riche, et deux numéros de Dynamiques permettront seulement d’en esquisser quelques facettes. Dans ce premier numéro, nous revenons sur la genèse du projet politique des maisons médicales et de leur Fédération, et sur l’importance accordée à la valorisation de leurs archives (car sans archives, pas d’histoire !). Mais comme une histoire gagne toujours à être contextualisée, nous nous attachons aussi à ancrer l’histoire des maisons médicales dans un passé plus ancien, en mettant en exergue le développement depuis le 19e siècle, d’autres initiatives médicales destinées aux populations vulnérables. Le prochain numéro, à paraître en 2025, mettra quant à lui en exergue quelques expériences novatrices des maisons médicales nées à partir des années 1970.
Commençons par les archives. Dans ce présent numéro, Marie-Laurence Dubois et Annette Hendrick nous expliquent la motivation des acteurs et actrices de la Fédération des maisons médicales à sauvegarder l’histoire de leur organisation. Il s’agit en effet de transmettre aux nouvelles générations de travailleurs et travailleuses, la mémoire d’un projet militant et politique. Une transmission qui passe nécessairement par le classement et la préservation des archives disséminées dans les armoires, mais aussi par la collecte des témoignages des acteurs et actrices de terrain. Cet article, qui montre un bel exemple de collaboration entre une association et des historien.ne.s-archivistes, pointe aussi le défi de la conservation des archives pour des associations privées de moyens humains et financiers en suffisance.
Pour ancrer l’accès aux soins médicaux dans la longue histoire, Renée Dresse revient sur le long cheminement qui, du 19e siècle aux années 1960, a mené à une lente (et incomplète) démocratisation des soins de première ligne. Au 19e siècle, dans une société rongée par les mauvaises conditions de travail, la précarité et l’absence de protection sociale, des initiatives existent pour offrir des soins de santé aux plus démunis. Mais, la plupart du temps laissées aux bons soins de l’initiative privée, elles manquent de cohérence et de moyens et elles ne peuvent répondre aux immenses besoins sanitaires. Cependant, à la fin du 19e siècle et durant la première moitié du 20e siècle, le soutien de l’État aux mutualités et à l’assurance maladie-invalidité provoque l’essor inédit de structures médicales professionnalisées qui élargissent incontestablement l’accès aux soins préventifs et curatifs.
Malgré ces améliorations, une large partie de la population peine toujours à se faire soigner, et la philanthropie déploie toujours des efforts pour leur venir en aide. C’est ce que montre Claudine Marissal dans l’Entr’aide des travailleuses, une association catholique fondée en 1925 dans un quartier paupérisé bruxellois. Durant l’entre-deux-guerres, elle met déjà en œuvre différents aspects de la médecine sociale de première ligne qui sera (re)valorisée par les maisons médicales des années 1970. Mais, nés dans un contexte politique et religieux très différent, les deux projets diffèrent profondément sur le plan politique. Pour cette association catholique, les soins de santé répondent en effet à un devoir de charité chrétienne, mais aussi à l’espérance de ramener des masses ouvrières dans le giron de l’Église.
Rien à voir avec le projet médical de Médecine pour le Peuple présenté par Marie-Thérèse Coenen. Cette fois, la motivation est clairement contestataire, voire révolutionnaire. C’est en effet dans la foulée des événements contestataires des années 1960 et de grèves ouvrières, que des médecins communistes décident de fonder des consultations médicales dans des quartiers populaires et ouvriers. Bientôt affiliées au Parti du travail de Belgique (PTB), ces nouvelles maisons médicales « Médecine pour le Peuple » entendent défendre le droit à la santé pour tous et toutes. Telle que pratiquée dans ces maisons médicales, la médecine donne aussi l’occasion de défendre collectivement des travailleurs et travailleuses frappés de maladies professionnelles, de remettre en cause les pratiques de la médecine privée, celles de l’Ordre des médecins et celles des firmes pharmaceutiques. C’est donc une réforme complète du système de soins qui est exigée, une posture qui causera de graves sanctions aux médecins de Médecine pour le Peuple, infligées par l’Ordre des médecins et les tribunaux.
Enfin, pour clore ce numéro consacré aux maisons médicales, Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau reviennent sur l’émergence d’une nouvelle vague des maisons médicales à partir des années 1970, et sur la création de la Fédération des maisons médicales en 1980 pour mutualiser leurs efforts et défendre collectivement leur nouveau modèle de soins auprès des autorités politiques. Ils expliquent les priorités de la Fédération pour renforcer la médecine de première ligne, ses revendications pour le droit à la santé, ses succès (comme le financement au forfait) et les menaces qui guettent. À travers leurs propos, on perçoit aussi la pugnacité d’une initiative qui repose à l’origine sur des investissements bénévoles : il a fallu beaucoup d’efforts pour assurer la reconnaissance et la pérennité de ce modèle alternatif de soins, une lutte rendue encore plus ardue du fait des nombreuses reconfigurations institutionnelles.
Pour en savoir plus
-
- DUBOIS M.-L. et HENDRICK A., Inventaire des archives de la Fédération des maisons médicales et collectives de santé francophone (1966-2022), FMM, 2022.
-
- FETTUCCI D., « Parcours d’une intégration », Magazine C4, Le magazine qui nous pend au nez, 30 octobre 2017, https://c4magazine.org/category/mag/n230-numero-double-2017.
-
- HENDRICK A. et MOREAU J.-L., De A à Z : histoire(s) du mouvement des maisons médicales, FMM, 2022, https://www.maisonmedicale.org/wp-content/uploads/2022/02/abecedaire-version-web-20200217.pdf.
-
- MORMONT M. et ROLAND M., « Maisons médicales, semailles et germinations », Politiques, n° 101, septembre 2017, p. 28-37.
-
- Santé conjuguée, revue de la Fédération des maisons médicales, n° spécial consacré aux 40 ans de l’association, n°98, mars 2022, https://www.maisonmedicale.org/wp-content/uploads/2023/07/SC-98-complet-ok-2.pdf.
Notes
[1] BAETEN R., CÉS S., Les inégalités d’accès aux soins de santé en Belgique. Rapport de synthèse, Bruxelles, Observatoire social européen, 2020, p. 4, https://www.ose.be/sites/default/files/publications/2020_SC_RB_NIHDI-Report_Synthese_FR_0.pdf
[2] Ibidem, p. 26.
[3] Ibidem, p. 27.
[4] Institut Solidaris, « Renoncement aux soins pour des raisons financières, Solidaris, édition 2024 », 2024, https://www.institut-solidaris.be/wp-content/uploads/2024/12/Report-de-soins-2024-VF.pdf, page consultée le 17 décembre 2024.
[5] « Droits humains », site web de l’Organisation mondiale de la Santé, 1er décembre 2023, https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health, page consultée le 12 décembre 2024.
[6] Ces revendications ont fait l’objet de différents plaidoyers pour les élections de 2024. Parmi eux, citons celui de la Ligue des usagers des soins de santé (LUSS), qui fédère des dizaines d’associations de patient.e.s : « Mémorandum 2024 », https://www.luss.be/memorandum2024/ et « Accès à des soins de qualité en péril : la LUSS est inquiète ! », mars 2023, https://www.luss.be/wp-content/uploads/2023/03/202303-lacces-a-des-soins-de-qualite-en-peril.pdf, et celui de la Fédération des maisons médicales, Mémorandum 2023. Enjeux locaux, régionaux, fédéraux, européens, 2023, https://www.maisonmedicale.org/wp-content/uploads/2023/10/memorandum-elections-2024-Federation-des-maisons-medicales.pdf, consultés le 16 décembre 2024.
[7] DUBOIS M.-L. et HENDRICK A., Inventaire des archives de la Fédération des maisons médicales et collectives de santé francophone (1966-2022), FMM, 2022.
[8] Sophie Bodarwé, « L’Histoire, un levier de formation », Santé conjuguée, n° 98, mars 2022, p. 19-20.
[9] Ibidem, p. 20.
Pour citer cet article
MARISSAL C. « Introduction au dossier : Les maisons médicales : le droit à la santé pour tous et toutes ! », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 25 : Les maisons médicales, le droit à la santé pour tous et toutes !, décembre 2024, mis en ligne le 18 décembre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/.
Préserver l’histoire d’initiatives inspirantes : conserver les archives de la Fédération des Maisons médicales
Marie-Laurence Dubois, consultante en gouvernance de l’information et archiviste (Valorescence)
Annette Hendrick, archiviste et historienne indépendante (ORAM)
Du témoignage à l’histoire en passant par les archives
Il est fascinant, pour qui se penche sur l’histoire de la Fédération des maisons médicales (FMM)[1], de voir avec quelle vigilance les témoignages de ses acteurs et actrices sont très tôt précieusement recueillis. Il n’est pas un congrès, pas un colloque ou un anniversaire où l’on n’évoque les moments forts du mouvement. On y fait parler les « ancien.ne.s ». Démarche didactique : il s’agit de mobiliser les plus jeunes, de les enraciner dans une histoire très riche et de les encourager à s’approprier des valeurs sans cesse réactualisées.
Depuis longtemps, différentes initiatives sont prises aussi pour tenter d’écrire l’histoire de la Fédération. Cependant, pour qui veut passer du simple témoignage à l’histoire, il y a un saut qualitatif à franchir. L’histoire repose sur une analyse critique de sources primaires (les archives) et la mise en œuvre de ces sources dans le cadre d’une synthèse qui inscrirait le mouvement des maisons médicales dans un contexte politique, social, économique et médical.

Pas d’histoire, donc, sans archives. Conscient.e.s de ce fait, Corinne Nicaise, responsable communication de la Fédération, et Mourad Benmerzouk, documentaliste, ont progressivement rassemblé les archives confiées par des collègues, fondateurs et fondatrices et ancien.ne.s travailleurs et travailleuses. Ils prennent néanmoins conscience qu’à moyen ou long terme, ces documents peuvent disparaître, que ce soit à l’occasion de travaux, déménagement, changement de direction, etc. Certain.e.s au sein de la Fédération, prônant une politique « zéro papier », sont enclins à faire place nette, quitte à numériser quelques séries. Or, généralement, la numérisation porte non tant sur les archives proprement dites que sur les séries de publications, alors que celles-ci sont plus faciles à trouver en bibliothèque.
Ceci fait ressortir l’importance de la démarche entreprise en 2018 à l’initiative essentiellement de Corinne Nicaise. À l’automne 2018, celle-ci prend contact avec Marie-Laurence Dubois (Valorescence, spécialisée en gouvernance de l’information et archivage) et lui fait part du souhait de la Fédération de s’occuper enfin des nombreux classeurs et documents accumulés au fil des années dans ses bureaux, sis boulevard du Midi à Bruxelles. L’objectif est de trier et d’organiser ces archives pour en assurer une préservation à long terme et, surtout, leur redonner vie.
Cette démarche répond à deux motivations distinctes. La première est d’ordre pédagogique : il faut transmettre l’histoire de la Fédération à ses nouveaux travailleurs et travailleuses, dont le nombre augmente. Beaucoup, né.e.s dans les années 1990, comprennent mal le fonctionnement des maisons médicales car ils et elles ignorent par exemple à quel point le bagage génétique des maisons médicales est marqué par les évènements de mai 68, par le rejet de l’hospitalocentrisme et par l’idéal de type communautaire qui s’exprime par la médecine de groupe. Ils et elles ignorent aussi à quel point la mise en place du paiement au forfait en 1982 représente une rupture par rapport au système du paiement à l’acte. Conserver et organiser les archives permet de préserver la mémoire collective, d’expliquer les valeurs et les choix historiques qui ont façonné la structure actuelle des maisons médicales.
D’un autre côté, plusieurs membres fondateurs désirent que le 40e anniversaire de la Fédération, en 2021, soit l’occasion d’une rétrospective plus globale sur son histoire. Un groupe de travail est d’ailleurs mis en place pour l’écrire. Ce projet est aujourd’hui partiellement atteint. Le 40e anniversaire est donc une nouvelle occasion de faire parler un grand nombre d’acteurs et d’actrices du mouvement. Pas moins de 20 podcasts et un numéro spécial de Santé conjuguée sont consacrés à ce travail de mémoire. En outre, une brochure historique et didactique est rédigée par deux historien.ne.s, Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau, et publiée en janvier 2022. Ce sont là des matériaux intéressants pour celles et ceux qui veulent accéder à l’histoire de la Fédération.
Quant au projet « archives », il aboutit par le versement au Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP). Dans ce centre d’archives privées reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les archives sont conservées dans de bonnes conditions et accessibles à tou.te.s.

Des soins de santé pour tous et toutes : un projet qui s’ancre dans la longue Histoire
Renée Dresse (historienne, CARHOP asbl)
Au Moyen Âge, l’entraide familiale, la bienfaisance venant du riche ou des congrégations religieuses, constituent le cœur de l’aide apportée aux malades, invalides et pauvres valides. Puis, les autorités publiques, voulant briser le monopole de l’Église dans ce domaine, complètent ces initiatives avec l’instauration d’institutions locales.
Au 19e siècle, l’insécurité des milieux de travail, les horaires de travail trop lourds (10 à 12 heures en moyenne de travail par jour), la cadence imposée par le patron, la faiblesse salariale qui ne permet pas une alimentation correcte, le manque d’hygiène des lieux de vie, sont autant de facteurs qui nuisent à la santé des familles ouvrières. Des initiatives pour leur venir en aide se multiplient. Le secteur privé, via des associations et l’action de particuliers, reste très présent. Certaines bénéficient dès la fin du 19e siècle d’une contribution des pouvoirs publics locaux et provinciaux. De son côté, l’État, pressé par le mouvement ouvrier, instaure peu à peu un système de solidarité qui va répondre à une grande partie des besoins en matière de santé de la population.
L’initiative privée
Au 19e siècle, aucune loi ne protège l’ouvrier et sa famille face aux aléas de la vie. L’industrie rend malade, blesse, tue. Des recours existent : les uns relèvent de la bienfaisance, les autres d’un système d’assurances précaire, la société de secours mutuels.
La bienfaisance privée
Au 19e siècle, des lieux, gérés principalement par des congrégations religieuses et/ou des hommes et femmes d’œuvres, procurent les soins nécessaires aux malades ou victimes d’accident. Ainsi, l’œuvre du Calvaire, fondée en France en 1842, s’étend en Belgique à la fin du siècle grâce à un jésuite, le père Adolphe Petit. Il y a d’abord un hospice pour femmes qui ouvre ses portes à Bruxelles le 8 décembre 1886. Appelé également le château des pauvres, il dispose de 40 lits « où l’on reçoit des pauvres cancéreuses dont on console et sanctifie la fin, si l’on ne peut aider à les guérir, et des malheureuses, défigurées par le lupus, qui viennent chercher là de l’occupation et un milieu sociable que le monde refuse à leur repoussante laideur »[1]. Ces malades sont suivies par des médecins et entourées par des « Dames, veuves » qui apportent un réconfort religieux et/ou des soins aux malades. « Sous elles, des filles auxiliaires, dont plusieurs sont cancéreuses guéries, les assistent gratuitement, font les travaux de ménage. »[2] Par la suite, cette institution centrale met en place des dispensaires en d’autres endroits de Bruxelles et aussi à Gand (1896), Liège et Seraing (1901). Ce sont des locaux, équipés d’appareils, qui accueillent trois fois par semaine des femmes malades pauvres. Elles y bénéficient des soins de médecins et de « Dames » ou « Demoiselles ».
Certains patrons ne sont pas en reste : ils installent dans leur usine, à l’intention de leurs ouvriers, un dispensaire leur fournissant les premiers soins en cas d’accident ou de malaise. La société, Les Charbonnages de Mariemont-Bascoup à Morlanwelz, organise pour ses ouvriers actifs ou non (plus âgés) et leur famille, un service sanitaire en échange d’une cotisation. Les anciens ouvriers invalides, pensionnés ou non, les veuves et les enfants des ouvriers décédés sont exempt.e.s de cotisation. Ce service leur permet de bénéficier des soins des médecins des charbonnages, y compris à domicile, de se fournir en médicaments auprès de pharmaciens, et de recevoir un équipement spécial comme une jambe de bois, des yeux artificiels, etc.[3]
Certaines associations s’intéressent aussi à l’enfance souffrante. C’est le cas de l’infirmerie Sainte-Élisabeth établie à Verviers en 1879 : « Le but est d’y soigner gratuitement les maladies aiguës des enfants pauvres du sexe féminin (restriction provisoire, j’espère[4]) et un certain nombre d’affections chroniques »[5].
Les sociétés ou caisses de secours mutuels
Le rôle de ces caisses de prévoyance doit permettre aux ouvriers de se prémunir contre les risques encourus (maladie, accident, décès mais aussi vieillesse). Essentiellement d’origine privée, ce sont des organisations héritées des anciennes corporations où les membres d’une même profession s’entraidaient.
Ces sociétés sont créées par des hommes d’œuvres dans les paroisses et non loin des milieux industriels. Certains patrons proposent également à leurs ouvriers leur propre société de secours. C’est le cas de l’usine L.A. Legrand à Vilvorde qui fournit, via sa société de secours mutuels, les secours médicaux et pharmaceutiques ainsi qu’une indemnité salariale, ou encore la Caisse de secours de la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne à Angleur qui donne gratuitement les soins nécessaires aux ouvriers malades ou accidentés et les étend aux membres de leur famille habitant sous le même toit.
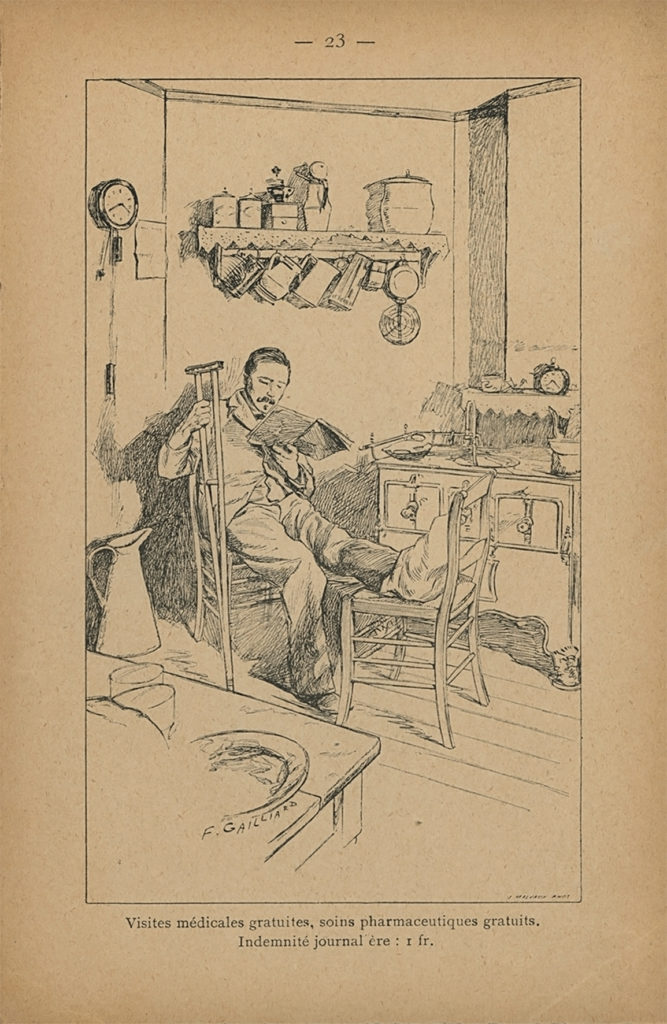
Soigner pour évangéliser ? L‘Entr’aide des travailleuses (1925-années 1960)
Claudine Marissal (historienne, CARHOP asbl)
Introduction
Dans les années 1970, et dans le vivifiant sillage des mouvements contestataires des années 1960, des médecins se mobilisent pour améliorer l’accès aux soins médicaux. Ils interrogent les hiérarchies du passé et entendent fonder un nouveau modèle de soins, plus accessible et plus démocratique. S’inspirant d’initiatives d’autres pays, ils fondent des maisons médicales qui offrent une médecine de première ligne en phase avec l’environnement social de leur patientèle. Pour éviter l’éclatement des soins, ces maisons rassemblent des professionnel.le.s de différentes disciplines (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux…) qui se concertent pour mieux soigner. En plus de consultations médicales, elles proposent aussi à leurs patient.e.s des actions de médecine préventive et des activités socio-culturelles pour renforcer leurs capacités d’autonomie. Ce faisant, ces médecins réfléchissent et innovent sans se référer aux centres médico-sociaux plus anciens qui, dans un contexte très différent, il est vrai, en étaient venus à développer des activités similaires.
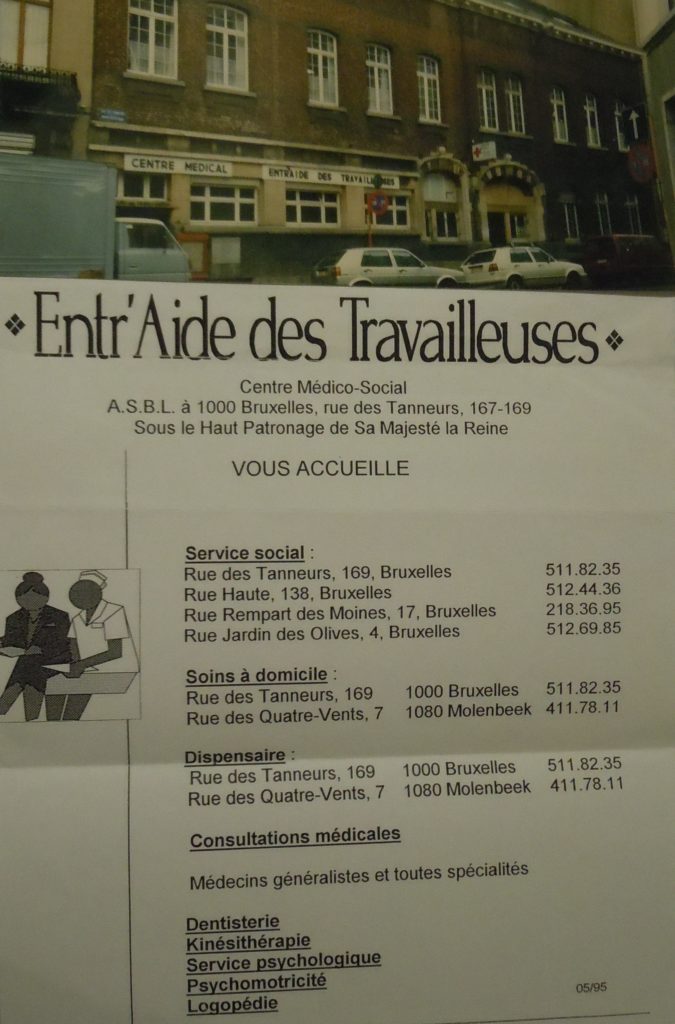
C’est l’une de ces initiatives plus anciennes que nous mettons en lumière dans cette présente contribution, à travers l’histoire de l’Entr’aide des travailleuses (Entr’aide des Marolles depuis 2004). Fondée en 1925 dans un quartier paupérisé du centre de Bruxelles, cette association a mis sur pied un centre de santé qui a rapidement fourni des soins médicaux gratuits à des milliers de familles précarisées. Initiée dans le contexte politique, social et religieux de l’entre-deux-guerres, l’Entr’aide diffère par son origine, son essence et ses réseaux des maisons médicales créées dans les années 1970. Et pourtant, des points communs se dessinent. Les histoires finissent d’ailleurs par se rencontrer puisqu’en 2011, les services médicaux de l’Entr’aide sont reconnus en tant que « maison médicale ». Cette association offre donc la belle opportunité d’ancrer la philosophie des maisons médicales dans un passé plus ancien.
Les archives conservées au siège de l’association, qui nourrissent cet article[1], permettent différentes approches. Pour favoriser les comparaisons avec la « nouvelle vague » de maisons médicales, nous avons choisi d’investiguer les relations que l’Entr’aide a tissées avec ses bénéficiaires. Pourquoi s’est-elle s’implanter dans un quartier précarisé ? Quelles représentations avait-elle de ses patient.e.s ? Quels services leur a-t-elle offerts et pour quelles finalités ? Quel personnel soignant a-t-elle mobilisé et comment s’est-il organisé pour mieux soigner ? Mais avant de plonger dans l’histoire de cette association, il convient de revenir brièvement sur le contexte socio-politique de l’entre-deux-guerres, un contexte évidemment très différent de celui des années 1970, et qui a assurément façonné son organisation et ses priorités.
La foi dans la charité chrétienne
Au tournant du 19e siècle, les profondes inégalités sociales avaient provoqué de violents conflits sociaux et de nombreux débats sur leur résolution. Alors que les socialistes dénonçaient avec véhémence l’exploitation capitaliste et exigeaient l’intervention de l’État et l’adoption de législations sociales pour protéger les travailleurs et travailleuses (notamment pour ce qui concerne les soins de santé), les catholiques et les libéraux restaient divisés : beaucoup comptaient encore sur la moralisation de la classe ouvrière et sur la charité pour traiter la misère et pacifier les relations sociales[2]. Souvent d’obédience chrétienne, de multiples œuvres couvraient alors le pays, qui distribuaient des aides ponctuelles tout en exerçant un contrôle moral et religieux sur les populations précarisées et potentiellement dangereuses[3].
Le vote des premières lois sociales à la fin du 19e siècle et leur multiplication durant l’entre-deux-guerres, ne modifient pas fondamentalement l’engouement pour les œuvres charitables. Traversés par d’influents courants progressistes, les catholiques appuient à présent les législations protectrices, mais comme ils continuent à redouter l’emprise de l’État sur les politiques sociales, ils adoptent des réformes qui prennent appui sur des organismes privés et confessionnels. Les œuvres catholiques trouvent d’ailleurs une nouvelle vitalité dans le vaste mouvement d’Action catholique initié en 1922 par le Pape Pie XI, qui appelle les laïcs à se mobiliser sous la supervision du clergé pour (re)christianiser une société jugée en perte de repères religieux. En 1928 à Bâle, la Conférence internationale des œuvres catholiques de bienfaisance invite à stimuler dans chaque pays le développement et le regroupement des œuvres médico-sociales catholiques pour faire barrage aux organisations socialistes et non confessionnelles. Pour y répondre, l’Office catholique d’hygiène, d’assistance et de service social (Caritas Catholica) est alors fondé en Belgique et placé sous l’autorité de l’Archevêché de Malines[4]. C’est dans ce contexte que l’Entr’aide des travailleuses voit le jour.
Soigner pour rapprocher du Bon Dieu
En 1925, une jeune noble âgée de 24 ans, Marie-Thérèse Robyns de Schneidauer, réunit autour d’elle quelques jeunes femmes qu’elle a rencontrées à l’Œuvre des retraites fermées pour travailleuses, une initiative bruxelloise qui émane de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF). Fondée en 1924 par l’abbé Joseph Cardijn, la Fédération bruxelloise de la JOCF encourage ses membres à visiter les familles ouvrières pour s’enquérir de leurs problèmes, de leurs besoins et de leurs inquiétudes[5]. C’est dans cette voie que Marie-Thérèse Robyns de Schneidauer et ses amies s’engagent, quand elles décident de visiter « des pauvres, des malades, des vieux particulièrement (…) pour leur porter un sourire d’amitié, leur porter surtout quelque chose du Bon Dieu »[6]. Elles se dénomment d’ailleurs « Association des Âmes Apôtres », avant d’adopter l’appellation jugée plus consensuelle d’Entr’aide des travailleuses. L’objectif est clairement apostolique, car les visites qu’elles projettent doivent servir à propager la foi chrétienne dans le quartier des Marolles, un quartier miséreux situé dans le centre de Bruxelles, en contrebas du Palais de Justice, et dont les ruelles surpeuplées abritent une population ouvrière revendicative et encline aux rébellions sociales.
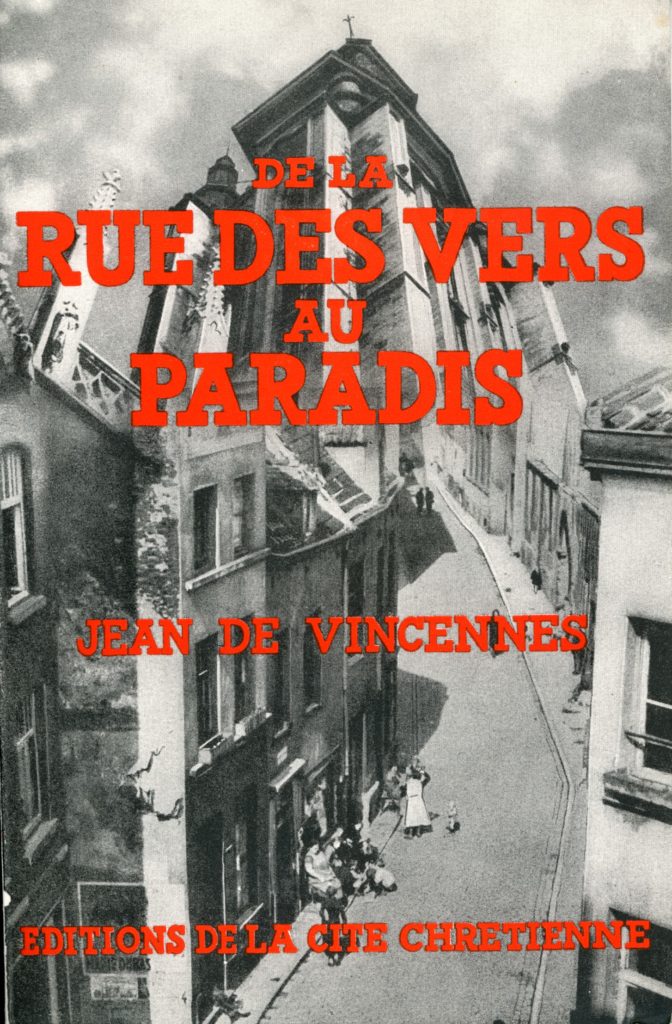
Médecine pour le Peuple : des maisons médicales luttent pour le droit à la santé
Marie-Thérèse Coenen (historienne, CARHOP asbl)

Dans le paysage de la médecine de première ligne, les maisons médicales de Médecine pour le Peuple occupent une place particulière. Pionnier dans la création des centres de santé de proximité, ce réseau coordonne aujourd’hui 11 maisons médicales multidisciplinaires, toutes affiliées au Parti du travail de Belgique (PTB-PvdA). Une appartenance politique qui ne ferme cependant la porte à aucun.e patient.e : comme le soulignent deux militantes interviewées pour cet article[1], « nous ne cachons pas nos engagements politiques, ni nos combats, mais nos maisons sont ouvertes et chacun.e reste libre d’adhérer ou non »[2]. Les 11 maisons médicales se situent en Flandre (Hoboken, Zelzate, Genk, Deurne, Lommel), en Wallonie (Marcinelle, Herstal, La Louvière, Seraing) et dans la Région de Bruxelles-Capitale (Schaerbeek et Molenbeek). Des médecins, des infirmier.e.s et du personnel d’accueil forment l’équipe de base, rejoints en fonction des besoins locaux par des kinésithérapeutes, psychologues, diététicien.ne.s et assistant.e.s social.e.s. Médecine pour le Peuple regroupe aujourd’hui quelque 220 salariés, des bénévoles et environ 25 000 patient.e.s. Tous et toutes constituent la force de Médecine pour le Peuple et se sont mobilisé.e.s à de nombreuses reprises pour défendre ses médecins et son modèle de santé pour tous et toutes.
Hoboken en 1971 : ici on soigne « gratis »
L’origine de Médecine pour le Peuple remonte au 7 février 1971, lorsque Kris Merckx et Michel Leyers ouvrent leur premier cabinet médical à Hoboken, une commune ouvrière située près d’Anvers (aujourd’hui un district d’Anvers)[3]. Kris Merckx est un militant communiste. Pendant ses études de médecine à l’Université catholique de Louvain (1962-1968), il a milité pour la scission de l’université : une université pour les Flamands à Leuven, une pour les Francophones en Wallonie. Délégué des étudiants en médecine, puis pour l’ensemble des facultés, il a rejoint le syndicat étudiant marxiste, le Studentenvakbeweging (SVB) créé au printemps 1967. Ce syndicat fait évoluer politiquement la contestation étudiante vers une réforme fondamentale de l’université (participation, démocratisation, réforme des programmes) et milite pour l’ouverture de l’université à toutes les classes sociales, car il s’agit aussi de rapprocher l’université du peuple. En 1968, le SVB décide de sortir des auditoires pour aller vers la classe ouvrière.
Kris Merckx est diplômé en juin 1968, mais il poursuit une spécialisation en médecine interne et reste mobilisé sur différents fronts des luttes ouvrières : les grèves des mineurs du Limbourg (1968 et 1970), celles de Ford-Genk (1968) et Michelin (1969) ainsi que les longues grèves du textile à Gand et des chantiers navals de Cockerill Yards à Hoboken (4 mois en 1970). Présent sur les piquets dans le Limbourg et à Hoboken, Kris Merckx soigne gratuitement des mineurs grévistes et leurs familles. Quand en septembre 1970, le SVB se mue en parti politique d’extrême-gauche « Alle macht aan de arbeiders – Tout le pouvoir aux ouvriers » (AMADA-TPO), Kris Merckx fait partie des fondateurs[4].
De médecins à vocation sociale à Médecine pour le Peuple
C’est à Hoboken que quelques mois plus tard en octobre 1971, Kris Merckx choisit d’ouvrir un cabinet médical avec Michel Leyers (qui vient d’être diplômé médecin). Ce lieu n’est pas fortuit. C’est en effet à Hoboken que le délégué syndical des chantiers navals, Jean Saeys, avait attiré l’attention de Kris Merckx sur la maladie des brûleurs qui frappait ces ouvriers exposés aux vapeurs toxiques d’oxyde de zinc. Kris Merckx constate lui aussi les maladies des ouvriers, auxquelles il donne une dimension politique : à l’évidence, « le capitalisme rend malade. Sa loi est celle du profit maximal, la sécurité et la santé des travailleurs est seconde »[5]. L’observation des problèmes sanitaires amorce un travail de recherche pour en définir les causes. L’action politique suit : la dénonciation des conditions de travail, la reconnaissance comme maladie professionnelle et l’obligation pour l’entreprise de prendre en charge les victimes et d’installer des équipements de prévention.
Le délégué syndical Jean Saeys propose alors de rendre pérenne cette « médecine pour le Peuple » et, forts de ce soutien, Kris Merckx et Michel Leyers ouvrent leur cabinet médical « Médecins pour le Peuple ». Les familles ouvrières affluent : le tarif de la consultation correspond au montant INAMI qui est remboursé par la mutuelle, et le patient fait l’économie du ticket modérateur (supplément à charge du patient, que le médecin doit en principe lui réclamer)[6]. Ce n’est pas une médecine « gratuite », mais un acte médical au tarif INAMI, suivant le principe que les travailleurs cotisent à la sécurité sociale et que rien ne justifie de les faire contribuer davantage à leur santé. Ce n’est pas non plus une médecine « au rabais » : chaque consultation dure 20 minutes et plus si nécessaire. Innovante à plus d’un titre, l’approche du patient est aussi globale et politique. Bien avant le dossier médical global[7], les deux médecins établissent des fiches médicales par patient, ce qui leur permet de faire sur le temps long le suivi des pathologies et des protocoles de soin, mais aussi de repérer les récurrences. Parmi leur patientèle, ils observent sur des femmes migrantes, une ablation systématique de la vésicule, sans qu’elles puissent en expliquer les raisons. Ils dénoncent cette pratique d’interventions « inutiles » remboursés par l’INAMI et ils en tirent une conclusion mobilisatrice : « les soins de santé sont malades du capitalisme et de l’appât du gain »[8]. Au sein de leur patientèle ouvrière, ils constatent certaines pathologies surreprésentées et font le lien avec les conditions de vie, l’environnement et les effets de la pollution sur le développement des maladies, ce qu’ils dénoncent : vivre en bonne santé dans un environnement sain est un droit qui réclame une action politique.
L’initiative est un succès et, avec le soutien de syndicalistes et de patients, l’équipe s’étoffe et le cabinet devient maison médicale. Elle devient aussi un modèle à suivre : dans les années qui suivent, d’autres médecins d’AMADA-TPO décident à leur tour d’ouvrir des maisons médicale Médecine pour le Peuple.
Le Parti prend le relais
Au congrès d’octobre 1979, AMADA-TPO devient le Parti du travail de Belgique– Partij van de arbeid van België (PTB-PvdA). Le Congrès adopte ses lignes fondamentales et définit sa stratégie d’action. Un réseau de maisons médicales Médecine pour le Peuple est désormais coordonné par le Parti qui en assure le développement et porte ses revendications : la gratuité des soins de santé et des médicaments, la création d’un service national de santé avec des médecins salariés, la nationalisation de l’industrie pharmaceutique[9]. Le Parti met aussi à l’agenda politique des problématiques qui émergent des soins de première ligne, une pratique qui reste d’ailleurs toujours d’actualité : en 2024, Médecine pour le Peuple mène une enquête sur les troubles musculosquelettiques dans le secteur des titres-services, tandis que les député.e.s PTB dans les différents parlements appellent à l’élargissement de la reconnaissance de maladies professionnelles.

Esquisse historique de la Fédération des maisons médicales
PDF
Annette Hendrick (archiviste et historienne indépendante (ORAM))
Jean-Louis Moreau (archiviste et historien indépendant (ORAM))
Les antécédents (1964-1979)
Bien que née en 1980-1981, la Fédération des maisons médicales a des racines plus anciennes, qui plongent jusqu’aux années 1960 et plus précisément jusqu’à la grève des médecins de 1964.[1] Au lendemain de cet événement dramatique, un groupe de médecins, dont beaucoup travaillent dans de grands hôpitaux, s’insurgent contre le caractère corporatiste du mouvement dans lequel leurs Chambres syndicales les ont entraînés malgré eux. Ce groupe dénonce pêle-mêle : l’incohérence de la politique de santé en Belgique, la dévalorisation du rôle du médecin généraliste, la formation hospitalo-centriste des soignant.e.s, l’absence d’un système d’échelonnement des soins, la pauvreté de la médecine préventive, etc. De tendances philosophiques et politiques diverses – mais avec une nette tendance à gauche – il constitue une plateforme de réflexion, le GERM : Groupe d’étude pour une réforme de la médecine. À travers les Cahiers du GERM et d’autres publications, le groupe de médecins dresse un tableau des réformes du système de santé à entreprendre selon eux en Belgique. Les lignes de force de ce programme restent aujourd’hui pour une large part celles de la Fédération.
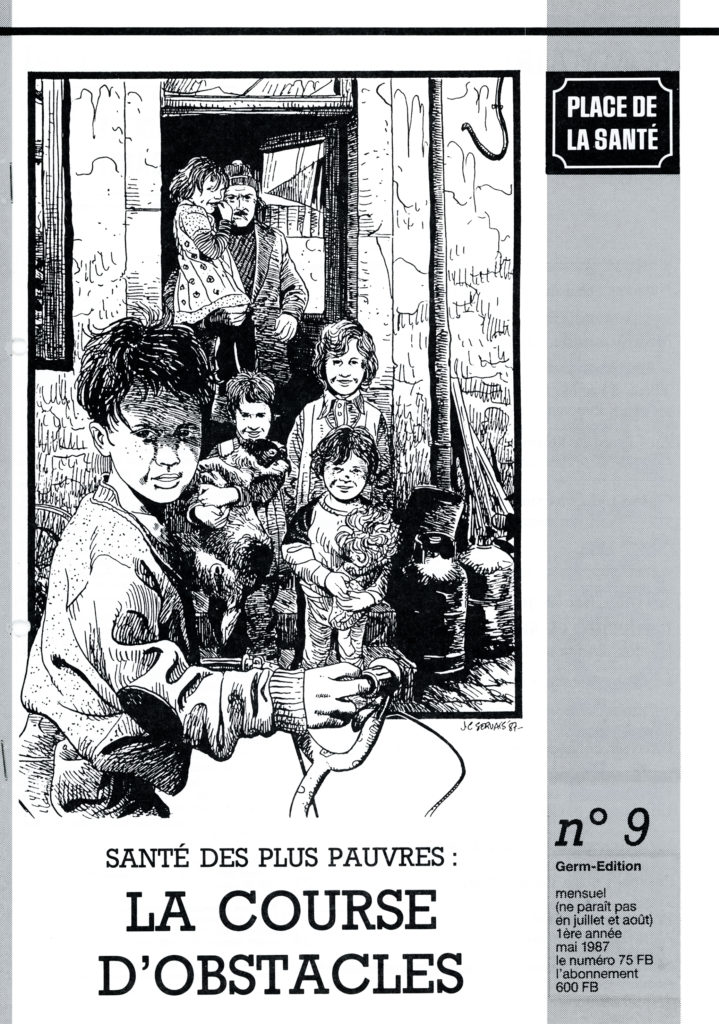
Parallèlement aux travaux du GERM, les premières maisons médicales sont fondées à partir de 1972 en réaction à une médecine technocratique et libérale et dans la foulée des événements de mai 1968. Elles réunissent des équipes interdisciplinaires de soignant.e.s de première ligne (médecins, infirmier.e.s, kinésithérapeutes), s’appuyant le cas échéant sur les compétences de psychologues, accueillant.e.s, assistant.e.s sociaux… Ces équipes fonctionnent en autogestion, sur un mode non hiérarchique. Influencées par les idées du GERM, elles entendent prodiguer des soins accessibles à tou.te.s, des soins continus (suivi des patient.e.s sur le long terme), des soins intégrés (qui mettent l’accent sur la prévention) et des soins globaux (en s’intéressant non seulement au somatique mais aussi au cadre de vie des patient.e.s, à leurs activités, à leur situation professionnelle, sociale, familiale).
Ces premières initiatives sont spontanées et non coordonnées, elles se concentrent essentiellement dans les centres urbains de Bruxelles, Liège et Charleroi. La plupart des maisons médicales (mais pas toutes) desservent des quartiers populaires. Elles revendiquent « la socialisation de la santé au lieu de la médicalisation de la société ». À la fin des années 1970, il existe une trentaine de maisons médicales.
La grève des médecins orchestrée par l’ABSyM[2] en 1979 semble avoir joué le rôle de catalyseur pour une structuration du mouvement des maisons médicales : celles-ci contribuent à briser la grève qu’elles jugent corporatiste et motivée essentiellement par l’appât du gain. Après un an de réflexion, une Fédération des maisons médicales est organisée en association sans but lucratif lors de l’assemblée générale de septembre 1980.
Le temps des utopistes (1980-1989)
La Fédération compte une trentaine de membres à sa fondation ; 35 en 1983 ; 40 en 1988 ; et 44 en 1990. Chaque année, ce sont donc une ou deux maisons médicales supplémentaires qui s’affilient durant cette période. Le groupe bruxellois est le plus important (17 équipes sur 35 en 1983, 20 sur 40 en 1988). Vient ensuite, par ordre d’importance, le groupe de Charleroi, avec une douzaine de maisons. Le groupe liégeois compte une demi-douzaine d’équipes en 1988. Et les maisons médicales de Tournai et Barvaux sont un peu isolées sur cet échiquier. Le nombre de travailleurs et travailleuses en maison médicale est évalué à quelque 220 en 1988, dont une centaine de médecins.
Faute de moyens, les premières années de la Fédération sont laborieuses : elle ne dispose d’aucun.e permanent.e, toute son action repose sur le bénévolat. De plus, sa tâche comme relais des maisons médicales vers la politique est compliquée par la deuxième réforme de l’État qui confirme que l’Assurance maladie-invalidité reste une matière fédérale mais que certaines compétences comme la prévention, l’agrément des hôpitaux et l’octroi de subventions à des structures de soins sont confiées aux Communautés. La coordination des politiques de la Fédération devient particulièrement compliquée lorsque les différents niveaux de pouvoir présentent des majorités asymétriques.
Disposant de peu de moyens propres, la Fédération peut néanmoins compter sur l’appui du GERM. Celui-ci contribue à la maturation du modèle du centre de santé intégré dont s’inspirent toujours les maisons médicales. Les permanent.e.s du GERM soutiennent les recherches-actions de la Fédération entre sa création en 1980 et la dissolution du GERM en 1994.
Sur le plan politique, la Fédération réussit à cette époque deux coups de maître : la reconnaissance du financement des soins au forfait et l’octroi de subsides aux Centres de santé intégrés (CSI).
Le financement au forfait (dit aussi à l’abonnement), organisé en 1982 par l’INAMI, est une des victoires les plus significatives des maisons médicales sur la médecine libérale. C’est à la demande de la Fédération et avec l’appui des mutuelles, des syndicats et du Groupement belge des omnipraticiens (GBO) que l’INAMI met en place le système. Celui-ci se base sur un contrat qui lie une maison médicale, un.e patient.e et sa mutuelle. Cette dernière verse un forfait mensuel à la maison médicale pour financer les soins de chaque patient.e inscrit.e. Les patient.e.s ne déboursent rien (sinon parfois un droit minime d’inscription). Le montant du forfait versé pour chaque patient.e inscrit.e en maison médicale est calculé en fonction de la moyenne nationale de consommation de soins.
Bien sûr, la formule du forfait a ses limites : seules les prestations couvertes par l’INAMI dans le système à l’acte sont concernées, soit celles des médecins, kinésithérapeutes et infirmier.e.s. La prise en charge psychosociale de l’abonné.e n’est pas couverte. Le système est donc boiteux par rapport au projet de médecine globale et intégrée voulu par les maisons médicales. Tel quel, il a cependant représenté un pas important pour améliorer l’accès aux soins (les patient.e.s ne doivent plus avancer l’argent des consultations). L’inscription des patient.e.s facilite aussi leur suivi individuel. À l’échelle du territoire desservi par la maison médicale, il rend possible des études épidémiologiques et stimule les démarches de prévention (les soignant.e.s ont intérêt à ce que la population qu’ils et elles soignent reste en bonne santé – cela leur coutera moins d’efforts).
Il y a malheureusement un frein à l’adoption du forfait : son montant est si bas que les maisons médicales rechignent à adopter le système. De ce fait, celles qui s’y engagent (à partir de 1984) rencontrent de grosses difficultés financières.
Au niveau de la Communauté française, la Fédération obtient en 1983 l’octroi de subsides aux « Centres de santé intégrés » (CSI) de première ligne, animés par des équipes interdisciplinaires. En 1986, la Fédération organise d’ailleurs son premier congrès sur ce thème : Le CSI, base d’une politique de santé. Cinq délégations étrangères y participent. Le financement des Centres de santé intégrés est toutefois remis en cause en 1986-1987 suite à un changement de majorité politique.
La nécessité de définir plus ou moins strictement le modèle de CSI que reconnaîtrait la Communauté française, suscite des conflits entre différentes tendances qui coexistent au sein de la Fédération. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point sur lequel il y a des divergences. La nécessité d’un texte programmatique se fait cruellement sentir. En 1989, un premier essai est rédigé, intitulé Plateforme pour la Fédération des maisons médicales, qui ramasse en une page la conception de la politique de santé défendue par la Fédération. Ce texte liste aussi les fonctions que doit assumer l’équipe pluridisciplinaire d’un CSI. Il ne s’impose pas comme un modèle rigide, mais doit permettre l’évaluation de chaque maison médicale par rapport à un idéal.
La reconnaissance d’un modèle (1989-1997)
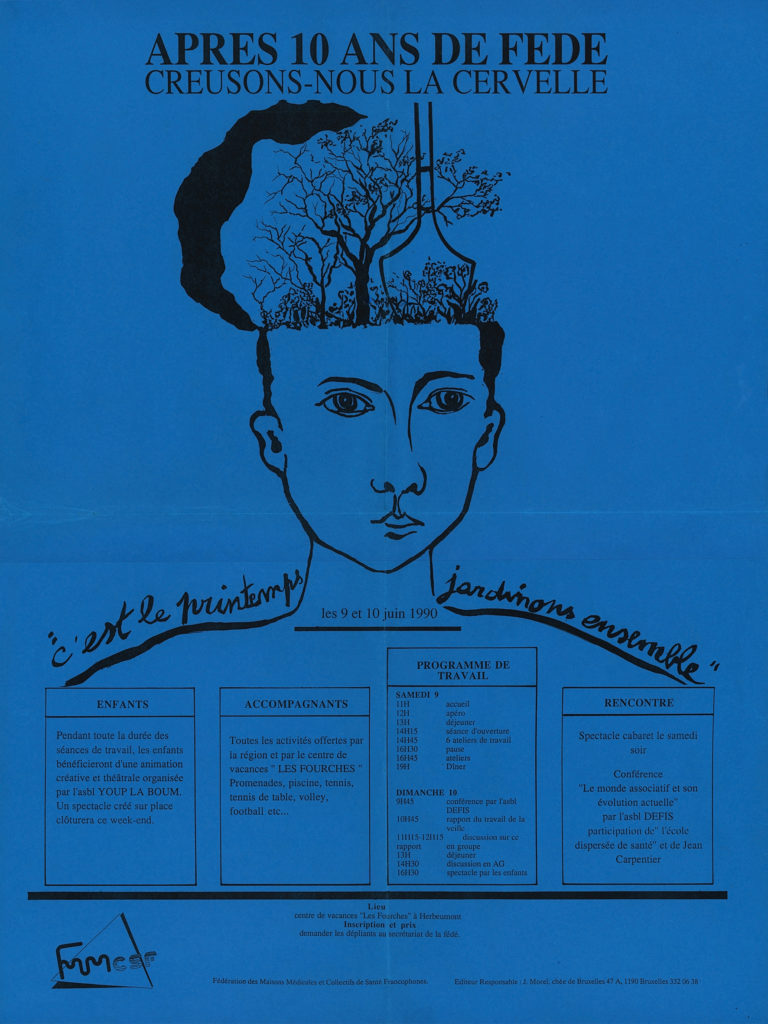
Continuer la lecture de « Esquisse historique de la Fédération des maisons médicales »
Lire pour lier!

Edito
Depuis de nombreuses années, les mouvements sociaux se sont pleinement approprié les canaux d’information aux formats courts, directs, rythmés : Facebook, X (ex-Twitter), Snapchat… Pourtant, nombre d’entre eux n’ont jamais sacrifié leur mission d’éducation permanente sur l’autel de l’instantané. Numéro après numéro, ils continuent de publier des contenus plus fouillés, plus denses qui visent à informer, former, outiller et relier. C’est pourquoi revues et journaux ont toujours occupé une place essentielle dans leur travail d’approche critique des réalités sociales et d’émancipation.
S’appuyant à la fois sur les nombreuses ressources qu’il conserve dans ses riches collections et sur la longue tradition d’édition des organisations du Mouvement ouvrier chrétien, le CARHOP consacre ce numéro de Dynamiques à l’histoire et à l’usage des périodiques au sein de mouvements socioéducatifs. Parce que lire et lier relèvent de la même dynamique (construire du commun), plongez-vous dans les coulisses des journaux et revues qui sont autant de rendez-vous hebdomadaires, mensuels, semestriels… pour de nombreux militant.e.s en quête de comprendre et d’agir sur le monde dont ils sont partie prenante.
Bonne lecture !
Introduction au dossier : Les périodiques, outils de recrutement, de formation, de mobilisation et… de divertissement ?!
Camille Vanbersy (Historienne au CARHOP)
Emilie Arcq (Bibliothécaire-documentaliste au CARHOP)
Dès le début de l’imprimerie, la presse est utilisée par les mouvements sociaux comme moyen de promotion de leurs idées. Cependant, au contraire de la presse généraliste et de la presse féminine, peu d’études s’y sont intéressées[1]. En effet, parmi ces titres, prennent place des publications destinées à des publics précis et dès lors méconnues dans l’espace médiatique.
Avant d’entrer plus en avant dans ce sujet, il est utile de revenir sur quelques notions de vocabulaire et de préciser la manière dont les articles qui vont suivre considèrent le terme de « périodiques » et ses éventuels synonymes. Un « périodique » selon la définition du Larousse est une « publication qui parait à intervalles de temps réguliers »[2]. Ces productions étant caractérisée par leurs fréquences de parution, nous trouvons dans cette famille : les quotidiens, les mensuels, les bimestriels, les trimestriels… Le terme de « journal »[3] est parfois utilisé comme synonyme de périodique. Cependant, comme nous le verrons à plusieurs reprises dans les articles qui suivent, par extension et dans le langage courant, le terme « journal » peut désigner la forme que prend le périodique à savoir un format relativement grand de pages pliées et non reliées à l’image d’un journal tel que Le Soir. Il se distingue alors du format « revue » ou « magazine » qui, de taille plus réduite, A4 ou moins, est composé de feuilles reliées entourées d’une couverture. « Magazine » étant défini comme un « périodique, le plus souvent illustré »[4] et « revue » comme « une publication périodique spécialisée dans un domaine donné »[5].
Cette presse de mouvement, financée par les acteurs eux-mêmes et les subventions, ne vise pas la rentabilité, mais l’expression. C’est par la publication de bulletin, de revue, par ce « quatrième pouvoir »[6] que les mouvements vont recruter de nouveaux membres, les former et faire vivre le mouvement. Ces publications sont « des instruments capables de véhiculer son idéologie, de diffuser ses informations vers les membres et de faire remonter celles de la base »[7]. Les syndicats sont de grands producteurs de périodiques dès leur création. Cependant, ceux-ci n’ont évidemment pas le monopole de la publication périodique. Dans le cadre de ce numéro de Dynamiques, sur les cinq organisations constitutives que compte le Mouvement ouvrier chrétien, nous en avons choisi trois, actives dans le domaine socio-éducatif : Vie féminine, la Jeunesse organisée combative (JOC) et les Équipes populaires. La presse syndicale et la presse mutuelliste sont en effet écartées de ce numéro dès lors qu’elles ont déjà été largement analysées par le passé[8].
L’ampleur de la production de ces associations a été mise en lumière lors du travail d’inventaire des publications produites depuis l’origine par la JOC. À cette occasion, ce sont plusieurs dizaines de mètres linéaires de monographies, de brochures, de plaquettes, de magazines, de journaux, de bulletins, de feuilles d’information… qui ont été décrits. Parmi cette production, les périodiques semblaient occuper une place importante. Cette impression a été renforcée par la rencontre d’ancien.ne.s jocistes dans le cadre des préparatifs du centenaire de la JOC qui aura lieu en mai 2025. Ces militant.e.s accordent en effet beaucoup d’importance aux périodiques. Leur redécouverte du T.U., du Zig Zap, du Face A témoignait d’un attachement particulier à ce média. Rencontre des grands esprits, ces préoccupations très actuelles de militant.e.s font écho à une réflexion que nous menions au sein du CARHOP dans le cadre de notre plan quinquennal 2024-2028, à savoir : en quoi les périodiques participent-ils aux liens de sociabilité entre les militant.e.s ?
Face à cet attachement et à la multitude de titres et de numéros publiés, se pose la question du “pourquoi” créer, maintenir et diversifier les périodiques, surtout si nous tenons compte de notre époque qui, a priori, privilégie les contenus médiatiques très courts (capsules vidéo, posts sur les réseaux sociaux, etc.). Répondre à cette question aussi simple que fondamentale nous amène à nous intéresser au(x) rôle(s) des périodiques en tant qu’outils d'(info)formation, de lien (Lire pour lier), voire de divertissement. Là sont les enjeux des différents articles qui composent ce numéro de Dynamiques.
Ces questions nous semblent d’autant plus importantes aujourd’hui que la production périodique en général et celle des associations en particulier rencontre aujourd’hui différents problèmes ou questionnements liés, en partie, à la dématérialisation des supports de ces médias. Celle-ci ainsi que l’arrivée des nouveaux médias et la prédominance d’internet et du numérique dans notre quotidien amènent à repenser nos pratiques. Dans une optique de simplification et d’accessibilité, les périodiques papier sont parfois remplacés par une version digitale. Se pose alors la question de savoir si les publics visés par ses associations ont réellement et facilement accès aux contenus dématérialisés ? En effet, force est de constater que face aux « inégalités sociales numériques »[9] rencontrées, certains délaissent ces médias dématérialisés… Ce numéro de Dynamiques n’a pas la prétention d’apporter des réponses à ces vastes problématiques, mais plutôt d’apporter un éclairage historique par trois exemples concrets.
Dans le premier article de ce numéro, Émilie Arcq, bibliothécaire documentaliste au CARHOP, présente un focus sur les périodiques conservés au CARHOP. En effet, depuis de nombreuses années, le centre attache une attention particulière à ce type de média et en possède une importante collection couvrant de nombreuses thématiques. L’article détaille également l’intérêt de conserver et d’exploiter ce type de source.
Le deuxième article, rédigé par Amélie Roucloux, historienne au CARHOP, retrace l’histoire des périodiques publiés par Vie Féminine. Il suit l’histoire du mouvement de manière chronologique et présente dans un premier temps le journal La ligue des femmes qui accompagne lors de leur création les Ligues ouvrières féminines chrétiennes. En 1946, ce journal évolue et prend le nom de Vie féminine, appellation qu’il conserve jusqu’en janvier 1998 où il prend le nom d’axelle. Au cours du temps, les objectifs et les publics poursuivis par ces périodiques seront l’objet de discussions au sein du mouvement, ce journal doit-il être celui du mouvement ou viser un large public féminin ? Comment, par la forme et le contenu, maintenir le lien avec son public ?
Le troisième article parcourt la production périodique de la JOC. Dans celui-ci, Camille Vanbersy, historienne au CARHOP, présente les nombreux périodiques qui ont accompagné l’histoire de la JOC depuis son origine dans les années 1920 jusqu’à aujourd’hui. Un focus est ensuite mis sur le journal T.U. [Trait-d’union] paru de 1981 à 2000. Au sein de ce dernier les jeunes, les militants jocistes, occupent une place centrale. Ce périodique permet de mettre en lumière l’importance du maintien du lien avec ce lectorat ainsi que sa participation active à l’élaboration de la revue. L’article se clôture par une esquisse des enjeux rencontrés par les périodiques jocistes depuis les années 2000 jusqu’à aujourd’hui.
Enfin, ce numéro se clôture par l’article de Monique Van Dieren, ancienne permanente communautaire aux Équipes populaires, consacré au périodique des Équipes Populaires, Contrastes. Après avoir resitué historiquement le mouvement des Équipes Populaires (EP), elle s’interroge sur l’utilité et les publics visés par le périodique édité. Elle détaille dans cet article en quoi Contrastes est utilisé par les Équipes comme un moyen de renforcer l’adhésion et la cohésion, comme un outil de propagande et de visibilité du mouvement. Elle aborde ensuite le rapport que ce périodique entretien avec ses lecteurs et comment celui-ci entend répondre aux attentes des militants/lecteurs. L’article se conclut par deux modifications apportant son lot de conséquences sur la politique éditoriale des EP à savoir, d’une part, la mise en application du décret de reconnaissance de l’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autre part, la question du numérique et de l’abandon du papier.
Notes
[1] Citons une étude quantitative québécoise sur le sujet : RIVIERE M-J. et CARON C., « La presse des femmes et le progrès social au Québec ». Une bataille de l’imprimé, Presse de l’Université de Montréal, 2008, p. 181-187. https://books.openedition.org/pum/16915, consulté le 16 septembre 2024.
[2] « Périodique », dans Le Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/p%C3%A9riodique/59581 ,consulté le 16 septembre 2024.
[3] Ce terme désigne, toujours selon Le Larousse, une « publication quotidienne donnant des informations ou des opinions sur les nouvelles politiques, économiques, sociales, etc. » ou encore un « terme générique désignant diverses publications périodiques ». « Journal », dans Le Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/journal/45035, consulté le 16 septembre 2024.
[4] « Magazine », dans Le Larousse, en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/magazine/48522, page consultée le 16 septembre 2024.
[5] « Revue », dans Le Larousse, en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/revue/69183, page consultée le 16 septembre 2024.
[6] Anthony Vienne : rédacteur et administrateur au « Peuple », publie en 1930 le Quatrième pouvoir . Cet ouvrage met en lumière la presse comme le quatrième pouvoir (exécutif, législatif et judiciaire) et relève « l’insuffisance de moyens » de la presse ouvrière face à la presse bourgeoise.
[7] DRESSE R., La Mutualité chrétienne de Liège – 125 ans d’engagement solidaire, Liège – Bruxelles, CARHOP , Mutualité chrétienne de Liège, 2020. Pour la CSC consulter : WELTER F., (coord) La CSC retour sur 45 ans de progers social, Bruxelles, CSC, 2023. https://www.lacsc.be/la-csc/publications/brochures/carhop , page consultée le 16 septembre 2024.
[8] Pour la Mutualité chrétienne, consulter par exemple : DRESSE R., La Mutualité chrétienne de Liège – 125 ans d’engagement solidaire, Liège – Bruxelles, CARHOP , Mutualité chrétienne de Liège, 2020. Pour la CSC consulter : WELTER F., (coord.), La CSC retour sur 45 ans de progrès social, Bruxelles, CSC, 2023. https://www.lacsc.be/la-csc/publications/brochures/carhop, page consultée le 16 septembre 2024.
[9] Sur ce sujet lire : VAN NECK, S., La « fracture numérique », un système de (dé)classement qui vous veut du bien – quelques considérations critiques sur une notion au centre des préoccupations, Lire et Ecrire, mai 2022, : la_fracture_numerique_un_systeme_de_declassement.pdf (lire-et-ecrire.be), page consultée le 16 septembre 2024.
Pour citer cet article
VANBERSY, C. et ARCQ E., « Introduction au dossier : Les périodiques, outils de recrutement, de formation, de mobilisation et…de divertissement ?! », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 24 : Lire pour lier!, octobre 2024, mis en ligne le 10 octobre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/
Le périodique : un outil d’éducation permanente. L’exemple du CARHOP
Emilie Arcq (Bibliothécaire-documentaliste au CARHOP)
Qu’est-ce qu’un périodique ? De sa création à son utilisation.
Qu’il soit digital ou papier, qu’on le nomme journal, magazine, revue ou périodique, il est défini par le glossaire de l’association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) comme une « Catégorie de publications en série, à auteurs multiples, dotée d’un titre unique, dont les fascicules, généralement composés de plusieurs contributions répertoriées dans un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers (journal, magazine, lettre, numéro spécial, revue), pendant une durée non limitée a priori. Les publications annuelles sont comprises dans cette définition ; les journaux et les collections de monographies en sont exclus. »[1]
En d’autres termes, le périodique est une publication sérielle à titre unique avec un ou plusieurs contributeurs avec une périodicité de publication le plus possible régulière.
Loin de prétendre à l’exhaustivité, cet article a pour vocation de traiter de l’utilité de la conservation des périodiques associatifs et de leur usage dans un processus d’éducation permanente, et particulièrement comme outil d’éclairage historique sur les questions sociales qui sont débattues aujourd’hui dans le mouvement ouvrier et le secteur associatif. Le CARHOP disposant d’un centre de documentation spécialisé particulièrement fourni en périodiques, la focale sera mise sur ses collections et l’usage qu’il en est fait.
Conservation des périodiques au CARHOP

Action de collecte dès la création
Depuis sa constitution en ASBL en 1980, le CARHOP a pour objectif « de constituer un centre de documentation classant systématiquement les documents écrits, iconographiques, sonores recueillis et les rendant accessibles :
-
- Prioritairement aux cellules régionales et aux organisations du Mouvement Ouvrier Chrétien
- Aux institutions ou personnes intéressées par l’histoire ouvrière »[2].
En juin 1980, un comité de gestion de la bibliothèque est mis en place pour gérer l’apport de la bibliothèque donné par Berthe Wolf au centre (+/- 5000 ouvrages). Ce comité réalisera également « le dépouillement régulier de la presse quotidienne qui permet d’enrichir régulièrement le fonds »[3]. Dès lors, on peut constater que certaines revues sont recherchées en priorité : « un effort spécial a été fait pour recevoir, dépouiller, compléter les revues importantes comme le Courrier hebdomadaire du CRISP [4], le Bulletin de la FAR[5], la Revue Nouvelle, la Revue du Travail »[6]. Les périodiques La Chaine et UCP-Flash : bulletin du secrétariat national de l’Union Chrétienne des pensionnés asbl sont aussi mentionnés dans les rapports d’activités du CARHOP.
Dès juin 1982, l’équipe du CARHOP crée « un fichier pour les revues et dépouillements des articles. ».[7] Le travail de collecte et de dépouillement se poursuit au fil des années. On peut noter que les journaux La Cité et Le Soir sont dépouillés en priorité, probablement sur des questions en lien avec les questions sociales du moment.
Le CARHOP ne se limite pas à ces périodiques généralistes. Il prospecte également auprès des organisations sociales, des mouvements socioéducatifs et des associations ancrées dans le pilier chrétien. Lors de l’Assemblée générale du CARHOP en juin 1985, il est ainsi mentionné un accroissement des collections par des dons « principalement des fédérations des Équipes Populaires, de celles du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), et de la CSDC [sic lire CSC, Confédération des syndicats chrétiens] »[8]. Cependant,
Les projets de recherche, les travaux archivistiques et d’éducation permanente ont amené le CARHOP à récolter et conserver des périodiques émanant d’associations et de collectifs situés en dehors du pilier chrétien.
Plus de 1000 titres !
En juin 1985, la bibliothèque compte 160 titres de périodiques. L’année suivante, on dénombre 288 titres de périodique et 69 titres de journaux. Ce qui, si les chiffres sont exacts, relève d’un énorme travail de collecte et d’inventorisation. Aujourd’hui, le CARHOP compte plus de 800 titres de périodiques et de journaux. Ce nombre représente 328 mètres linéaires (m.l.). Ce métrage concerne tant des périodiques courants (c’est-à-dire, toujours édités) que des collections qui ne sont plus éditées ou à périodicité variable et qui sont parfois difficiles à trouver. Nous conservons également des périodiques qui ne sont plus édités tels que La lutte contre le Chômage : organe trimestriel de la section belge de l’Association Internationale, édité de 1912 à 1925.
Plus d’un tiers des périodiques conservés par le CARHOP proviennent du MOC et de ses organisations constitutives[9]. Parmi les collections, se retrouvent ainsi des titres comme :
- En marche : la solidarité c’est bon pour la santé, bimensuel édité par la mutualité chrétienne (MC) (1948-2023).
- Contrastes[10], éditée par les Équipes Populaires. Cette revue bimestrielle propose des dossiers pédagogiques sur des sujets tels que la démocratie, le féminisme, le logement, l’emploi…
- Organise-toi!, publié par la JOC[11] (Jeunesse organisée et combative), trois à quatre fois par an (dernier numéro paru en décembre 2023), qui met en avant le format de l’enquête pour décrypter les conditions des jeunes. Soulignons le nombre important de titres de périodiques de la JOC, tout au long de son histoire, ainsi que le volume qu’ils représentent. Les périodiques de la JOC représentent à eux seuls, plus d’un quart de nos collections, soit 26,39 %.
- axelle[12], édité par l’asbl Vie Féminime, périodique féministe bimestriel papier mais aussi numérique met en avant les combats menés par les femmes.
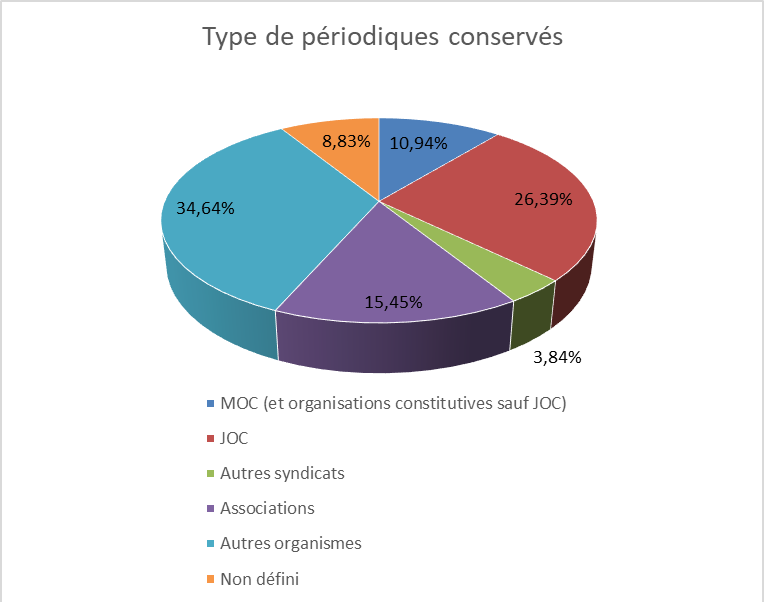
Il ne s’agit de quelques exemples de périodiques qui ont souvent été précédés par d’autres titres et qui sont complémentaires d’autres collections. Ainsi, Info CSC n’est ni plus ni moins que le successeur de Au Travail. Sa lecture peut être associée à la consultation d’autres publications telles que Syndicaliste ou le Droit de l’employé, par exemple[13]. Les périodiques d’associations représentent quant à eux 15.45 % de nos collections. Citons par exemple Les cahiers du fil rouge édité par le Collectif formation société (CFS) dont les actions ont commencé dans les années 1960 par des cours d’alphabétisation pour aider les travailleurs marocains analphabètes au sein d’une organisation syndicale à Bruxelles[14] ou Le marollien rénové édité par l’asbl le Mensuel d’information locale a pour objet « d’éditer et de publier un journal permettant aux habitants d’être informés de ce qui se passe dans ce quartier et de faire parvenir des messages aux autorités »[15].
Nous conservons également des « ovni » éditoriaux comme Le Petit Pangolin Illustré : le journal des petites bêtes qui aiment se mettre en boule …, fondé par Patrice Baudinet et édité aux éditions Fanzinorama. D’abord hebdomadaire, puis mensuel, il voit le jour pendant la pandémie de Covid-19. Il est principalement composé de dessins, dans le but de répondre aux besoins de sortir de l’isolement des personnes confinées. Sa conservation s’inscrit dans la campagne nationale de récolte de traces relatives au confinement. Chapeautée par l’Association des archivistes francophones de Belgique (AAFB) et son pendant néerlandophone (De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie – VVBAD), cette campagne donne lieu à la mise en place de la plate-forme Archives de Quarantaine #AQA, à laquelle le CARHOP a contribué[16].

L’usage des périodiques dans l’histoire sociale
Les périodiques sont des outils d’information, de formation de leurs lecteurs et lectrices, en même temps qu’ils entretiennent du lien entre eux. Sur le plan de la recherche historique, ils sont aussi une littérature grise[17] qui constitue une source précieuse pour la compréhension des luttes et des conquêtes sociales, en complément des archives inédites. Ils permettent aux historien.ne.s de comprendre en quelques lignes les tenants et aboutissant, les processus et la concrétisation des projets réalisés en collectif, ainsi que la manière dont ceux-ci sont présentés et expliqués dans la sphère publique. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les consultant.e.s qui se présentent au CARHOP pour consulter des archives, quelles qu’elles soient, sont généralement intéressés de consulter aussi les périodiques. Notons par ailleurs que ceux-ci ont l’avantage de contenir généralement une grande variété d’illustrations qui rendent plus vivantes, qui incarnent les luttes sociales ; c’est là aussi une grande différence avec des archives inédites parfois arides.

En guise de conclusion
L’évolution de la consommation des périodiques a évolué ces trente dernières années, avec l’arrivée du Web : les habitudes de lecture, d’édition et de commercialisation ont changé. La digitalisation de l’information décline celle-ci sur différents supports, y compris le papier[18]. Les journaux et périodiques sont maintenant accessibles numériquement, c’est le cas entre autres du Courrier hebdomadaire du CRISP, (disponible au CARHOP). Les bibliothèques numériques en ligne, telles que Belgica[19] et BelgicaPress[20] mettent à dispositions la numérisation de 136 journaux. Cependant, tout n’est pas disponible à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR). En effet, malgré la loi du 08 avril 1965[21] instituant le dépôt légal en Belgique qui oblige le dépôt de toutes publications (livres, brochures, périodiques paraissant moins d’une fois par semaine, distribuée gratuitement, vendue ou en location) éditées en Belgique, les publications éditées à l’étranger dont l’un des auteurs est Belge et est domicilié en Belgique, il arrive que certains documents ne soient pas conservés à la KBR. C’est là que réside l’importance des travaux réalisés par les centres d’archives et les centres de documentation spécialisés.
Rares ou largement diffusés, les périodiques ont une grande valeur. C’est pourquoi le CARHOP leur accorde une attention particulière. Comme de nombreuses autres structures (IHOES, Mundaneum, Etopia, etc.), le CARHOP conserve de nombreux titres de périodiques, qui constituent des ressources essentielles pour la compréhension des luttes sociales d’hier et d’aujourd’hui, menées par de grandes organisations, comme des associations plus modestes. Lui-même a fait le choix, il y a huit ans, d’informer et de former ses lecteurs et lectrices par le biais d’un périodique : Dynamiques. Histoire sociale en revue[22]. Le fait que l’aventure se poursuive et que, de manière générale, les mouvements sociaux ont toujours gardé ce canal d’information et de formation, est un signe que les acteurs et actrices de transformation sociale sont toujours en quête de questionnements, de réflexions, de construction de points de vue grâce à des supports accessibles et solides au niveau du contenu.[23]
Notes
[1] L’association des professionnels de l’information et de la documentation, « Glossaire », https://adbs.fr/publications/glossaire, page consultée le 12 septembre 2024.
[2] CARHOP, fonds CARHOP, n°1, document de travail de Hubert Dewez pour l’AG du CARHOP du 17/02/1981.
[3] CARHOP, fonds CARHOP, n°2, annexe 3 rapport de l’AG du CARHOP, 26/12/1980.
[4] Maintenant disponible en version électronique.
[5] Fondation André Renard.
[6] CARHOP, fonds CARHOP, n°2, annexe 3 rapport de l’AG du CARHOP, 26/12/1980.
[7] CARHOP, fonds CARHOP, n°5, Rapport d’activités de l’AG du CARHOP, 1981, juin 1982.
[8] CARHOP, fonds CARHOP, n°8 : Rapport d’activités de l’AG du CARHOP, juin 1985.
[9] Pour rappel les organisations constitutives du MOC sont les Équipes Populaires, la Mutualité Chrétienne, la JOC, Vie féminine et la CSC.
[10] Pour aller plus loin, voir l’article de Monique Van Dieren : De L’Équipe Populaire à Contrastes : Un trait d’union entre le mouvement et ses affiliés, dans ce numéro.
[11] Pour aller plus loin, voir l’article de Camille Vanbersy : Le périodique, outil de propagande, de formation et Trait d’Union entre les jocistes et la JOC ?, dans ce numéro.
[12] Pour aller plus loin, voir l’article de Amélie Roucloux : La Ligue des femmes, Vie féminine, axelle, De la ligueuse chrétienne aux militantes féministes, Un siècle de femmes à la Une !, dans ce numéro.
[13] Pour une analyse de la presse syndicale chrétienne, voir : LEPOUTRE S., « L’information syndicale : multiple, foisonnante et sous tension », La CSC, retour sur 45 ans de progrès social, Bruxelles, CSC-CARHOP, p. 385-409.
[14] GEERAETS, R. M., «Fil rouge. En quête de sens », Les cahiers du fil rouge, n°1, [2005], https://ep.cfsasbl.be/IMG/pdf/cahier1-2.pdf , page consultée le 25 septembre 2024.
[15] Président de la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), « Lettre à monsieur le bourgmestre », février 2001, https://www.vct-cpcl.be/sites/default/files/import/32120MD-AZ.pdf , page consultée le 20 septembre 2024.
[16] DI SENZO L. et ROUCLOUX A., « Covid-19 et confinement. Regard de l’histoire sur des mobilisations actuelles » Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°12, septembre 2020, mis en ligne le 15 octobre 2020, https://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2020/10/20201013_RD_Intro_VD.pdf .
[17] La définition de la littérature grise désigne « tout type de document produit par le gouvernement, l’administration, l’enseignement et la recherche, le commerce et l’industrie, en format papier ou numérique, protégé par les droits de propriété intellectuelle, de qualité suffisante pour être collecté et conservé par une bibliothèque ou une archive institutionnelle, et qui n’est pas contrôlé par l’édition commerciale ». Voir : SCHÖPFEL J., « Vers une nouvelle définition de la littérature grise », 2012, https://www.abd-bvd.be/wp-content/uploads/2012-3_Schopfel.pdf , page consultée le 23 septembre 2024.
[18] Pour aller plus loin, voir : COOLS B. « Presses quotidienne belge : passé, présent et futurs économiques.», Courrier hebdomadaire du Crisp, n°2552, 2022.
[19] KBR, « Belgica », https://belgica.kbr.be/belgica/home-belgica.aspx?_lg=fr-FR, page consultée le 25 septembre 2024.
[20] KBR, « Belgicapress », https://www.belgicapress.be , page consultée le 25 septembre 2024.
[21] Loi du 08 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (Moniteur belge du 18 juin 1965).
[22] En ligne gratuitement, Dynamiques, a pour objectif de « de prolonger une dynamique de rencontres sur l’histoire sociale entre les milieux universitaires, les institutions socioculturelles, les milieux associatifs et militants, ainsi que leurs publics ». La revue électronique mélange la recherche et l’éducation permanente dans une approche sociohistorique. Chaque numéro porte sur un thème qui allie “savoirs de terrain, issus des milieux syndicaux et associatifs, des expertises universitaires/scientifiques […] ainsi que des “témoignages qui sont les sources de l’histoire sociale”. CARHOP, « Présentation de la revue», Dynamiques. Histoire sociale en revue, 2016, https://www.carhop.be/revuescarhop/, page consultée le 25 septembre 2024.
[23] Ibidem.
Pour citer cet article
Arcq E., « Le périodique : un outil d’éducation permanente. L’exemple du CARHOP », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 24 : Lire pour lier!, octobre 2024, mis en ligne le 17 octobre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/
La Ligue des femmes, Vie féminine, axelle, De la ligueuse chrétienne aux militantes féministes, Un siècle de femmes à la Une !
Amélie Roucloux (Historienne au CARHOP)
De La Ligue des femmes à axelle, en passant par Vie féminine, le mensuel accompagne l’histoire d’un mouvement féminin centenaire : les Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC), devenues Vie Féminine en 1969. Destiné au départ aux membres du Mouvement, le mensuel participe à la construction de ce dernier, à son évolution d’une identité chrétienne à une identité féministe, avec toujours la question sociale chevillée au corps et les femmes au centre des écrits. Pour comprendre le cheminement de ce journal de propagande chrétienne devenu magazine d’analyse féministe, il faut se plonger au cœur de ses tiraillements entre sa volonté de porter les messages du Mouvement auprès des membres, et son désir de toucher un plus large public en s’intéressant aux préoccupations des femmes.[1]
La ligue des femmes pour construire les Ligues

Tout à leur volonté de construire un mouvement féminin chrétien de masse, les LOFC mettent l’accent sur la formation et la propagande. Le journal La Ligue des femmes s’intègre parfaitement dans cette stratégie. Paru en avril 1919, il a pour mission d’informer et de renforcer les liens avec les membres. La cotisation mensuelle comprend l’abonnement au journal qui est amené par la sectionnaire au domicile de l’affiliée. D’inspiration sociale et catholique, des rubriques consolident la ligne éditoriale du journal : « Chronique des Ligues » qui informe sur l’activité des ligues locales ; « Formation religieuse » ; « Échos de notre action sociale » qui informe sur les actions politiques et sociales du Mouvement ; « Ce que nous en pensons » qui est un édito sur des sujets d’actualité ; « Les idées de tante Fine » qui propose l’achat de patrons de couture ; les rubriques cuisine, mode, jardin qui donnent des recommandations d’entretien du logis et d’hygiène de la famille.
Avec la Seconde Guerre mondiale, les LOFC arrêtent officiellement leurs activités et La Ligue des femmes avec. Toutefois, officieusement, les LOFC contournent la censure en éditant un petit polycopié sans logo. Sa diffusion par les sectionnaires permet de maintenir le lien avec les ligueuses, tout en apportant un message religieux et d’espoir, ainsi que des conseils de cuisine et de couture pour pallier aux restrictions. En septembre 1944, La Ligue des femmes reparaît. Le temps est à la reconstruction.[2]
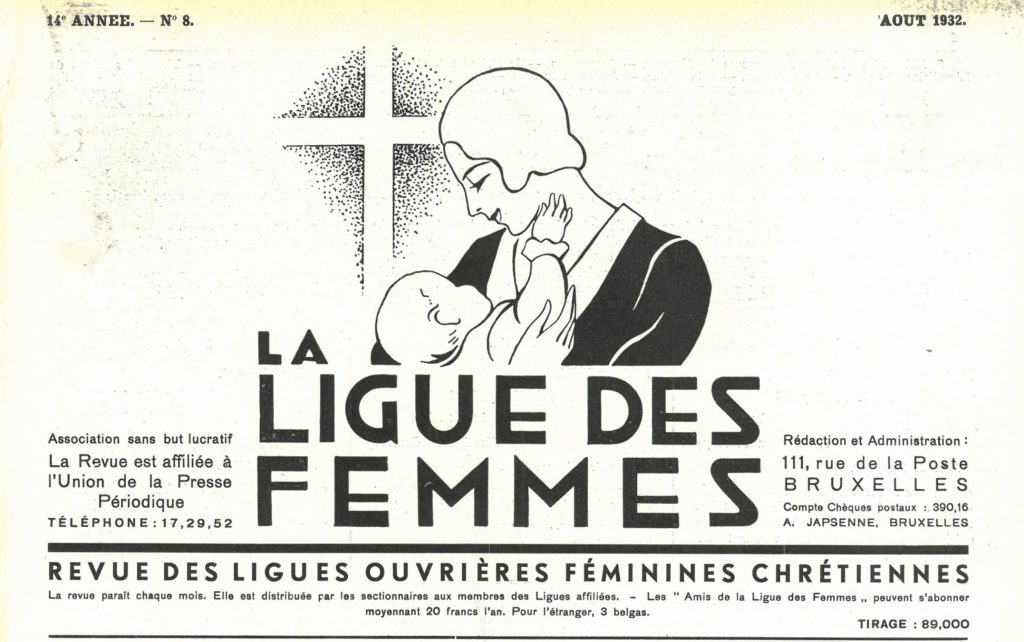
Vie féminine, journal de Mouvement ou journal féminin ?
En janvier 1946, La Ligue des femmes prend le nom de Vie féminine. Le fonctionnement par rubrique, qui avait progressivement disparu, n’est pas renouvelé et une commission Journal est créée. En 1953, celle-ci souligne l’importance d’insister sur le lien entre Vie féminine et les LOFC, à savoir : intégrer la prière de la Ligue dans les numéros, rappeler que le prix du journal est une participation à tous les services, et mentionner plus souvent le lien existant entre les ligueuses et les fédérations régionales et nationales.[3] À ce moment-là, Vie féminine est le journal des membres et le choix du public cible répond aux stratégies de recrutement des LOFC. Ainsi, en 1958, Marie Braham, secrétaire générale, intervient directement auprès de la commission en lui demandant de créer des rubriques à destination des jeunes, des aînées, et des travailleuses, ce qui correspond à la volonté des LOFC de spécialiser leurs actions en fonction de ces publics spécifiques.[4]

En 1962, une commission élargie est organisée avec les secrétaires des fédérations régionales à propos du contenu du journal.[5] Elles font part de leurs suggestions : plus d’articles en lien avec le programme d’année afin de faciliter les discussions avec les ligueuses, et intégrer des poésies, des conseils ménagers, des romans, des reportages à l’étranger, des conseils coiffures, un sommaire[6], un courrier pour les questions sociales et éducatives, et enfin une présentation plus pédagogique et ludique de l’actualité législative et sociale qui concerne les femmes.[7] Des hésitations surviennent quant à savoir à qui s’adresse le journal. À la question : « Vie féminine est-il un “Journal de Mouvement ou journal féminin ?” », les secrétaires ne se prononcent pas, pas plus qu’elles ne parviennent à préciser la manière de faire lien entre les LOFC et le journal. « La question est restée en suspens. On a aussi laissé en suspens la question “Comment faire passer les activités du mouvement dans le journal ?” »[8]
En 1969, directement inspirées par leur journal, les LOFC prennent le nom de Vie Féminine. Puis, le Mouvement réfléchit à la ligne éditoriale de Vie féminine afin de la rafraîchir pour attirer un nouveau public. En mars 1985, le Centre d’étude de la communication (CECOM) en fait l’analyse.[9] Au niveau visuel, il s’apparente à un toutes-boîtes et semble s’être arrêté « avec les golden sixties, et n’avoir fait aucun effort pour rejoindre les années [19]80. »[10] La mise en page manque de lignes directrices, entraînant une organisation hasardeuse des articles.
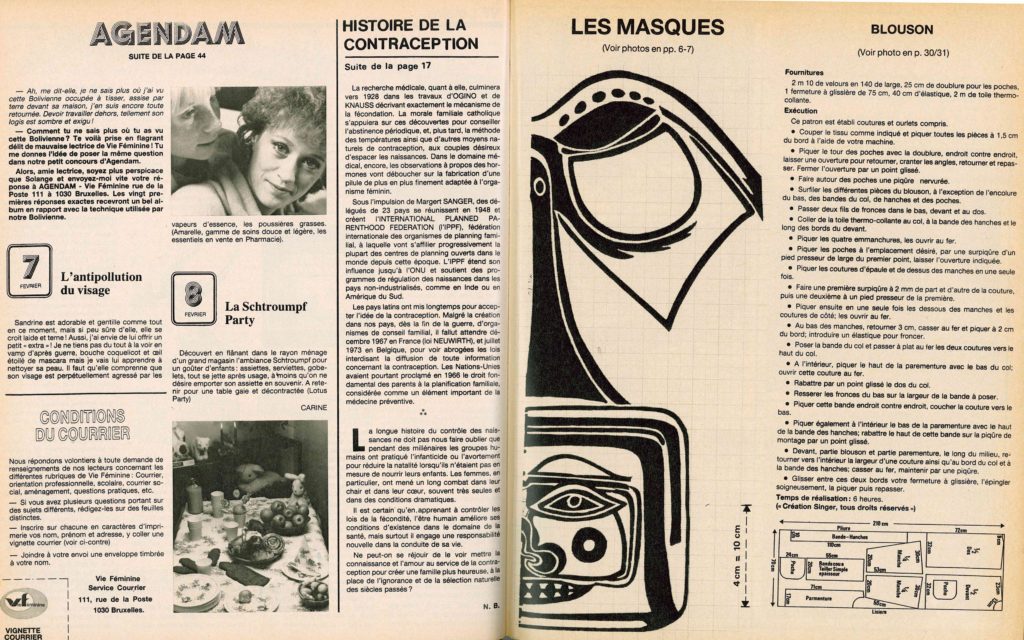
Au niveau du contenu, le CECOM préconise un style plus vivant et accrocheur, ainsi qu’un travail de relecture systématique pour donner un ton commun au journal. Il pointe ainsi les articles modes & beauté, dont les discours normatifs créent un décalage avec les prises de position sociales explicites du Mouvement. « Vie féminine participe alors généralement aux mythes de la société dominante, et la revue, au lieu de contester les situations, tend à un idéal de classe moyenne. »[11]

Vie féminine en prend acte et une première modification est faite en mars 1986 avec l’adoption d’un format rectangulaire. La typographie du logo change afin de le rendre plus visible. Les couleurs et l’organisation des textes sont plus équilibrées.[12] Les premiers retours sont positifs[13], et une enquête sur cette nouvelle formule est prévue.[14]

En 1987, le Mouvement décide de cibler les jeunes lectrices. « Nous sommes d’accord sur le fait que le journal doit changer, mais les critiques semblent venir uniquement du côté des jeunes ; les autres semblent satisfaites… alors cela ne sera pas facile de changer. Pourtant, si les jeunes veulent autre chose, n’est-ce pas sur ce public qu’il faut miser ? »[15] Parmi les pistes envisagées pour agrandir le nombre de lectrices : « Séparer cotisation et journal pour un nouveau public. »[16] Pour l’heure, des groupes locaux s’essayent à de nouvelles méthodes de distribution du journal, en délaissant progressivement la visite domiciliaire au profit de la distribution postale.[17]
axelle, média féministe belge
En janvier 1998, Vie féminine prend le nom d’axelle. La charte éditoriale précise : « Il est un magazine destiné à un large public féminin. » La nouvelle formule surprend et cristallise toute une série de débats en cours au sein du Mouvement. En septembre 1999, un audit du lectorat identifie quelques ajustements de contenus et constate que l’objectif de toucher un public externe est un succès. De nouvelles structures sont créées pour alimenter axelle. Un comité d’édition, composé notamment de personnes-ressources extérieures au Mouvement, propose des contenus rédactionnels. À ses côtés, un groupe d’accompagnement, composé de membres de Vie Féminine et de représentantes des services de Vie Féminine, garantit le lien entre le Mouvement, les services et axelle.[18]

Sabine Panet, engagée en 2013 et actuelle rédactrice en chef, et Stéphanie Dambroise, engagée en 2003 et actuelle secrétaire de rédaction, rendent compte des évolutions d’axelle depuis sa création.[19] Au niveau visuel, les réflexions sont constantes : la mise en page accompagne l’air du temps et le magazine investit rapidement internet, en créant une petite page web au début des années 2000. En octobre 2016[20], le chantier de renouvellement du magazine aboutit à une nouvelle formule : la mise en page est repensée avec le concours de trois graphistes, le sommaire est réorganisé, et un nouveau site web est créé. La rédaction se compose alors de la rédactrice en chef et de la secrétaire de rédaction, qui fait appel à des journalistes indépendant.e.s et ponctuellement de graphistes. À partir de 2017, axelle propose de plus en plus souvent des couvertures illustrées avant de systématiser la formule fin 2021. En novembre 2021, le magazine passe en bimestriel ce qui permet de développer des dossiers plus conséquents, le plus souvent coordonnés avec l’aide d’un.e journaliste indépendant.e, ainsi que des grandes enquêtes en Belgique.

Au niveau du contenu, le passage à axelle s’accompagne, dès le départ, d’une volonté de professionnaliser le magazine. Des contributrices extérieures à Vie Féminine sont invitées à rédiger des articles et un travail de relecture systématique est réalisé. Au fur et à mesure que le magazine acquiert une certaine notoriété, de plus en plus de journalistes professionnel.le.s proposent d’écrire des articles. Cette professionnalisation des personnes implique une professionnalisation du cadre de travail. Depuis 2016, pour la rémunération des journalistes, la rédaction se base sur les recommandations de l’Association des journalistes professionnels.

Les liens sont maintenus avec Vie Féminine, même si leur nature change. Si axelle continue à rendre compte des grandes campagnes du Mouvement,[21] il s’agit de plus en plus d’une présentation journalistique, qu’une promotion des activités du Mouvement. La rédaction est informée de ce qui se fait dans les régionales de Vie Féminine et, lorsqu’elle évalue que ces expériences sont intéressantes à documenter journalistiquement, elle sollicite un.e journaliste indépendant.e pour écrire un article. De leur côté, les journalistes voient en ce lien avec le Mouvement une source d’inspiration puisque ses « enjeux irriguent nos pages. »[22] Une réflexion est entamée pour mettre en place un comité éditorial, composé de représentantes de Vie Féminine et de journalistes, dont le rôle serait de partager des réflexions et des retours du terrain afin d’amorcer des pistes pour des articles.

« (axelle) est à la fois dedans et dehors (de Vie Féminine). Ça fait partie de notre identité. On est dedans parce qu’on est édité par Vie Féminine, qu’on partage les valeurs de Vie Féminine, qu’on est là parce qu’il y a Vie Féminine, qu’on partage la vision du monde, que c’est notre source d’information première. On est aussi dehors parce qu’on a une mission de regarder ce qui se fait dehors, de regarder ce qui se fait dans le reste du monde, de parler à des femmes qui ne sont pas membres du Mouvement. On a notre engagement féministe qui est vraiment ancré dans Vie Féminine, et puis notre engagement journalistique qui est dehors. On marche sur ces deux pieds en permanence, ce qui est une grande source de richesses, mais ce qui amène aussi une certaine complexité parfois. »[23]
Sabine Panet
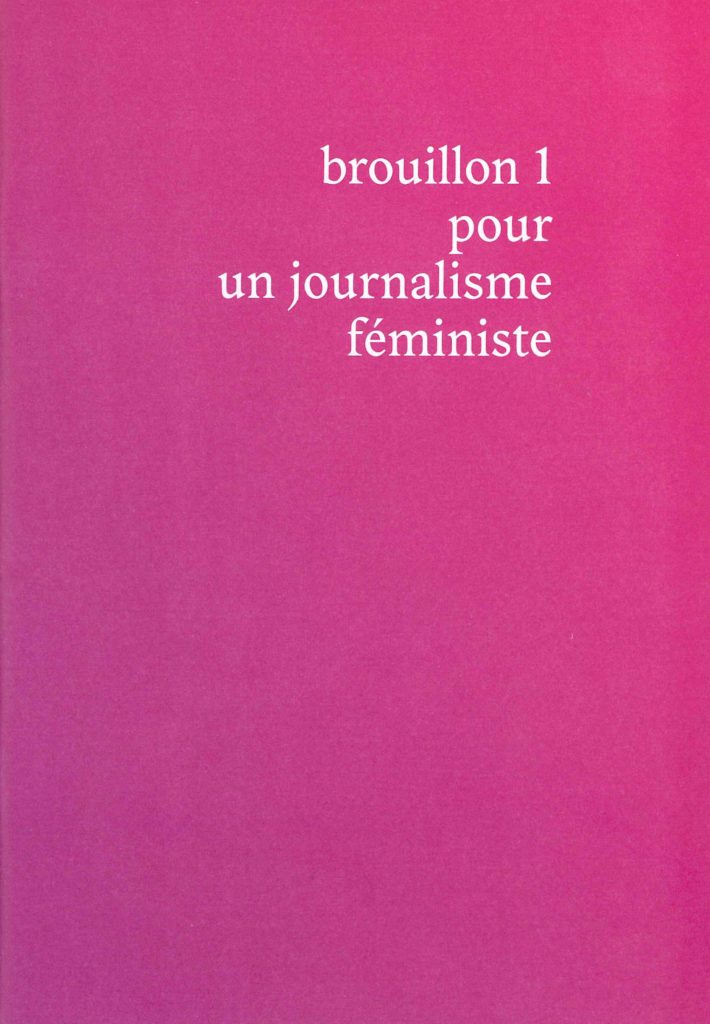
Aujourd’hui, axelle continue à questionner et à se questionner pour diffuser un regard féministe sur l’actualité. En 2023, la rédaction et les journalistes rédigent un brouillon 1 pour un journalisme féministe afin de partager des façons de faire du journalisme féministe, inviter à repenser la fabrication des récits médiatiques et situer sa démarche dans la perspective d’une société démocratique plus égalitaire, plus juste, plus solidaire.[24] L’analyse du site web révèle que le lectorat consulte plutôt les anciens articles, pour donner ce faisant axelle est considéré comme magazine de référence sur les thématiques relatives aux droits des femmes. Le lectorat web représente 10 à 15 000 visites uniques et les podcasts sont une réussite, celui sur la maternité ayant atteint près de 50 000 écoutes. Enfin, le magazine papier axelle est diffusé tant auprès des membres de Vie Féminine, sur base de leurs cotisations, qu’auprès d’abonné.e.s. La diffusion est également assurée dans quelques points de ventes. Dans l’avenir, la rédaction aimerait développer une stratégie pour toucher un public plus large d’abonné.e.s.

Notes
[1] À noter que, à côté de cette publication, plus d’une dizaine vise spécifiquement les responsables, à des fins de formation. L’édition de ces dernières se succède ou se chevauche en fonction des stratégies politiques du Mouvement. Aujourd’hui, ce type de publication a disparu.
[2] Pour en savoir plus sur l’histoire des LOFC, de Vie Féminine et de son journal, voir ROUCLOUX A. (coord.), Vie Féminine. 100 ans de mobilisation féminine, Bruxelles, CARHOP, 2021.
[3] Secrétariat national de Vie Féminine (SNVF), fonds du secrétariat national (FSN) 1919-1990, n° 857, Commission du journal, 26 novembre 1953, p. 1-2.
[4] SNVF, FSN 1919-1990, n° 858, Lettre de Marie Braham et de Marguerite Debilde à la Commission Vie féminine, 9 mai 1958, p. 1.
[5] SNVF, FSN 1919-1990, n° 860, Réunion de Vie féminine, 21 mars 1962, p. 1-2.
[6] Le sommaire par rubrique reparaît en 1967, mais sans s’accompagner d’une réorganisation du journal.
[7] SNVF, FSN 1919-1990, n° 860, Commission élargie Vie féminine, 16 mai 1962, p. 1-6.
[8] SNVF, FSN 1919-1990, n° 860, Vie féminine – Suggestions des secrétaires, mai 1962, p. 4.
[9] SNVF, FSN 1919-1990, n° 863, Vie féminine : analyse d’une revue. Constat et perspectives, Louvain-la-Neuve, Centre d’étude de la communication (CECOM), 27 mars 1985, p. 119.
[10] SNVF, FSN 1919-1990, n° 863, Vie féminine : analyse d’une revue…, p. 36.
[11] SNVF, FSN 1919-1990, n° 863, Vie féminine : analyse d’une revue…, p. 107-113.
[12] SNVF, Vie féminine, mars 1986, 48 p.
[13] SNVF, FSN 1919-1990, n° 864, Compte-rendu du Groupe femme du Journal Vie féminine, 23 septembre 1986, p. 1.
[14] SNVF, FSN 1919-1990, n° 864, Compte-rendu de la réunion du Groupe femmes du journal, 14 janvier 1986, p. 2.
[15] SNVF, FSN 1919-1990, n° 864, Procès-verbal de la rencontre du Groupe journal jeunes femmes, 4 septembre 1987, p. 3.
[16] SNVF, FSN 1919-1990, n° 864, distribution journal, synthèse du travail S.E. 88, 1988, p. 5-6.
[17] SNVF, FSN 1919-1990, n° 864, Carnet outil, pour une autre distribution du journal Vie féminine, janvier 1989, p. 1.
[18] Pour en savoir plus sur l’histoire des LOFC, de Vie Féminine et de son journal, voir ROUCLOUX A. (coord.), Vie Féminine. 100 ans de mobilisation féminine, Bruxelles, CARHOP, 2021.
[19] CARHOP, interview de Sabine Panet et Stéphanie Dambroise par Amélie Roucloux, 22 août 2024.
[20] axelle, n° 192, octobre 2016, www.axellemag.be, page consulté le 6 septembre 2024.
[21] 20 ans de droits des femmes, axelle, hors-série, juillet-août 2018, www.axellemag.be, page consulté le 6 septembre 2024.
[22] Texte collectif, « Pour un journalisme féministe », axelle, n° 205, janvier-février 2023, p. 18-20. www.axellemag.be, consulté le 6 septembre 2024.
[23] CARHOP, interview de Sabine Panet et Stéphanie Dambroise par Amélie Roucloux, 22 août 2024.
[24] Les contributrices du brouillon, brouillon 1 pour un journalisme féministe, Bruxelles, axelle magazine & Vie Féminine asbl, 2023, p. 4.
Pour citer cet article
ROUCLOUX A., « La Ligue des femmes, Vie féminine, axelle, De la ligueuse chrétienne aux militantes féministes, Un siècle de femmes à la Une ! », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 24 : Lire pour lier!, octobre 2024, mis en ligne le 17 octobre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/
Le périodique, outil de propagande, de formation et Trait d’Union entre les jocistes et la JOC ?
Camille Vanbersy (Historienne au CARHOP)
De 1922 à nos jours, c’est près de deux cents titres de périodiques qui ont été édités par la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) [1]en Belgique ! Pourquoi autant de titres, quels sont les buts et les publics visés par ces publications ? En quoi celles-ci participent-elles aux actions du mouvement et comment évoluent-elles au cours de ce siècle d’existence ? C’est ce que nous tenterons d’ébaucher dans l’article qui suit, d’abord en retraçant à grands traits l’histoire de ces périodiques et ensuite en nous concentrant plus particulièrement sur l’un d’eux, le T.U. [Trait-d’union]. Comme nous le verrons, trois problématiques traversent cette histoire : celle du public visé, celle du but poursuivi et celle des rédacteurs des contenus.
À l’heure d’écrire ces lignes, près de 200 titres de périodiques jocistes belges qui ont été recensés dans les collections conservées au CARHOP[2]. Ce nombre pourrait encore évoluer au gré des versements, des dépouillements et des travaux de recherche[3]. C’est principalement sur ces documents ainsi que sur les archives de la JOC nationale, actuellement en cours d’inventaire, que cet article se base. Ce travail est également complété par une rencontre faite avec Pascal Brachotte, ancien président national de la JOC et éditeur responsable de 49 numéros du T.U., parus entre 1991 et 1996.
Dès l’origine de la JOC, un périodique ; durant son histoire, une pléthore de titres
Aux origines … Un périodique !
Dès les origines du mouvement, dans les années 1920, la JOC, qui s’appelle à l’époque la « Jeunesse syndicaliste » s’est dotée d’un « journal », afin de diffuser ses idées et de renforcer les liens entre les militants. Le premier porte le même nom que le mouvement : Jeunesse syndicaliste. Son premier numéro sort en octobre 1920. En avril 1924, il change de nom et devient Jeunesse ouvrière (JO), quelques mois avant que le mouvement lui-même adopte le nom de « Jeunesse ouvrière chrétienne ».

Dès 1922 également, ce qui deviendra la JOCF, branche féminine du mouvement, se dote de Joie et travail[4]. Paraissant chaque mois, ces publications ont pour objectif d’organiser la formation d’un mouvement de jeunesse ouvrière masculine, d’une part, et féminine, d’autre part. L’abonnement est alors compris dans la cotisation. Parallèlement, de nombreux numéros sont vendus de la main à la main ou à la criée, à la sortie des usines, des églises, sur les marchés ou lors d’événements… À ces ventes, s’ajoutent des campagnes de vente ciblées qui permettent également de stimuler la diffusion des publications et surtout le recrutement de nouveaux militants [5].
La multitude de titres produits témoigne de l’importance pour la JOC des périodiques et de la variété des fonctions que celui-ci remplit : moyen d’action, lien, instrument de propagande, outil de formation et d’animation… Évidemment, parmi ces titres, tous n’ont pas eu le même succès. Parmi ceux qui ont eu une longue existence, citons, par exemple, Joie et travail qui est publié entre 1922 et 1965, le Bulletin des dirigeants, qui parait de 1924 à 1966, ou encore Film, la feuille de liaison interne à la JOCF publié entre 1985 et 2009. À l’inverse, d’autres ont une vie éphémère et seuls quelques numéros sont produits.
Le nombre de titres et donc la variété des périodiques évoluent à travers le temps. Avant la Seconde Guerre mondiale, plus d’une dizaine de titres de périodique différents sont dénombrés selon les années. Chacun cible un public privilégié et chaque type de responsable a son Bulletin. Celui des Dirigeants de section, s’adresse aux responsables du mouvement et les outille pour faire vivre leurs sections. Le Bulletin fédéral de la JOC et celui de la JOCF s’adressent aux équipes régionales. Les dirigeants pré-jocistes[6] disposent également de leur bulletin. Les Notes de pastorale jociste s’adressent aux aumôniers qui assurent l’encadrement religieux du mouvement. De même, à chaque type de militant répond un périodique : Mon Avenir, pour les militants pré-jocistes, et En route pour les militantes pré-jocistes, Jeunesse ouvrière pour les militants jocistes, Joie et travail pour les militantes. Citons également Le jeune chômeur dont le but est précisé dans le sous-titre « journal de combat des sans travail », à savoir défendre les droits des jeunes frappés par la crise et les informer de leurs droits. Durant la Seconde Guerre mondiale, seuls quelques titres sont édités. Après-guerre, de nouveaux titres font leur apparition et cette variété perdure jusqu’à la fin des années 1960. Durant cette période, les titres suivent l’évolution sociologique des militant.e.s. Aux côtés des journaux s’adressant aux jeunes travailleurs tels que Notre action, le bulletin des responsables de « l’action au travail », apparaissent d’autres. Ceux-ci ciblent d’autres publics que sont les élèves des écoles techniques, les étudiants, les soldats… Souhaitant encadrer l’ensemble des aspects de la vie des militant.es apparaissent des titres comme, par exemple, Promesse, journal de préparation au mariage à destination des fiancé.es.

De plus, à ces journaux récurrents, s’ajoutent des titres ponctuels dont le but est de préparer les militant.e.s à certains événements. Citons, Nous irons à Rome ou En mission vers Rome, publiés en 1956 et 1957 visant à préparer respectivement les militants et les chefs d’équipes de la Jeune JOC au Congrès mondial de Rome, qui se tient en 1957. Autre exemple, des journaux spéciaux tels Révolution pour la JOC et Revivre pour la JOCF accompagnent les campagnes pascales.
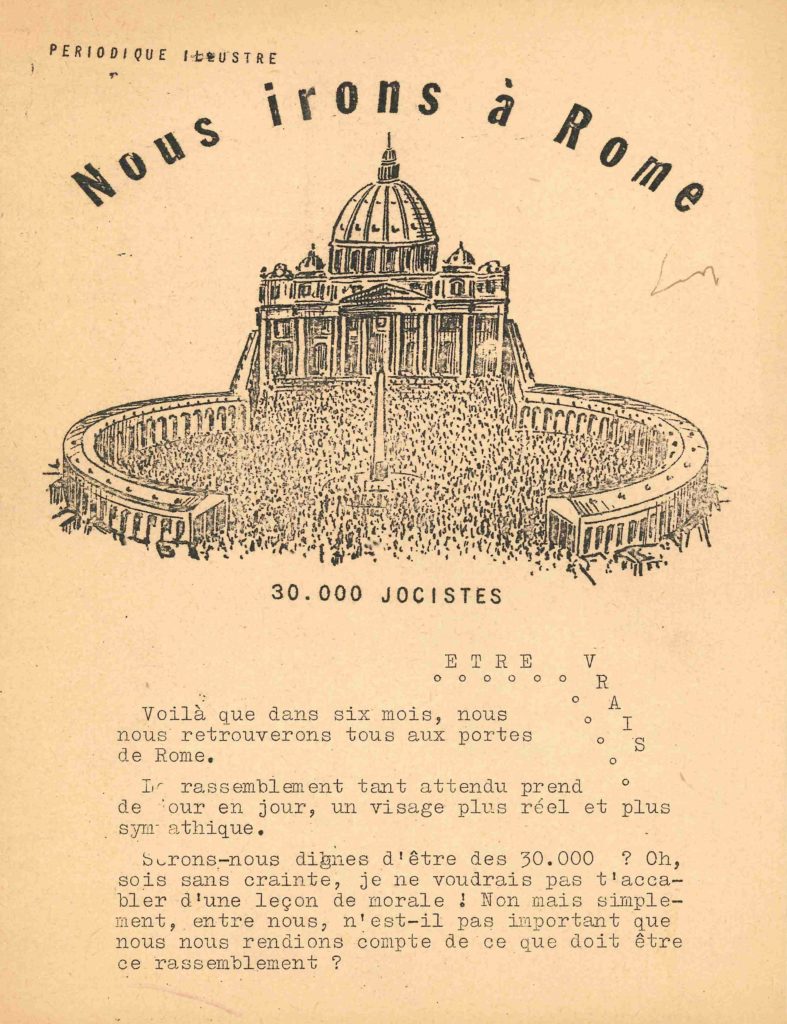
1970 – 2000 vers une diminution du nombre de titres
Au début des années 1970, à l’image du nombre d’affilié.e.s, le nombre de titres diminue fortement. Il s’agit d’une période de transition pour le mouvement : implication politique, distanciation avec le MOC, divisions internes, passage d’une organisation essentiellement ouvrière à un mouvement de jeunes…[7] Tout cela se ressent dans la production de périodiques, qui passe durant quelques années au second plan. C’est en moyenne deux à trois titres qui sont publiés simultanément, sans compter les éventuels périodiques locaux dont nous n’avons pas (encore) connaissance[8]. Il s’agit alors essentiellement de journaux destinés à faire le lien au sein du mouvement : informations générales, organisation d’événements…
Au début des années 1980, paraissent deux titres de périodiques qui seront publiés sur une longue période. Il s’agit, d’une part, de Trait d’Union (T.U.), pour la JOC, publié de 1981 à 2000[9] et, d’autre part, Film, publié par la JOCF de 1985 à 2009. Ces deux titres sont rejoints ensuite par Face A qui parait de 1989 à 2001, à l’initiative de la JOCF. Le Face A est une revue d’information qui a pour objectif de présenter un thème d’actualité d’une façon originale et simplifiée : « L’accent est mis sur la facilité de la lecture, la simplicité de la représentation par des illustrations. Le Face A veut amener les jeunes à réfléchir sur les enjeux qui caractérisent notre société, mais aussi leur permettre de découvrir les organes de presse en général »[10]. Chaque numéro traite d’un sujet spécifique au départ d’extraits de presse et d’articles rédigés en interne. Face A est publié jusqu’en 2009 ; il est ensuite remplacé par Info Kit car « les jeunes ne lisent pas la revue, les abonnés étaient essentiellement des adultes ». Info kit va alors cibler enseignants, formateurs, animateurs, parents…, « tous ceux qui sont en contact avec des jeunes ». Le contenu du journal se veut « branché sur la réalité des jeunes » afin de l’analyser et de donner des pistes d’action en appliquant la méthode jociste voir-juger-agir [11].
Le T.U. disparaît en 2000 et est remplacé par Zig-Zap, lui-même remplacé par Red’Action en 2009. Ce changement intervient en même temps qu’un changement de logo pour la JOC et se veut porteur des évolutions du mouvement. Enfin, depuis 2013, le journal de la JOC se nomme Organise-toi, en lien avec le changement d’appellation de l’organisation qui se nomme « Jeunes organisés combatifs », puis « Jeunesse organisée et combative ».
Focus sur le TU

C’est en octobre 1981 que parait pour la première fois le T.U. Par cette publication, la JOC souhaite « rompre avec les habitudes et souligner ainsi un changement ». Le choix du titre du périodique est explicité dans l’éditorial :
« À une époque où le “Moi” et le “Je” sont à l’honneur, c’est se montrer “à la page” que de s’appeler “Tu”. » Le souhait est de faire de ce périodique « un moyen d’échange, d’information et de confrontation réalisé par et destiné aux militants de la JOC, aux “sympathisants ”, aux “anciens du mouvement”, bref à tous ceux qui aspirent, se battent, luttent pour rendre leur vie moins conne, pour un autre mode de vie, pour un changement social… »[12].
Cet éditorial mentionne trois problématiques qui émailleront l’histoire du T.U. et qui avaient déjà questionné les rédacteurs des journaux jocistes dès les années 1960. D’abord, ce périodique doit permettre une communication large des expériences, des combats menés par les fédérations et les quartiers. Mais il doit aussi, voire surtout, faire le lien en interne entre l’équipe fédérale et les militants d’une part et entre l’ensemble des militants des différentes régions d’autre part. Ensuite, les équipes de rédaction mettent un point d’honneur à laisser une place la plus importante possible aux écrits des jeunes. Cependant, des demandes d’écrits professionnels sont formulées rapidement afin d’apporter des éclairages aux témoignages des jeunes et du contenu informatif à la revue. Enfin, les équipes de rédaction doivent trouver un équilibre entre la diffusion du vécu des jocistes, pour faire le lien, celles d’articles de fonds, pour former et informer et enfin celle de contenus plus légers, pour attirer et maintenir l’intérêt du lecteur… Un exercice peu évident, nous le verrons.
Au cœur du T.U. : les jeunes (lecteurs)
Jusqu’en janvier 1984, le T.U. est envoyé gratuitement à ceux et celles qui en font la demande et est distribué à cette date à plus de 640 adresses. À partir de janvier 1984, un abonnement est mis en place pour faire face au coût croissant de production. Souhaitant garantir l’accès à tous, plusieurs formules sont proposées. L’abonnement ordinaire est de 100 francs par an, l’abonnement de soutien, à 300 francs, et, pour les plus « démunis », le journal peut être envoyé gratuitement, sur simple demande[13]. En 1987, l’équipe de rédaction se félicite du nombre d’abonnés qui dépasse les 400.
Le maintien de ce lectorat est, dès le début, au centre des préoccupations des responsables de la publication et, dès le numéro 7, publié en octobre 1982, des réflexions sont menées et de nouvelles rubriques font leur entrée. Le numéro 14 de mai 1983 propose aux lecteurs de répondre à un questionnaire afin d’évaluer le journal et bien que de nombreux commentaires positifs aient été formulés, un T.U. nouvelle formule est édité en décembre 1983, marquant par ailleurs le passage de relais entre Jean Joye et Giorgio Casula en tant que rédacteur en chef.
Ce dernier est responsable de la publication de 33 numéros parus entre 1983 et 1987[14]. Il profite de l’éditorial de mars 1985 pour préciser les objectifs du T.U. « C’est aussi un journal de liaison, la JOC existe un peu partout dans le monde. Partout des jeunes se regroupent pour réfléchir ensemble sur leurs situations. Dans leur quartier, ville ou village, ils font des choses (actions, projets, animations…) et ils veulent les répercuter. Le T.U. sert à ça ! Parfois, sans le savoir, des groupes de différents coins font des choses sur un même problème. Parfois nous trouvons utile d’organiser des rencontres entre tous ces groupes afin de voir ce qui peut être fait ensemble. » Cette idée est reprise plusieurs fois dans les éditoriaux des années 1985 et suivantes. À cette volonté de faire du lien entre les jeunes du mouvement s’ajoute aussi celle de faire connaître le mouvement : « Partout où c’est possible nous racontons ce que nous vivons et ce que nous faisons à la JOC. Et c’est de plus en plus important car il faut montrer la valeur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons à la JOC. Des gens l’ont compris, ils s’ouvrent à nous, ils nous tendent l’oreille »[15]. L’éditorial du numéro 17 de janvier 1987 revient également sur ce point. Il ajoute que le public visé reste l’ensemble des « gens en relation avec la JOC », mais que ce périodique doit avant tout permettre une communication entre les jeunes des différents groupes et des différentes régions[16].

Cette volonté de faire du lien sera également l’élément central lorsqu’en 1991, Pascal Brachotte prend le relais de la coordination : « Je me suis rendu compte, assez vite, que le T.U. incarnait vraiment son nom, un trait d’union et que c’était notre Facebook ; on n’avait pas de téléphone et si on avait envie de communiquer et [de dire] le bonheur qu’on avait à militer, c’était à travers le T.U. que tu pouvais le communiquer aux autres de la JOC. Si tu avais envie de communiquer ta révolte, c’était aussi à travers le T.U. que tu pouvais le faire. […] je me suis rendu compte que c’était un outil et une arme importante, autant pour l’intérieur du mouvement que pour l’extérieur »[17]. Un outil également qui assure le lien entre les militants et augmenter le nombre d’abonnés « […] plus tu écrivais dans le T.U., au plus tu faisais écrire des jeunes, plus les jeunes avaient envie de s’abonner, plus ils avaient envie d’en faire partie et donc en fait c’étaient vraiment le trait d’union »[18].
Un journal écrit par les jeunes, pour les jeunes
Dès l’origine, le souhait est de donner la parole aux jeunes à tous les jeunes, même à ceux que l’écriture effrayait, comme l’explique Pascal Brachotte en parlant de sa propre expérience : « Le français et l’écriture, ce n’était pas mon truc. J’avais peur des mots. En fait, comme je ne savais pas écrire sans faute, je n’osais jamais écrire, […] j’étais gêné […] le T.U. m’a donné la possibilité de me raconter et je pense que j’ai découvert que j’étais capable d’écrire des trucs et que cela me plaisait bien […] elle [la responsable du T.U.] corrigeait les trucs et on s’en foutait, c’était les jeunes qui écrivaient et elle qui corrigeait. Et donc il n’y avait aucun jugement, tu pouvais envoyer ton texte tel quel »[19].
Impliquer les jeunes dans le processus d’élaboration de la revue et dans la construction de contenus, confère une fierté aux jeunes et leur donne envie de s’impliquer comme en témoigne Pascal Brachotte « Le fait d’accrocher au Trait d’Union, c’est accrocher à la fédération, c’est accrocher à la JOC, c’est accrocher à la responsabilité et donc les jeunes se sentent plus responsables. Dans un parcours de formation de militants, si je voulais qu’ils accrochent à leur groupe de base, le T.U. étais un outil fabuleux. Le T.U. c’est le Facebook de notre époque. »[20]. L’utilisation du périodique comme outil d’animation par les permanents au sein de leurs groupes participe également à accroître l’intérêt des jeunes pour cette revue. Des articles du T.U. sont alors parfois amenés par les jeunes dans les écoles ou d’autres lieux qu’ils fréquentent pour alimenter les réflexions.
En 1991, après dix ans d’existence, le nombre d’abonnés ne s’élève plus qu’à 250. Dès lors, le début de cette décennie va être mis à profit pour relancer le périodique. Des réflexions sont entamées pour refondre le journal. Les objectifs poursuivis semblent faire l’unanimité et se placer dans la continuité : « Le T.U. est un moyen d’expression pour les jeunes du mouvement (ce qui implique un look approprié), un moyen d’information et de formation (destiné aux acteurs du mouvement), une vitrine du mouvement (ce qui implique une cohérence au niveau du contenu et finition dans la présentation) »[21]. La JOC souhaite également assurer un meilleur encadrement des numéros. Une équipe de coordination, composée du permanent national, des deux employés du T.U. et de trois ou quatre militants ou permanents, est mise en place au niveau national. Elle établit le sommaire, vérifie l’adéquation des articles avec les objectifs de la revue, veille « au look jeune, à la qualité de la mise en page et illustrations » … Au niveau fédéral, il est demandé de suivre l’écriture et le contenu des articles, ainsi que d’assurer le suivi des abonnements et leurs renouvellements[22].
Des changements sont tentés dans la forme comme dans le fonds pour essayer de relancer le T.U. Le périodique parait sur papier recyclé en février et mars 1992, mais ce support ne fait pas l’unanimité. En mars 1992, la couverture est faite de papier glacé. En 1993, des phrases chocs sont mises en exergue dans les articles en s’inspirant du ton acerbe du magazine co-créé par Thierry Ardisson, Entrevue, « pour que les gens aient envie de lire l’article »[23].
Des innovations en termes de contenu sont tentées également avec l’introduction de jeux, de bandes dessinées… De nouvelles rubriques telles que la boite à outils, bulle d’air, humour, cinéma, musique font leur apparition… autant de rubriques ayant déjà été utilisées dans le T.U. au milieu des années 1980 et qui disparaissent et apparaissent au gré des modifications du lectorat ou de l’équipe de coordination.
Plusieurs hors-séries centrés sur la revue et son fonctionnement sont intégrés aux numéros afin de promouvoir la revue, présenter la JOC, présenter l’équipe responsable et surtout inciter les jeunes à participer et produire des articles. En juin 1992, le hors-série « « T.U. n’a pas peur de la vérité, « T.U. » ne censure pas, « T.U. » est vivant… » explique : « Tu en connais beaucoup toi, des revues écrites par les jeunes, pour les jeunes et entre les jeunes ? C’est une évidence : ce genre de revue ne court pas les rues ! Et pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup pensent que les jeunes n’ont rien à dire, qu’ils ne sont pas suffisamment responsables. Depuis des années les jeunes de la JOC prouvent le contraire. Ils s’expriment par l’intermédiaire du Trait d’Union. » Un second hors-série est publié en avril 1994, à l’occasion d’une refonte du journal.
1994 : Campagne pour le T.U.
Les années 1993 et 1994 marquent une période de grande réflexion pour l’avenir du journal. 1994 est également marquée par l’« action 94 », campagne durant laquelle les jocistes ont sillonné les communes de Wallonie pour faire entendre leurs revendications.

Le T.U. se fait alors le relais pour l’organisation des événements, le porte-parole des revendications portées par l’action et le réceptacle des témoignages des jeunes, acteurs de cette mobilisation. À cette occasion, le journal fait peau neuve, pour suivre le mouvement : nouvelle mise en page de la couverture, nouveau look intérieur et l’équipe de rédaction évolue. La participation des jeunes repose souvent sur les épaules du responsable régional : plus celui-ci est convaincu par l’utilité de l’écrit en général et du T.U. en particulier, plus les jeunes de cette région participent. Comme en témoigne Pierre Tilly, permanent à Mons et membre de l’équipe de coordination du T.U., dans son « Programme de survie pour le T.U. » : « La grande originalité du T.U., c’est qu’il repose sur l’envie des jeunes d’écrire ce qu’ils pensent, ce qu’ils vivent, ce qu’ils dénoncent. Ce qui nous donne un journal aux multiples facettes, d’une grande variété et d’une grande richesse. Seulement voilà, tout cela est bien beau, mais cela foire à partir du moment où on dépend du bon vouloir et du rythme de travail des jeunes et des permanents qui ont curieusement d’autres chats à fouetter »[24]. C’est ainsi qu’en fonction des périodes et des mandats des permanents, certaines fédérations telles que La Louvière, Verviers, Liège ou encore le Brabant wallon[25] sont davantage représentées que d’autres.
Si la force du T.U. réside dans sa capacité à « faire parler les jeunes », c’est là aussi que se trouve sa plus grande faiblesse. En effet, au regard de la diversité des articles produits, le T.U. est parfois perçu comme « une foire aux articles » qui disent la même chose en restant dans le ressenti et le sentiment, sans entrer dans une analyse étayée de la réalité[26]. Cependant, lorsque le T.U. se veut plus informatif, il lui est reproché de faire « double emploi avec le Face A [revue d’information] et ses dossiers thématiques », des commentaires demandent de choisir entre « un journal d’expression des jeunes » et un journal de « formation des jeunes »[27].
En 1994, pour « sauver le T.U. du naufrage et lui éviter de rejoindre le cimetière des journaux trop tôt disparus », Pierre Tilly propose de mettre sur pied une équipe de rédaction se réunissant une fois par mois pour discuter du contenu du journal, évaluer les numéros précédents [28]. Ce sera fait quelque temps plus tard. Une équipe de journalistes, composée de militants jocistes volontaires, est également mise en place. La JOC se procure une authentique carte de presse : en échange des avantages que celle-ci octroie (entrée gratuite dans de nombreux événements), les journalistes s’engagent à rédiger au moins un article par numéro. À leurs côtés, des correspondants régionaux doivent assurer le relais régional, rechercher des articles…
En 1995, une « Campagne TU » est mise en place. Elle donne lieu à la création d’un stand de présentation organisé lors des événements de mouvements proches. Elle renforce la communication autour du périodique. De plus, face aux difficultés des jeunes d’écrire, la JOC organise un week-end de formation avec en invités/formateurs Luc Gilson, journaliste à RTL TVI et Steeve Roosemont, permanent JOC du Brabant Wallon, surnommé « l’écrivain fou du BW »[29]. Un concours est également organisé et permet, grâce aux articles réalisés durant l’année, à la fédération de Verviers de remporter une télévision et un lecteur de vidéocassettes ainsi qu’a un jeune de bénéficier de deux places de concert à Forest National [30].

De plus, comme précédemment mentionnée, la réussite du journal tient également aux personnes qui le portent. Les réunions de coordination de la revue témoignent de la distance qui s’installe à la fin des années 1990 entre la coordination du T.U. et les régions. Le périodique n’est plus utilisé, comme l’explique Pascal Brachotte : « Cela a été compliqué par ce qu’on n’avait plus de relais en région, j’ai ce souvenir des permanents qui n’étaient plus dans l’écrit et n’accrochaient plus […]. Si le permanent de la région n’accorde pas de l’importance à son périodique, les jeunes ne vont pas y accorder de l’importance non plus, c’est automatique. Une revue ne peut pas venir de la nationale en disant simplement : « abonnez-vous » ; si la région et le permanent ne font pas le relais, la revue est condamnée à mourir et je pense que c’est ce qu’il s’est passé, à un moment donné, il y a eu une forte diminution. Et on a essayé de relancer parce qu’on a retrouvé des permanents qui étaient accrochés »[31].

En 1996, des réflexions sont menées autour du nom de la revue, en vue de dynamiser le journal[32]. Celui-ci restera le T.U. jusqu’en 2000. Un ultime changement de format est effectué en 1997. Publié jusqu’à présent sous forme de cahier au format A4, le T.U. prend la forme d’un journal format A3, doté de pages à découper pour former « une boite à outils » ; de nouvelles rubriques s’ajoutent avec, par exemple, l’introduction de la rubrique « les vieux racontent », qui donne la parole à d’anciens jocistes…
Malgré ces changements, seuls cinq numéros sortent en 1998, 1999 et 2000 et comportent trop peu d’articles au regard de certains militants comme le signale Christian David de la fédération de Couvin-Walcourt qui raconte sa première rencontre avec le journal trois ans auparavant lors du week-end T.U. : « Au premier abord, tu [le journal T.U.] me plaisais, tu avais des couleurs, tu n’étais pas trop gris et de l’intérieur, tu paraissais intéressant et passionnant, comme je n’avais jamais vu ailleurs. Aujourd’hui, tu [le journal T.U.] as grandi [le journal a changé de format], tu as pris plus de couleur, mais il me semble que tu perds de plus en plus de poids et mes amis me le disent aussi. » Ce constat amène à Gene de Verviers cette réflexion publiée dans le T.U. de novembre 1998 : « Enfin, se passe-t-il encore quelque chose ou les gens sont-ils tellement occupés dans leurs régions respectives qu’ils n’ont plus le temps d’écrire et de tenir les autres au courant de ce qu’ils font ? C’est sûrement cela !!! ou alors, une autre éventualité, à voir nos factures de Belgacom, c’est peut-être la nouvelle ère du GSM qui fait qu’on devient paresseux et qu’il est plus facile de se transmettre les infos de cette façon ». La situation est alarmante, comme le fait remarquer Frédéric Jacquemart, éditeur responsable, dans un courrier adressé aux fédérations : « Urgent, Le T.U. est en danger, non seulement par manque d’abonnés, mais en plus par manque d’articles ! Le journal n’est pas représentatif de ce qu’est le mouvement, et il ne le sera pas avec seulement 2 FD [2 fédérations qui rédigent des articles] »[33].
Un périodique disparaît… Un autre le remplace

Le T.U. n° 169 de juillet-août 2000 est le dernier. Mais, la JOC ne peut laisser ce vide. Apparaît en 2001 Zig Zap. Durant ses premiers numéros, celui-ci diffère du T.U. Premièrement par sa forme, publié en noir et blanc sur feuilles A4 agrafées et précédée d’une couverture sur une feuille de papier coloré. Deuxièmement, au niveau du fonds, cette « feuille de liaison » donne, à ses débuts, sous forme de brèves au ton décalé des informations variées sur le mouvement, les permanents, les activités menées dans les différentes régions. Cependant, dès 2002, le ton change et se fait plus sérieux, moins de blagues internes et plus d’articles de fonds. Il se rapproche de son prédécesseur, le T.U., au niveau de son contenu. En 2009[34], l’édito du Zig Zap est sans appel : « Vous tenez en main ce qui devrait être le dernier Zig-Zap ». Il est alors remplacé par Red’action. Ce changement intervient en même temps qu’un changement de logo pour la JOC et se veut porteur des évolutions du mouvement.

Les motivations reprennent alors des arguments plusieurs fois entendus dans l’histoire des périodiques JOC : « Faute de moyens, notre trimestriel était devenu, par la force des choses, l’égal d’un bulletin paroissial. Insuffisant pour la JOC (dont le fondateur Cardijn est présent sur notre couverture). Plus qu’une feuille de liaison entre fédérations, notre revue devait s’ouvrir vers un nouveau public. Un public-non-jociste, ouvert, … Une ouverture nécessaire à la survie de l’organisation. Pour toucher ce public, un seul moyen : écrire sur des sujets de fonds, des sujets susceptibles d’intéresser le plus grand nombre »[35]. Des techniques déjà tentées aux cours de décennies précédentes sont reprises : textes écrits par les jeunes aux côtés de textes de fond, articles sur les activités et actions du mouvement et dossiers thématiques détachables sur des thématiques d’actualité : sécurité sociale en Belgique, désobéissance civile, attitude à adopter en cas d’agressions policière… À cela s’ajoutent des textes de chansons et articles de réflexions politiques… Pour en faire un « vrai périodique »[36]. Mais qu’est-ce qu’un « vrai périodique » car lorsque l’on y regarde de plus près Red’action reprendra les recettes de ces prédécesseurs et, de manière cyclique, les fera évoluer.

Aujourd’hui le « journal » de la JOC se nomme Organise-toi. Publié depuis 2013, il est accessible en ligne. À ses côtés, prend place également une page Facebook. Pour les rédacteurs, les questions et problèmes rencontrés par le T.U. restent toujours d’actualité : comment assurer le lien entre les lecteurs et leur journal, comment laisser une place importante à la parole des jeunes tout en proposant également des articles de fond aux tonalités professionnelles, comment attirer le lecteur sans tomber dans le travers des journaux grand public de divertissement pur. À ces questions, s’ajoutent aujourd’hui celle de l’abandon des formats papier pour les versions numériques et la cohabitation de ce média avec les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et d’autres formes de communication (podcast, vidéo, « réels » …). Au travers de ces changements de support, c’est plus largement la question de l’adéquation entre la méthode de communication et les publics visés qui se pose.
Notes
[1] À l’origine « Jeunesse syndicaliste », l’organisation prend le nom de « Jeunesse ouvrière chrétienne » en 1925. Aujourd’hui, elle porte le nom de « Jeunesse organisée et combative ».
[2] Nous renvoyons sur ce point à l’article d’Émilie Arcq dans ce même numéro de Dynamiques.
[3] En effet, parmi les périodiques recensés actuellement, peu de productions des sections locales de la JOC apparaissent, or celles-ci ont également été actives au travers de ce médias. Dès lors, de nouveaux titres pourraient allonger cette liste au gré des inventaires des archives des fédérations JOC.
[4] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « Dossier J.O. Préparé par la commission J.O. Les 29 décembre 77 et 18 janvier 78 et présenté à la rencontre des permanents des 31 janvier et 1er février 78 », 1978.
[5] « En décembre 1924, La Jeunesse ouvrière à l’ambition de parvenir à 5.000 abonnements. Un concours lancé en 1928 met en valeur les sections et les jocistes qui en diffusent le plus. En avril, le journal tire à 8.000 exemplaires et son numéro spécial de 1929, à 130000. Joie et Travail imprime en 1925 quelques centaines d’exemplaires. Le tirage de son édition spéciale de juillet 1929 grimpe à 100000 ». BRAGARD L., FIEVEZ M. et JORET B. et al., La Jeunesse ouvrière chrétienne Wallonie Bruxelles, 1912-1957, tome I, Bruxelles, Vie ouvrière, 1990, p.117.
[6] Les sections pré-jocistes accueillent les jeunes avant leur entrée dans le monde du travail ou lors de leurs débuts.
[7] Pour une histoire de la JOC à cette période, lire : WYNANTS P. et VANNESTE F., « Jeunesse ouvrière chrétienne », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. 27, Paris, Letouzey, 1999, p. 1254-1280, extrait disponible en ligne : https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/38405971/JOC_120.pdf, page consultée le 02 septembre 2024.
[8] Les archives de la JOC nationale ont été déposée au CARHOP et sont en cours d’inventaire. À terme celui-ci sera disponible sur la base de données : https://carhop.lescollections.be/ sur laquelle le lecteur pourra déjà consulter une grande partie des inventaires des archives d’anciens jocistes ainsi qu’une partie de la collection iconographique du mouvement en cours de numérisation.
[9] Il ne faut pas confondre le T.U. des années 1990 avec son prédécesseur Trait-d’union paru à partir de février 1948 et de manière irrégulière jusqu’au début des années 1950 avec pour sous-titre « Bulletin des équipiers fédéraux de la JOC ».
[10] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « De face A à l’Info kit quelques suggestions pour le prochain numéro », s.d. circa 2009.
[11] Ibidem.
[12] JOYE J., « Éditorial », dans T.U., n° 1, octobre 1981, p.1.
[13] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, T.U., n° 17, janvier 1984, p. 4.
[14] Giorgio Casula sera éditeur responsable de 33 numéros publiés entre 1983 et 1987, Rocco D’Amore de 23 numéros entre 1988 et 1990 et Pascal Brachotte de 49 numéros entre 1991 et 1996. Les autres éditeurs responsables n’auront que quelques numéros à leur actif.
[15] CASULA, Giorgio, « Éditorial », dans T.U., n° 30, avril 1985, p. 1.
[16] CASULA, Giorgio, « Éditorial », dans T.U., n° 17, janvier 1984, p. 1.
[17] CARHOP, Interview de Pascal Brachotte, réalisée par Camille Vanbersy le 28 août 2024.
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, note « Topo sur le fonctionnement actuel du T.U. », 3 juin 1991.
[22] Ibidem.
[23] CARHOP, Interview de Pascal Brachotte, réalisée par Camille Vanbersy le 28 août 2024.
[24] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, “Programme de survie pour le T.U.” réalisé par Pierre [Tilly], Mons, le 5 septembre 1994.
[25] Citons par exemple Pierre Tilly pour Mons, Fred Jacquemart pour Verviers, Steve Roosemont, surnommé l’écrivain fou du BW, pour le Brabant Wallon, ou encore Pascal Brachotte pour La Louvière.
[26] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, Rapport de la réunion de coordination du T.U. du 4 septembre 1992.
[27] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, Rapport de la réunion de coordination du T.U. d’octobre 1992.
[28] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « Programme de survie pour le T.U. » réalisé par Pierre [Tilly], Mons, le 5 septembre 1994.
[29] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « Plan du week-end “J’écris ton nom liberté” », circa 1994.
[30] BRACHOTTE P., « Campagne T.U. », dans T.U., 133, janvier 1996, p. 27.
[31] CARHOP, Interview de Pascal Brachotte, réalisée par Camille Vanbersy le 28 août 2024.
[32] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « Farde T.U. 95 », Lettre de la coordination du T.U., datée du 4 novembre 1996.
[33] CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « Farde T.U. », lettre de Fred [?], datée du 31 janvier 1998.
[34] L’année 2009 marque également la fin de Face A, remplacé ensuite par Info Kit car « les jeunes ne lisent pas la revue, les abonnés étaient essentiellement des adultes ». Info kit va alors cibler les enseignants, les formateurs, animateurs, parents… « tous ceux qui sont en contact avec des jeunes » cet outil, axé sur un thème précis, doit « être branché sur la réalité des jeunes, de l’analyser et de donner des pistes d’action en essayant d’appliquer la méthode JOC : Voir-juger-agir [sic] » CARHOP, Fonds d’archives de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) nationale, non inventorié, « De Face A à l’Info kit quelques suggestions pour le prochain numéro », s.d., circa 2009.
[35] « Edito », dans Red’action, n° 1, janvier, février, mars 2009, p.1.
[36] Ibidem.
Pour citer cet article
VANBERSY C., « Le périodique, outil de propagande, de formation et Trait d’Union entre les jocistes et la JOC ? », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 24 : Lire pour lier!, octobre 2024, mis en ligne le 17 octobre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/
De L’Équipe Populaire à Contrastes : Un trait d’union entre le mouvement et ses affiliés
Monique Van Dieren
Permanente aux Équipes Populaires de 1978 à 2022, responsable des publications.
En presque 80 ans d’existence, le mouvement « Équipes Populaires » (EP) a publié une pléthore de journaux et revues. Comme la plupart des publications associatives, celles-ci ne s’adressent pas prioritairement à des « lecteurs » ou des « abonnés », mais à des « affiliés » à un mouvement auquel ils sont généralement très attachés. Ils ont donc des attentes spécifiques et parfois très fortes vis-à-vis des publications.
L’objet de cet article n’est pas d’analyser l’évolution du contenu des publications des Équipes Populaires, mais de jeter un regard sur la manière dont elles ont répondu (ou pas) aux attentes du mouvement et de ses affiliés. Nous aborderons également les questions et défis auxquels l’équipe de rédaction a été confrontée au cours des 40 dernières années.
De manière plus générale, nous pensons ne pas nous tromper en disant que toute publication associative a été ou est confrontée aux questionnements suivants : à quoi et à qui sert-elle ? Quels liens entretient-elle avec ses lecteurs/affiliés, et dans quelle mesure est-elle capable de s’adapter pour répondre à leurs attentes parfois antagonistes ? Plus récemment, une autre question s’est invité dans les débats du comité de rédaction : comment concilier les exigences du décret sur l’éducation permanente de 2003 avec les caractéristiques d’un lectorat populaire ?
Le cadre historique
C’est en 1947 que quelques militants et responsables actifs dans les organisations ouvrières du MOC décident de créer le mouvement « Les Équipes Populaires ».
« Des militants chrétiens du milieu populaire, consacrant leurs loisirs de travailleur et de père de famille à une organisation ouvrière (syndicat, mutuelle…) ont constaté une lacune dans leur vie […]. D’autres ont regretté une insuffisance de formation religieuse »[1] . Des lieux de rencontre et de réflexion émergent d’abord à Liège, puis partout en Wallonie et à Bruxelles, pour répondre aux besoins éprouvés de ces militants : réfléchir et débattre sur des problématiques familiales ou professionnelles, ainsi que sur le sens de leur engagement de militant chrétien.
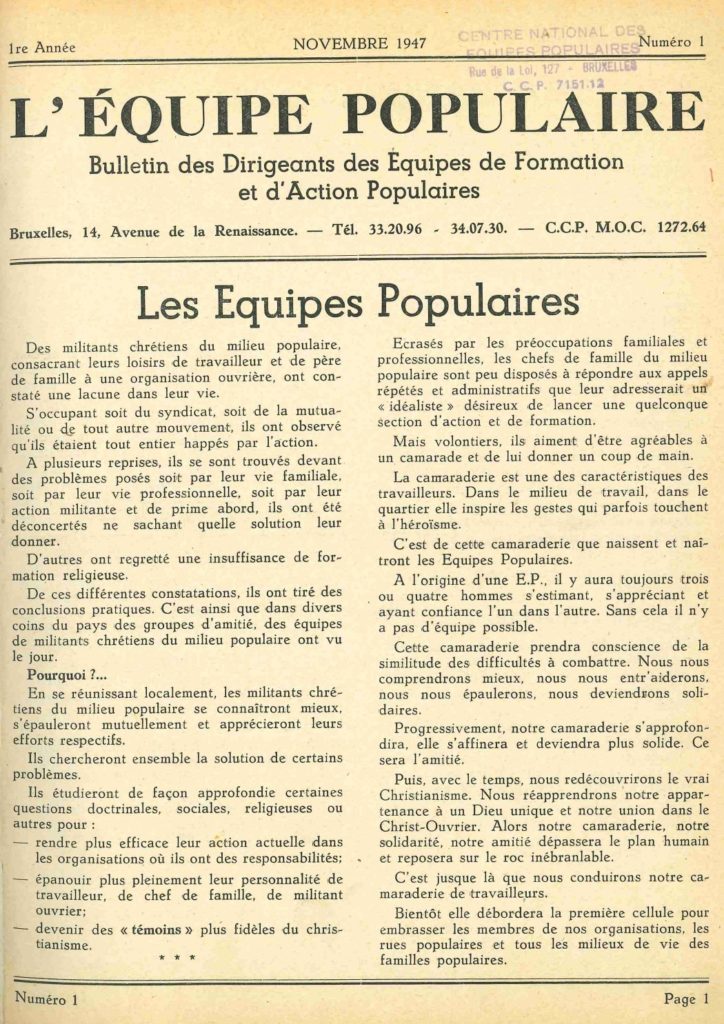
Dès novembre 1947, le premier numéro de L’Équipe Populaire est édité. C’est un bulletin mensuel destiné aux « Dirigeants des Équipes de Formation et d’Action Populaires ». Celui-ci propose des courts articles de réflexions personnelles, des suggestions pour l’animation des réunions, des conseils pour toucher un public plus large, des témoignages sur les conditions de travail ou la vie familiale… Son public cible : les hommes adultes (à cette époque, il y avait la Jeunesse ouvrière chrétienne pour les jeunes et la Ligue ouvrière chrétienne féminine pour les femmes), membres d’organisations du MOC et leurs proches, ainsi que les milieux paroissiaux. Il est important de souligner la proximité avec les institutions religieuses et la foi chrétienne fortement ancrée des initiateurs du mouvement Équipes Populaires.
Le mouvement change, ses publications aussi
Très progressivement, le mouvement prend ses distances avec l’institution religieuse, même si ses militants restent pour la plupart de fervents chrétiens engagés. À partir des années 1970, le pluralisme fait une discrète entrée dans le mouvement ; celui-ci se positionne davantage comme un mouvement d’éducation permanente que comme un lieu de réflexion de sens et de foi. Il cherche à élargir et diversifier son public. À partir des années 1980, le mouvement s’ouvre à la mixité, prend ses distances vis-à-vis de l’Église et se déclare pluraliste en 2001[2]. Toutes ces évolutions modifient la physionomie et le contenu des publications au cours des 40 années qui suivent, mais brouillent aussi les cartes quant à la stratégie éditoriale à adopter[3].
Dès le début des années 1980, le dilemme se pose et les débats sont récurrents (en comité de rédaction surtout) par rapport au public cible et aux objectifs du journal du mouvement[4]. Doit-il être un bulletin de liaison, un outil d’animation et de réflexion interne (à destination des membres actifs) ou, au contraire, un outil de promotion du mouvement, c’est-à-dire ouvert à des problématiques plus larges, plus variées, susceptibles d’intéresser un nouveau public ? Ou les deux simultanément ?
Cette tension persiste durant une bonne vingtaine d’années (nous y reviendrons). Elle trouve en 2005 une issue qui semble jusqu’à ce jour satisfaire la grande majorité des affiliés/abonnés : séparer les dossiers thématiques de fond (Contrastes) et les informations relatives à la vie locale et institutionnelle du mouvement (La Fourmilière), les deux publications étant adressées à l’ensemble des affiliés et abonnés[5], mais pouvant aussi être diffusées séparément.
|
les périodiques de EP au cours du temps Novembre 1947. Premier numéro du journal mensuel « L’Équipe Populaire-Bulletin des Dirigeants des Équipes de Formation et d’Action Populaires ». Il contient des courts articles de réflexions personnelles, des suggestions pour l’animation des réunions, des témoignages, des conseils pour recruter de nouveaux membres… Janvier 1987. Changement de titre et de présentation. « « L’Équipe Populaire » devient « EP-Magazine ». C’est une revue mensuelle format A4, qui contient à la fois un petit dossier thématique et l’actualité du mouvement. Janvier 1993. « EP Magazine » » devient « Contrastes ». Il est toujours mensuel et le contenu reste similaire (un dossier thématique et l’actualité du mouvement). Janvier 2005. Contrastes se divise en deux publications distinctes. Contrastes devient un dossier thématique à part entière et La Fourmilière devient le bulletin de liaison des affiliés, qui se fait l’écho des activités du mouvement. Les deux publications sont bimestrielles et envoyées à tous les affiliés et abonnés. Parallèlement à ces publications qui s’adressent à tous les affiliés, une publication spécifique pour les animateurs des groupes est éditée dès 1950 : Responsables (de 1950 à 1980), qui s’appellera ensuite Intersections et Outils. Depuis cette date, les bulletins périodiques sont remplacés par des fiches ou des cahiers d’animations dont la périodicité est variable. |
Une publication associative, pour quoi ? Pour qui ?
Renforcer l’adhésion et la cohésion
Pour un mouvement associatif comme les EP, le journal représente une tribune pour faire connaître ses valeurs et ses combats auprès de ses militants et affiliés, et pour renforcer un sentiment d’appartenance. Cette fonction de cohésion était particulièrement forte et importante dans les premières années d’existence des EP, lorsqu’il s’est agi d’affirmer sa place et son rôle dans le monde chrétien associatif.
Le journal[6] est également une vitrine de la vitalité du mouvement, de la multiplicité de ses activités, de la diversité de ses terrains d’action. Il contribue à renforcer l’adhésion, suscite l’envie d’agir. C’est un élément qui contribue à la satisfaction d’appartenir à un mouvement, qui se bat pour la justice sociale et qui est « faiseur de droits ». Ce sentiment de fierté est régulièrement exprimé par les affiliés.
Il est important de souligner que les publications des EP ne sont pas conçues de manière autonome par une équipe éditoriale qui choisit librement les thématiques des dossiers, mais elles répondent généralement aux enjeux et thématiques que le mouvement inscrit dans son plan d’action. De ce fait, les publications, et en particulier les dossiers pédagogiques, ont pour objectif de servir de support d’animation et de réflexion pour les groupes locaux.
« Notre soirée a été entièrement consacrée au sujet des immigrés. La base de réflexion fut le n° de l’EP de janvier. Nous pouvons dire que nous avons pu tirer un maximum de cette soirée grâce aussi et surtout au journal qui était particulièrement réussi. »[7]
« Au cours des 3 dernières réunions, nous avions choisi d’analyser le problème de l’endettement du Tiers-monde en nous aidant du dossier du journal EP de janvier. Nous avons pu apprécier l’excellente valeur de ce dossier, sa présentation, l’équilibre du texte et la profondeur de recherche. […] Nous vous encourageons à travailler dans ce sens afin de garder au journal une bonne valeur pédagogique et de rester un très bon outil de propagande pour le mouvement. »[8]
Aujourd’hui encore, certains groupes utilisent la revue Contrastes comme outil d’animation. Par exemple, un groupe de la région montoise, « les amis de Contrastes », parcourt chaque mois de manière collective un article avec un public peu habitué à la lecture, en vue d’amorcer un débat sur le thème choisi.
Cependant, cette attente d’une revue « à usage interne » entre régulièrement en conflit avec l’objectif de faire connaître le mouvement à un plus large public.
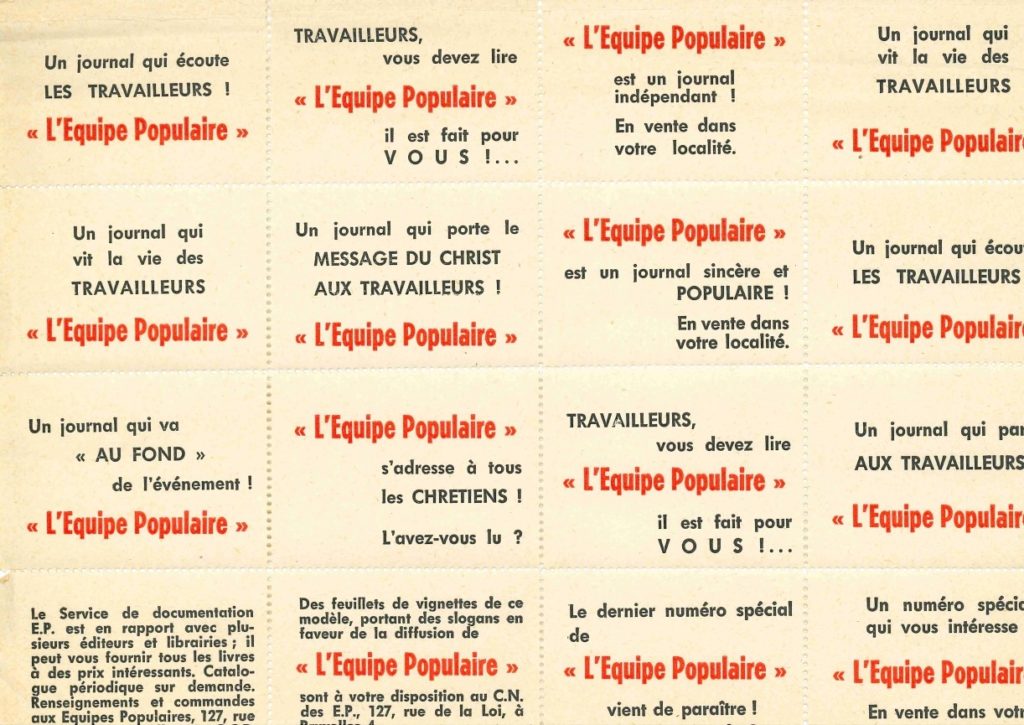
Un outil de propagande et de visibilit
Vignettes autocollantes destinées à la promotion de l’Équipe Populaire dans les années 60. Source : Matériel de propagande de l’Équipe Populaire, 1969, farde 1288
Une publication associative a également pour objectif de toucher de nouvelles personnes susceptibles d’adhérer au mouvement et d’élargir son réseau de militants et sympathisants. Dès la création du mouvement, le journal des EP a été un outil de « propagande » efficace, a fortiori s’il était accompagné d’un contact personnel. Différentes stratégies de diffusion ont été tentées pour cibler l’environnement proche ou plus éloigné des affiliés.
La plus ancienne est celle des « tableaux de rayonnement », qui a pris des formes différentes au fil des ans. Chaque équipe était chargée de compléter annuellement un formulaire, un mentionnant le nom des affiliés, des participants réguliers ou occasionnels non membres, des sympathisants rencontrés lors d’activités élargies, des personnes de leur entourage, et enfin des anciens membres. Il était demandé aux animateurs locaux de contacter ces personnes pour leur proposer de rejoindre l’équipe ou à minima de recevoir le journal.
Des numéros étaient également déposés en grande quantité dans certaines paroisses et salles d’attente des bureaux syndicaux ou mutuellistes. Par ailleurs, un numéro spécial à grand tirage était édité chaque année et ciblait un public particulier : les milieux paroissiaux (dans les années 1950 à 1980), les organisations syndicales, l’enseignement, etc. Cette pratique se poursuit aujourd’hui par une large diffusion sur l’espace public des dossiers édités dans le cadre des campagnes de sensibilisation.
La publication est également une carte de visite qui contribue fortement à la notoriété d’une association dans le milieu socioculturel. La rigueur des analyses et l’attractivité de la présentation sont donc fondamentales pour son image et sa crédibilité.
Comment connaître les attentes des lecteurs et y répondre ?
Dans les années 1980 et 1990, une question récurrente se pose au comité de rédaction : comment dans une seule publication cohérente, articuler une revue « à usage interne », un outil de formation renforçant la cohésion du mouvement avec un outil à usage externe renforçant la visibilité du mouvement ? En d’autres mots, comment satisfaire à la fois les affiliés, mais aussi un public plus large d’abonnés potentiels ?
Différents moyens ont tenté d’évaluer les attentes des lecteurs et ajuster le contenu des publications : enquêtes de satisfaction, courriers des lecteurs, débats au sein du comité de rédaction et dans les instances, contacts informels avec les militants… Malgré une certaine uniformité dans le profil des lecteurs (principalement des affiliés membres des équipes locales), la plus grosse difficulté était de répondre à des attentes très différentes : certains étaient en demande de dossiers d’analyse, tandis que d’autres s’intéressaient davantage à la vie du mouvement, aux activités des groupes locaux. Et les nouveaux membres n’avaient pas les mêmes attentes que les militants les plus engagés du mouvement.
Ces types d’attentes très différentes ont eu un impact sur la politique des publications :
-
- création de bulletins spécialement destinés aux responsables dès 1951 ;
-
- réalisation de dossiers de contenu plus étoffés dans l’Équipe Populaire (devenu ensuite EP Magazine en 1987 et Contrastes en 1993) ;
-
- diversification des thématiques des dossiers ;
- séparation de Contrastes en deux publications distinctes : Contrastes et La Fourmilière en 2005.

Nous avons relevé dans les archives (et dans notre mémoire) quelques moments de tensions entre les attentes des uns et des autres.
En 1983, le comité de rédaction décide de modifier la présentation du journal et de diversifier les thèmes des dossiers en vue de toucher un public plus large. Des réactions négatives s’expriment de la part de plusieurs groupes suite à une nouvelle mise en pages et au thème du premier dossier, qui fait polémique (L’Équipe Populaire de janvier 1983, dont le dossier de 4 pages était consacré… à la radiesthésie. Voir encadré Courrier des lecteurs).
La diversification des thématiques abordées en vue toucher un nouveau public ne laisse pas indifférent. Le comité de rédaction de juin 1983 fait l’évaluation de la manière dont cette évolution est perçue :
« Certains ont l’impression que ce n’est plus le journal du mouvement et sont réticents au fait que le journal n’aborde plus uniquement des sujets militants. […] Ceux-ci attendent du journal un lieu où s’expriment les options du mouvement par rapport à une série de sujets (attente d’un journal plus « doctrinaire »). D’autres (en général plus jeunes) sont favorables à une diversification des sujets, qui sortent des sentiers battus. Cela peut être interprété comme une recherche d’alternatives sur d’autres terrains du mouvement ouvrier actuel »[9].
En 1984, le comité exprime à nouveau cette difficulté de concilier les attentes entre anciens et nouveaux affiliés et entre générations. Après la publication du dossier intitulé « Église en monde ouvrier : Des travailleurs disent leur foi », il constate la « difficulté de présenter quelque chose qui plaise à tout le monde. La preuve : le journal de décembre a été en général très apprécié par les « moins jeunes » du mouvement (le meilleur de l’année selon eux), mais pas tellement par les jeunes adultes (c’est tout à fait dépassé, on ne se sent pas concerné). Donc, il faut tenir compte de deux publics très différents dans le mouvement » [10].
Deux changements de nom
En 1987, l’Équipe Populaire change de nom et de format et s’intitule désormais EP Magazine. Ce changement est justifié par le coût et la vétusté de la formule « Journal ». Le choix s’est porté vers une revue A4, à tirage plus limité, principalement destiné aux affiliés, avec un contenu plus interne, avec cependant un petit dossier thématique de quatre pages.

À partir de janvier 1993, nouveau changement de nom. L’EP Magazine devient Contrastes, dans une volonté de s’adresser à un public plus large. Mais le constat est amer : « L’effort fait au niveau de la mise en pages et du contenu n’est pas payant en termes d’abonnements. La question de la promotion interne est donc vitale. La diminution reflète-t-elle la décrépitude du mouvement ou une négligence des fédérations qui ne courent plus derrière leurs membres pour qu’ils s’abonnent à Contrastes ? Et à l’extérieur, quels sont les nouveaux créneaux possibles non encore explorés ? Comment et par quel biais les séduire ? Il faut donc mettre le paquet pour que l’effort fourni soit payant, car nous sommes toujours convaincus que Contrastes est indispensable pour maintenir le sentiment d’adhésion au mouvement et pour donner une image dynamique des EP à l’extérieur » [11].
Un sondage d’opinion peu éclairant
Face à ce constat, le comité décide d’organiser une enquête d’opinion auprès des lecteurs. Dans l’enquête « Votre avis sur Contrastes » en 1994[12], des opinions divergentes, voire opposées, sont une fois de plus exprimées : « Le journal est fait pour le monde ouvrier et non pour apprendre à jardiner ou à lire des BD » Ou, au contraire : « Trop limité au public EP, trop vieillot. Il faudrait ouvrir les fenêtres au monde qui nous entoure. Si les jeunes lisent notre journal, ce serait un signe encourageant. Efforcez-vous à simplifier le langage, tout en ne perdant rien du fond afin d’assurer une diffusion beaucoup plus large ».
Le comité constate des attentes et des suggestions tellement diverses et parfois contradictoires qu’il est difficile de tenir compte des résultats du sondage pour définir ou réorienter une politique éditoriale. Par exemple, que décider face à deux suggestions totalement contradictoires telles que « Suppression de la rubrique Foi, ouverture à d’autres idéologies » et « Contrastes devrait mieux sentir que nous sommes chrétiens et wallons »,[13] a fortiori lorsqu’elles sont exprimées toutes deux de manière équivalente en récurrence ?
Dans le cadre de ce sondage, José Fontaine nous donne une réponse pleine de bon sens à propos de la question des attentes des lecteurs. « À mon avis, un journal doit deviner ses lecteurs plutôt que leur demander ce qu’ils désirent avoir comme journal. C’est un peu comme savoir les désirs d’un ami ou d’une femme avant qu’il ou elle ne les exprime. Mais si j’avais un souhait, c’est que le journal passe des dossiers approfondis et même difficiles éventuellement. Car alors, on a intérêt à garder le journal et à y revenir »[14].
À notre connaissance, plus aucun sondage d’opinion n’a été réalisé depuis lors. Et sa suggestion de fournir des dossiers plus approfondis a été adoptée dix ans plus tard…
Un changement de formule qui semble réconcilier les points de vue
C’est finalement une « contrainte extérieure » qui a permis aux EP de clarifier la politique des publications et ainsi de mieux répondre aux attentes des lecteurs. En 2005, la mise en application du décret sur l’éducation permanente de 2003 et les conditions que celui-ci impose pour être reconnu et subsidié en axe 3 (production d’analyses, études et outils pédagogiques) amènent les EP à séparer Contrastes en deux publications distinctes : Contrastes, qui est un dossier thématique de 20 pages destiné à un public large, et La Fourmilière, devenu le bulletin de liaison qui se fait l’écho des activités du mouvement. Les deux publications étant distribuées simultanément, il semble que cette formule ait permis et permet encore de répondre aux différentes attentes : celles des personnes demandeuses d’articles plus approfondis sur des sujets de société et celles des personnes qui sont davantage intéressées par les activités développées dans le mouvement.
La posture du comité de rédaction a donc été, au fil de ces 40 dernières années, d’adapter tant bien que mal le contenu et la forme des publications afin de garantir un équilibre entre les attentes individuelles et collectives, dans le respect des convictions religieuses, philosophiques, politiques de chacun.
|
Un baromètre parmi d’autres : le courrier des lecteurs Le courrier des lecteurs est, par définition, une bonne manière de mesurer le lien qu’une publication entretient avec ses lecteurs (même si ce ne sont généralement que les mécontents qui réagissent par écrit !). En parcourant la farde contenant la plupart des courriers reçus entre 1983 et 2014[17], épinglons trois publications qui ont fait réagir, provoquer du débat, des frictions, voire des désaffiliations. En 1980 : Suppression de la mention « Pour Dieu et les travailleurs » (niveau de titre 2) Apparue en 1950, cette inscription qui se trouvait en sous-titre du nom du journal L’Equipe Populaire a été retirée en 1980 lors de la modernisation de la maquette et d’un changement d’éditeur responsable. De mémoire d’ancienne, cet « oubli » a provoqué des vives réactions de mécontentement de certains affiliés qui tenaient fortement à ce que l’identité chrétienne du mouvement apparaisse clairement. Une lettre envoyée au comité de rédaction le 29 janvier 2001 (dix ans plus tard) prouve que la rancune fut tenace chez certains affiliés : « Pour DIEU et les TRAVAILLEURS a non seulement disparu de la maquette du magazine, mais aussi et surtout, de la raison d’être, l’esprit des EP, devenu un mouvement imbibé d’un peu d’eau de rose évangélique. C’est la raison qui m’a poussé à abandonner la direction de la section EP de […], section qui a d’ailleurs immédiatement cessé d’exister, n’ayant pas survécu à la trahison des chefs nationaux. Pour ma part, je suis resté membre des EP par fidélité à mon passé jociste, mais Cardijn a dû se retourner dans sa tombe (…) »[18]. En 1983 : Tension autour d’un dossier sur la radiesthésie Le numéro de janvier 1983 n’a pas fait que des heureux. Soucieux de diversifier les thèmes des dossiers en vue d’intéresser un public plus large, l’Équipe Populaire publie un dossier sur la radiesthésie. « La fédération de Namur s’inquiète et s’étonne de l’orientation que vous avez donné à ce n°. Si ça continue dans ce sens, où va l’avenir du journal qui se veut près de la vie des travailleurs ? »[19]. Dans un courrier du 17 janvier 1983, l’équipe de Bressoux écrit : que vient faire la radiesthésie au milieu de votre publication ? Croyez-vous que son développement sur 4 pages apporte quelque chose de concret, alors qu’il y a tant d’autres préoccupations dans le monde ouvrier de ce 20e siècle et en particulier ces années de crise que nous traversons ? »[20]. D’autres se réjouissent de l’évolution : « J’ai trouvé bien le journal de janvier 83. Oui à la radiesthésie ! Oui à la rubrique Dans la foulée (activité au BW). Oui à la rubrique internationale. C’est ce qui m’a le mieux plu (avec l’éditorial aussi). Je ne sais pas ce qu’en pensent les équipiers, car les membres des nouvelles équipes ne reçoivent pas encore le journal qui, j’en suis sûr, leur plairait. Amitiés, J.A (aumônier de […]) » [21] En 1992 : Polémique autour d’un dossier sur les prisons (niveau de titre 2) Le dossier publié dans l’EP-Magazine de mai 1992 s’intitulait « Derrière les murs de l’oubli ». Celui-ci donnait exclusivement la parole à des détenus ou anciens détenus, ce qui a fait l’objet de vives discussions au sein de plusieurs équipes de Verviers. Certains estimaient que la justice était trop laxiste et que la rédaction avait été trop complaisante envers les détenus. Extraits d’une longue lettre de l’équipe de Verviers/St Joseph « On s’imagine la vie en prison, mais pense-t-on à la détresse de la jeune fille violée ou de la vieille dame agressée ? Les bouquins, la TV, le magnétoscope, combien de victimes de ces gens ont ce confort ? Tout le monde trouve la justice top laxiste, les libérations faites beaucoup trop vite, les congés pénitentiaires accordés trop facilement… » [22] . Un membre du groupe, aumônier de prison, a tenté de tempérer ces propos en soulignant le revers de la médaille d’une justice trop punitive : « Tout le monde est d’accord pour dire que la prison ne sert qu’à pervertir encore plus. Pourquoi emprisonner les étrangers et les vagabonds ? ».[23] La publication d’extraits de cette lettre dans la rubrique « Courrier des lecteurs » a suscité de vives réactions d’autres lecteurs, outrés par les propos tenus envers les détenus : « Je viens de lire et relire la réaction de l’équipe de Verviers sur le dossier consacré aux prisons. Et je suis perplexe. Des réactions comme celles-là, j’en entends dans la rue, par mes voisins, par des gens dont la réflexion n’est pas basée sur un vécu de foi. Mais de la part d’un groupe EP, ça m’attriste. J’ai envie de hurler comme Julos Beaucarne le lendemain de l’assassinat de sa femme : « Aimons-nous. Ce n’est pas parce qu’on souffre qu’on doit faire souffrir. »[24]. L’équipe de Verviers a ensuite réagi… aux réactions provoquées par la publication d’extraits de sa lettre. Elle a exprimé son mécontentement envers le comité de rédaction qui, selon elle, n’a relaté que les extraits dénigrants envers les détenus. Elle a demandé un droit de réponse qui n’a pas été publié, ce qui a attisé sa rancœur envers le comité de rédaction. La polémique a mis un certain temps à s’éteindre… |
Contraintes et opportunités du décret
La lisibilité des articles a fait (et fait encore) régulièrement l’objet de débats au sein du comité de rédaction, et est également évoquée dans des courriers de lecteurs. « L’équipe tient à attirer votre attention sur le fait que certains termes utilisés sont peu compréhensibles par le monde du travail : tertiarisation, inaccessibilité financière, triade… » [15]
Or, cette volonté de « vulgarisation » s’est complexifiée lors de la mise en application du décret de reconnaissance de l’éducation permanente par la FWB[16]. Le Comité de rédaction a dû se « professionnaliser » en adaptant le contenu et la manière d’écrire les articles : plus longs, plus analytiques, susceptibles d’intéresser un public large. Ces critères ne sont pas toujours compatibles avec une lisibilité aisée pour les milieux populaires peu familiarisés avec la lecture d’articles plus complexes et plus longs… Exactement le contraire de la norme actuelle, celle des réseaux sociaux !
Quant aux rédacteurs des articles, ceux-ci sont souvent amenés à faire le grand-écart entre la qualité de l’analyse et la fluidité de lecture : comment expliquer des notions complexes avec des mots simples ? Produire des analyses pertinentes est un exercice exigent, les rendre lisibles est tout un art…
Le décret a donc assez fortement influencé la politique des publications. Du côté positif de la balance, elle a amené les EP à améliorer la qualité des analyses, à cibler leurs publications en fonction des attentes des affiliés/abonnés, et à s’adresser à un public plus large. Certaines exigences (telles que le nombre minimum de signes) sont cependant un frein à des publications plus adaptées à un public peu habitué à la lecture.
La fin du papier ?

Pour conclure, une question qui risque d’être de plus en plus d’actualité dans les années à venir : alors que le papier se fait de plus en plus rare dans la presse traditionnelle, les publications papier ont-elles encore une raison d’exister dans le milieu associatif ?
Aux EP, malgré la pléthore d’informations disponibles sur internet, le maintien d’une version papier n’a pas (encore) été remise en question en raison de la fracture numérique particulièrement ressentie dans les milieux populaires, majoritairement représentés dans le mouvement. Par ailleurs, il y a une volonté de pouvoir conserver une version papier des dossiers par confort de lecture et pour éviter de devoir les imprimer soi-même, en particulier lorsque ceux-ci servent d’outil d’animation. Enfin, la revue est toujours considérée comme un bon outil pour faire connaître le mouvement à des potentiels nouveaux membres et lors d’activités sur l’espace public. Cependant, certaines associations sont ou pourraient être tentées de renoncer au papier pour supprimer les coûts d’impression et de distribution. Les EP n’ont heureusement pas encore dû faire ce choix.
Malgré toutes les difficultés évoquées, les publications associatives nous semblent plus que jamais indispensables pour les associations afin que celles-ci puissent maintenir un lien étroit avec leurs membres et continuer à exister sur l’espace public. Être capable d’adapter ses publications aux circonstances internes et au contexte extérieur représente un défi important pour leur développement.
La professionnalisation du secteur de l’éducation permanente a sans conteste contribué à améliorer la qualité des publications du secteur associatif. Au-delà des différences d’approche, ses publications sont le terreau d’un foisonnement d’idées et d’analyses qui permettent d’entretenir une « culture progressiste commune » plus que jamais nécessaire à l’exercice de la démocratie.
Notes
[1] L’équipe populaire, « Éditorial », n°1, novembre 1947.
[2] C’est au congrès « Un mouvement au cœur de la société » des 6-7 octobre 2001 que les EP actent officiellement le pluralisme du mouvement. L’identité chrétienne des EP est abandonnée. L’éducation permanente est prioritaire par rapport à la recherche de sens et de la foi.
[3] Cet article se base principalement sur la connaissance personnelle de l’auteure à partir des années 80. Celle-ci a été membre du comité de rédaction de « L’Équipe populaire » de 1979 à 1982, puis rédactrice en chef de la revue « l’EP Magazine » et « Contrastes » de 1982 à 2022.
[4] « L’Équipe populaire » de 1947 à 1986, « EP Magazine » de 1987 à 1992, puis « Contrastes » depuis janvier 1993
[5] Ceux que nous nommons « affiliés » sont les membres et militants au sein des groupes locaux des EP, les abonnés étant les personnes ou institutions qui reçoivent les publications sans toutefois participer régulièrement aux activités du mouvement.
[6] On parle de Journal de 1947 à 1987, car il avait le format journal, puis de Revue (format A4) à partir de 1987
[7] CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, n°5395, « Lettre de l’équipe du Bois-de Breux au comité de rédaction en 1984 »
[8] Ibidem, n° 5395, « Lettre de l’équipe l’équipe de Grâce-Hollogne au comité de rédaction en 1985 »,
[9] CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, n°1248.
[10] Ibidem , n°3707
[11] Ibidem, “Rapport du Comité de rédaction du 02/05/94 », n°3636
[12] Ibidem, n° 4589
[13] Ibidem, n° 4589
[14] Ibidem, « Lettre de José Fontaine, journaliste et éditeur de la revue Toudi, octobre 1994 », n°5395
[15] Ibidem, “Lettre de l’EP de Dison, le 8/10/96 », n° 5395.
[16] Les EP sont notamment reconnues dans l’axe 3 du décret qui accorde un subventionnement sur base d’un nombre suffisant d’analyses produites et selon des critères qualitatifs et quantitatifs.
[17] La farde 5395 des archives des Équipes Populaires contient la plupart des courriers reçus par le comité de rédaction entre 1983 et 2014. CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, n°5395.
[18] Ibidem, n°5395.
[19] CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, n°5395
[20] CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, “courrier de l’équipe de Vervier/St Joseph en mai 1992”, n° 5395.
[21] Ibidem
[22] Extraits, CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, « Courrier de l’équipe de Verviers/St Joseph en mai1992 ». n°5395
[23] CARHOP, Fonds d’archives du Centre communautaire des Équipes populaires, n°5395
[24] Ibidem
Pour citer cet article
Van Dieren M., « De L’Équipe Populaire à Contrastes : Un trait d’union entre le mouvement et ses affiliés », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 24 : Lire pour lier!, octobre 2024, mis en ligne le 17 octobre 2024, https://www.carhop.be/revuecarhop/
Appel à contribution pour un numéro de Dynamiques consacré aux radios libres
Émergeant dans les années septante, elles mobilisent des techniques audio et émettent sur des ondes pirates. Les radios libres deviennent un formidable moyen pour relayer les tensions sociales, donner la parole aux militants et militantes et diffuser les revendications de la classe ouvrière. Le mouvement étudiant et celui de la nouvelle vague féministe mobilisent aussi ce média. C’est un outil de lutte, d’information, d’expression populaire et de mobilisation, où amateurs et amatrices côtoient des professionnels du métier. L’apprentissage se fait pour beaucoup sur le tas. Les émissions sont joyeuses, dynamiques, inventives, hors cadre.
Des historiens et historiennes et animateurs et animatrices de radios libres s’intéressent à l’histoire de ces dernières et à la dynamique sociale qui en découle. Ces expériences tapageuses s’inscrivent dans une mobilisation militante pour partager la cause, avant même que les télévisions communautaires ou les réseaux sociaux ne prennent le relais.
C’est une belle histoire à faire connaître et à partager !
Animateur ou animatrice d’une radio locale, témoin du long combat pour la reconnaissance légale des radios libres, nous avons besoin de vous pour partager votre expérience sur le droit d’émettre, faire connaître les fréquences des ondes des radios libres (non commerciales) … Le CARHOP est également intéressé par des archives sonores ou iconographiques (affiche, photo, flyer, etc.) portant sur ces expériences de radios militantes.
Contact : Anne-Lise Delvaux (anne-lise.delvaux@carhop.be)