Julien Tondeur (historien, CARHOP asbl)
C’est dans la commune bruxelloise d’Anderlecht que débute, il y a cinquante ans, l’aventure du Centre d’action sociale Italien-Université ouvrière, plus généralement appelé par son acronyme CASI-UO ou tout simplement « le CASI ».[1] Aujourd’hui association d’éducation permanente, centre culturel et école de devoir (EDD), le CASI-UO est lancé en 1970 par une petite équipe militante italienne venue poursuivre ses études en Belgique à la fin des années 1960. Leur souhait est de favoriser l’émancipation culturelle des travailleurs et travailleuses immigré.e.s, principalement en provenance d’Italie. Dans le sillage de l’Université ouvrière[2], à destination des jeunes adultes, le CASI-UO crée dès 1973 une école des devoirs. Si elle initie cette démarche, c’est parce que l’équipe du CASI prend conscience que l’école reproduit les rapports de domination ainsi que les inégalités sociales et de classe présents dans la société. De l’avis de l’équipe, les jeunes issu.e.s de l’immigration en sont les premières victimes. Le cinquantième anniversaire du CASI-UO représente aujourd’hui une belle opportunité pour demander à Teresa Butera, actuelle directrice de l’association, et elle-même issue du parcours de formation interne au CASI, de jeter un regard dans le rétroviseur et de nous parler du passé, de l’évolution mais également du futur de l’école des devoirs. Son récit est complété, pour la période récente, par celui de Giulio Iacovone, actuel responsable de l’école des devoirs.
Les débuts de la « doposcuela » anderlechtoise
-
- L’arrivée de Teresa
Aujourd’hui, aborder l’histoire du CASI-UO, c’est inévitablement raconter aussi celle de Teresa. Notre interlocutrice débarque au milieu des années 1970 en Belgique. Elle ne se rappelle pas exactement la date parce que, dit-elle, « ça a été vraiment un déchirement assez profond et je ne veux plus me souvenir de tout cela. Je n’étais pas contente d’être là »[3]. Comme beaucoup d’immigré.e.s en provenance d’Italie qui atterrissent à Bruxelles, elle se retrouve à Cureghem. Quartier historique de l’est de la commune d’Anderlecht, physiquement coincé entre le canal de Bruxelles-Charleroi et les cinémas pornographiques qui jouxtent la gare du Midi, Cureghem a, de l’avis de Teresa, l’allure d’un ghetto. Par sa position et son passé industriel, Cureghem possède une tradition d’accueil des populations immigrées. Sur une superficie de moins de deux kilomètres carrés, de nombreuses nationalités, italienne, grecque, turque, espagnole ou marocaine s’y croisent déjà.[4] La communauté italienne y est importante. Dans une analyse publiée en 1978, le CASI-UO décrit le quartier comme « un monde qui pourrait être intéressant, s’il n’était pas le concentré des contradictions et de la rage de tous ces peuples »[5].

En fait, ironie de l’histoire, se remémore Teresa, « je suis arrivée au CASI au travers de l’école de devoirs ». Lorsqu’elle débarque à Bruxelles avec ses frères et sans ses parents, elle se sent vite mal à l’aise. « Il y avait une question de liberté par rapport aux filles immigrées et donc j’étais un peu coincée. […] J’ai fait appel à mes parents et je leur ai dit : “Ou vous venez en Belgique ou bien je retourne parce que ce n’est pas une vie pour moi” ». Finalement, ses parents arrivent à leur tour à Bruxelles, accompagnés de sa petite sœur. Teresa cherche une solution afin de l’aider pour l’école. C’est alors, nous dit-elle, qu’elle entend parler d’une « association qui avait organisé une école de devoirs. Je me suis renseignée et j’y ai accompagné ma petite sœur ». Elle y fait la rencontre des jeunes de son âge qui lui expliquent qu’il existe également au CASI-UO une école pour les adultes, appelée l’Université ouvrière.[6]
Il n’est sans doute pas exagéré d’affirmer que cette rencontre va bouleverser le destin de Teresa. Par curiosité, elle discute avec eux et se rend compte qu’ils vivent les mêmes problèmes, se posent les mêmes questions qu’elle. Ce moment, Teresa le considère comme fondateur : « Ça a été vraiment édifiant, […] ça m’a soulagée et je me suis dit : “Il y a un lien avec ma terre d’origine”. Et à partir de là, ça a été l’aventure. (…) Ma petite sœur n’a plus été à l’école de devoirs, mais moi, j’ai continué avec mon engagement ».
-
- Pourquoi une école des devoirs ?
Afin de mieux connaitre le milieu dans lequel il agit, le CASI réalise, durant les années 1970, plusieurs enquêtes sur les conditions de vie de ces immigré.e.s italien.ne.s.[7] Une des difficultés rencontrées par cette immigration se révèle être le parcours scolaire chaotique de ses enfants. Pour l’équipe du CASI, si le but est d’armer culturellement la jeune génération, il s’agit aussi de préparer la future. Ce n’est donc pas un hasard si, dans le sillage de l’Université ouvrière et imprégné de l’expérience appelée « école de Barbiana »[8] menée en Toscane une quinzaine d’années plut tôt, le CASI-UO crée dès 1973 une école de devoirs.
Les membres du CASI sont parmi les premiers à évoquer les problématiques spécifiques liées à la « deuxième génération », celle des enfants nés en Belgique de parents d’origine étrangère.[9] Selon Teresa, les nouvelles problématiques qui apparaissent avec cette deuxième génération ne sont prises en compte par personne. « L’État belge n’a mis aucun moyen en place pour intégrer cette population qui allait s’installer durablement dans le temps ». Quant à la communauté italienne, « en général, elle avait toujours souhaité retourner au pays et donc n’avait pas coupé le “cordon ombilical” […]. Ils ne pensaient qu’au retour ». Analysant les besoins de cette communauté dont la majorité des familles sont issues du milieu ouvrier ou rural, peu ou pas scolarisées et qui débarquent dans une grande ville, le CASI remarque que leur condition socio-économique et culturelle multiplie les difficultés à affronter. Leur situation est souvent catastrophique, rappelle Teresa, avec notamment pour conséquence, l’échec scolaire des enfants. « On parlait même », à l’époque, « de mortalité scolaire ». En 1975, l’enquête menée par le CASI, montre selon Teresa « que le taux d’échec scolaire des enfants issus des familles italiennes était le double de celui des enfants belges ». De par ses contacts sur place, le CASI est convaincu que nombre de ces familles vont rester en Belgique et « qu’il fallait tout mettre en œuvre pour […], à tout le moins, donner des réponses à cela ». Teresa se remémore d’ailleurs que deux dictons siciliens qui illustrent cette volonté résonnent à cette époque dans les couloirs du CASI et dictent sa démarche collective : « Si on veut de l’eau propre, il faut travailler à la source » et « Un peuple sain doit préparer le futur que sont les enfants ». L’école des devoirs du CASI est issue de cette volonté de proposer une alternative à l’échec scolaire des élèves immigré.e.s. Bien que les activités de l’association soient surtout tournées vers les jeunes adultes et l’Université ouvrière, l’équipe est persuadée de la nécessité de travailler avec les enfants, les préparant ainsi à intégrer le système de formation de l’association. Teresa résume finalement le tout en une phrase à l’allure de slogan : « L’école de devoirs au CASI a été considérée comme une activité seconde, mais jamais secondaire ».
-
- Contre l’école bourgeoise
Pendant les premières années de l’existence de l’EDD, les liens avec l’école officielle apparaissent inexistants. Plus précisément, le CASI souhaite que la population italienne organise le contre-pouvoir à cette école vue comme la matrice du système capitaliste, « c’est-à-dire sélective, élitiste et qui produisait des inégalités. À l’époque, […] c’était s’organiser contre l’école et pouvoir dénoncer certaines inégalités ». Car le constat auquel arrive l’association est sans appel : « Plus le type d’enseignement est disqualifié, plus les étrangers ont de chances de le fréquenter »[10]. Les chiffres récoltés par le CASI indiquent aussi que les Italiens et les Italiennes, comme les autres jeunes immigrés, connaissent des parcours très compliqués et ne s’installent pas sur la grille de départ de l’apprentissage scolaire avec les mêmes chances que les enfants belges. Un enfant d’origine italienne vivant à cette époque sur la commune d’Anderlecht a, selon une étude du CASI, « 8,44 probabilités sur dix de finir dans une école de la première batterie (c’est-à-dire dans un enseignement technique ou professionnel) et 8,1 probabilités sur dix d’avoir accumulé en 6ème primaire au moins un an de retard »[11]. L’école est simplement révélatrice du fonctionnement de la société inégalitaire, « c’était l’école bourgeoise non pensée pour eux, avec eux »[12].
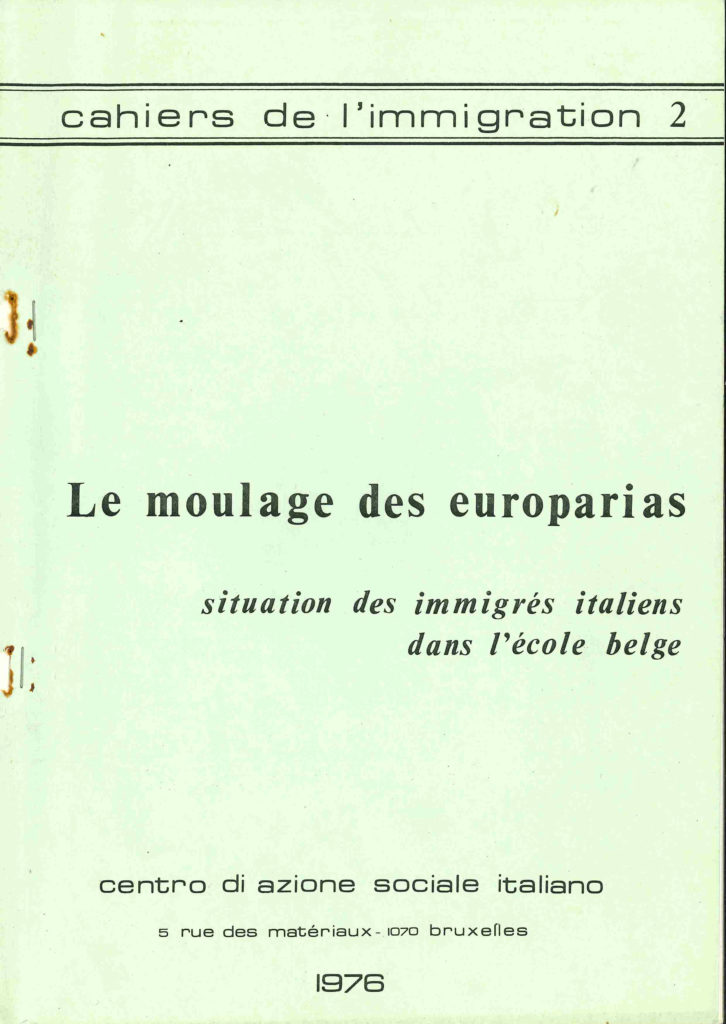
À l’EDD du CASI, les enfants apprennent l’histoire de l’immigration de leurs parents. Ce n’est pas le lieu pour s’occuper ou pour remédier aux échecs, du moins pas uniquement. Non, à l’EDD, on construit une conscience collective, on s’approprie des outils de compréhension du monde, « outils qui ne devaient pas servir à de la promotion uniquement individuelle, mais à se consolider ensemble pour faire avancer les luttes contre les exploitations et les diverses dominations de classes. Ce projet était politique, idéologique, plus que pédagogique. Il ne s’agissait pas d’assistance, mais de résistance »[13].
L’équipe réalise immédiatement que, parmi les activités de l’EDD, toutes ne permettent pas le même travail collectif avec les enfants. Dans un rapport de 1975, le CASI écrit : « Les cours de rattrapage sont plus contraignants dans le sens que souvent ils nous obligent à aider les enfants à faire leurs devoirs pour le lendemain et ils nous empêchent d’intervenir d’une façon systématique sur les carences de base ». Dès ses débuts, le CASI milite alors pour une EDD qui se distancie de son appellation d’« école des devoirs », mais promeut des activités parascolaires qui offrent la possibilité de contrer le système dans lequel ces enfants d’origine immigrée sont enfermé.e.s. L’équipe estime qu’il est « capital de ne pas réduire nos interventions à de simples services, mais il est nécessaire qu’elles soient inscrites dans une perspective politique plus grande (regroupement des familles, comité-école) qui réalise un choc en retour soit au niveau des écoles, soit au niveau du quartier. La création de comité de parents réalisée à partir des cours de rattrapage s’est déjà concrétisée dans plusieurs cas »[14].
-
- Collectivement avec les parents
Dans le but d’aider au mieux les enfants, l’attention du CASI-UO se porte sur leurs parents, « et ça, c’était une activité d’éducation permanente. Parce qu’on rentrait en contact avec les parents, et, pour nous, l’important était de les conscientiser par rapport aux problèmes scolaires, enlever toute cette idée de fatalité ». Les parents en contact avec le CASI-UO sont, pour la majorité, persuadés que si leur enfant ne réussit pas, nous explique Teresa, « c’est parce qu’il n’a pas envie d’étudier, qu’il n’est pas capable, qu’il n’est pas fait pour ça ». Teresa ne compte plus le nombre d’occasions où elle a entendu : « En fait, c’est mieux qu’il apprenne un métier manuel ». On « reproduisait le schéma. Depuis le père mineur au père ouvrier, il fallait prendre la relève avec le fils mécanicien ou bien la fille coiffeuse et on se contentait de ça ». Dès les premières années de l’EDD, un groupe de parents est constitué et leur participation à certaines activités est encouragée. Si aujourd’hui les EDD sont obligées de veiller à la coordination de leur travail avec les familles, à l’époque la démarche est innovante, nous explique Teresa. Les parents doivent, d’une part, suivre le parcours de leurs enfants et, d’autre part, eux-mêmes suivre des formations. À travers cette manière d’associer les parents à sa démarche, le CASI démontre sa volonté d’apporter aux problèmes des jeunes des solutions collectives plutôt qu’individuelles.
-
- Modalités d’interventions
Les principes qui sous-tendent la pédagogie employée à l’EDD sont similaires à ceux développés pour l’Université ouvrière. Il s’agit de faire évoluer la culture immigrée, qui, déracinée et faiblement scolarisée, « n’avait pas d’expression ni de sens analytique » pour développer ensuite un esprit critique, poursuit Teresa. C’est alors la culture ouvrière qui est valorisée, en prenant comme point de départ de toute réflexion la situation et le vécu des individus, reconnaissant par ce biais que chacun.e possède une culture propre. À l’époque, poursuit Teresa, « c’était partir aussi de la réalité de l’enfant, de la réalité de la famille immigrée dont les parents étaient des ouvriers, et ça, c’était vraiment primordial pour nous. Mettre l’enfant au centre, avec autour de lui, sa culture et sa réalité quotidienne, et travailler à partir de là ».
Au CASI, on apprécie se répéter ce petit slogan : « Mon problème est égal au tien. Si je m’en sors tout seul, c’est de l’égoïsme. Si on s’en sort tous, c’est de la politique ». La coopération est encouragée entre les enfants, contrairement à ce que l’association perçoit de la démarche présente dans le système scolaire classique : « Autant l’école promeut l’esprit individualiste et arriviste, autant nous devons détruire cet esprit en développant le sens d’autrui, de la solidarité, de la coopération, du travail en groupe »[15]. Une méthode non-directive, qui favorise l’expression de la créativité, est privilégiée, à condition que l’individualisme ne l’emporte pas sur le collectif.
L’équipe remarque que la plupart des enfants sont incapables de s’exprimer en public face au groupe. La prise de parole et l’argumentation sont alors encouragées, notamment par le biais de spectacles et de pièces de théâtre montés par les adolescent.e.s. Teresa se rappelle d’un spectacle des années 1980, qui s’intitulait Un visage à inventer. « Les jeunes avaient représenté une des scènes comme une cordée, où le prof était le chef de la cordée et expliquait aux élèves qu’ils ont terminé leur parcours scolaire et qu’ils sont prêts à entrer dans le monde du travail. En fin de cordée, se trouve le fils d’immigré qui n’entend pas et qui, étant donné son parcours scolaire chaotique, opte, faute de choix, pour une filière professionnelle. »
Les évolutions de l’EDD du CASI et du secteur
Lorsqu’elle regarde en arrière, sur une période longue de près de cinquante ans, Teresa observe de nombreux changements dans le secteur des écoles de devoirs. Elle en aborde ici quelques-uns avec nous.

-
- Des publics toujours plus précaires
Quand elle analyse l’évolution du public qui fréquente l’EDD, un des premiers éléments qui interpelle Teresa est la précarisation. Lorsque le CASI commence son action en 1970, la communauté italienne, pour une grande partie d’entre elle arrivée en Belgique entre 1946 et 1956, connait un certain bien-être économique. La question de l’intervention de l’asbl se situe alors surtout au niveau culturel.[16] Au contraire d’aujourd’hui, souligne Teresa, car « les deux questions, économique et culturelle, se posent à nous et font que la situation a empiré ». Pour autant, les problèmes auxquels doivent faire face les enfants qui fréquentent l’EDD n’ont pas réellement évolué mais « les noms ont changé », continue Teresa. « Avant, c’était Carmelo, Maria, Giuseppe et aujourd’hui, c’est Ahmed, Fatima, Ali ». Un rapport de l’Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et l’aide à la Jeunesse, daté de 2016, épingle effectivement le fait que la paupérisation augmente pour les familles qui fréquentent les EDD de la Fédération Wallonie-Bruxelles.[17]
De l’avis de Teresa, la zone spatiale de précarité socio-économique et culturelle d’Anderlecht qui constituait le terrain d’action du CASI s’est maintenant agrandie. « Auparavant, le ghetto était bien délimité et on en connaissait les limites et les “frontières”. Pour y avoir travaillé, par exemple, le ghetto de Cureghem s’étendait de la gare du Midi jusqu’au canal. Mais aujourd’hui, le ghetto s’est élargi. Et, en fait, aujourd’hui, on n’est pas près de la gare du Midi, on est plus dans le haut d’Anderlecht. Et là aussi, c’est devenu un quartier populaire, alors qu’il y a cinquante ans, le haut d’Anderlecht était le quartier de la classe moyenne et les bonnes écoles se trouvaient là-bas. »[18]
Giulio Iacovone[19], actuel responsable de l’EDD et collègue de Teresa, amène quant à lui des précisions sur la composition du groupe d’enfants dans lequel plusieurs profils se croisent. Certains ont surtout besoin de socialisation, d’autres d’un espace en dehors de la cellule familiale, mais de manière générale, « un grand nombre d’entre eux sont dans une situation de précarité à plusieurs niveaux ». Les raisons sont multiples : principalement parce que ce sont des enfants de mères célibataires[20], des enfants de parents analphabètes ou des primo-arrivants, pour lesquels le CASI garde toujours quelques places. « Par contre, on ne prend pas que des primo-arrivants, parce qu’on formerait un ghetto. Et nous faisons l’effort de garder de la diversité à l’EDD. On essaye qu’ils soient divers en termes d’origine, de parcours et de compétences, et on ne prend pas que des gens qui sont en échec. » Effectuer le suivi de ces enfants demande des compétences en accompagnement social si l’équipe souhaite pouvoir les aider efficacement, nous explique Giulio. L’équipe est présente, et les parents le savent, s’il est nécessaire d’accompagner les enfants dans une autre structure ou s’il est nécessaire de régler avec eux certaines démarches administratives. « La réussite scolaire passe aussi par la stabilité émotionnelle de l’enfant », continue Giulio, « qui passe aussi par la stabilité de la famille ».
-
- Reconnaissance graduelle et influence du décret
Entre les débuts de l’expérience et aujourd’hui, le nombre d’EDD explose : « D’une dizaine d’initiatives en 1975, les écoles de devoirs sont passées à 30 en 1977, à 50 en 1980, à 200 en 2000 et à plus de 300 en 2020. Progressivement reconnues et subventionnées par les autorités publiques, elles se sont constituées en un mouvement pédagogique qui développe ses propres caractéristiques à côté de l’école »[21]. Ces nouvelles initiatives sont souvent le fruit d’autres communautés immigrées, espagnole ou marocaine par exemple, qui s’organisent et qui créent elles aussi des structures non-subsidiées, nous explique Teresa. « C’était vraiment l’envie d’aider à s’en sortir et de préparer ces populations qui allaient devenir les futurs citoyens belges. On en était convaincu ». Le mouvement de création des EDD « s’étend ensuite à une population socialement et culturellement défavorisée à Bruxelles et dans les grandes villes de Wallonie et de là au milieu semi-rural puis rural… »[22]. Une certaine émulation s’empare des communautés immigrées de Bruxelles et des quartiers défavorisés, « il y a eu une prolifération d’écoles de devoirs, de soutien à la parentalité, de collaborations avec les écoles », se remémore Teresa. De manière progressive, le secteur sort de l’ombre médiatique : « Il y a eu, à partir des années 1980, de nombreux articles qui traitaient des écoles de devoirs ».
Si la reconnaissance institutionnelle des EDD par les pouvoirs publics est graduelle, Teresa identifie un moment-clé parmi d’autres : l’adoption par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles du décret de 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. « 2004 est une date forte. Après 2004, tout a changé. Ce n’était plus “aller contre” (les écoles) mais se mettre d’accord pour que l’école de devoirs puisse aider les écoles à mieux travailler avec une population immigrée. » Le décret amène plus de cohérence, il permet « d’organiser ce système de bénévolat, de volontariat et de militantisme pour certains. Il fallait mettre un cadre à tout cela et donner les moyens pour que les écoles de devoirs puissent s’organiser de façon autonome ». C’est d’ailleurs suite aux revendications et aux combats des associations que ce décret voit le jour, ce qui, de l’avis de Teresa, représente une évolution positive. Le décret reconnait en effet, de facto, « le travail de base d’un tas d’associations. On met un cadre législatif et ça, c’est une vraie conquête, on détermine des objectifs communs à tous et donc on se réfère à une charte (…). Il y a toute une structure qui prend forme »[23].
Giulio ajoute à propos du décret qu’il estime que, « sur papier, beaucoup de choses sont intéressantes. Dans les missions, on attache beaucoup d’importance à tout ce qui est l’émancipation, la stimulation de la créativité, etc. » Mais la pratique est « de plus en plus celle de l’institutionnalisation et de moins en moins en moins celle de la politique. […] On se retrouve dans un système qui crée de plus en plus de précarité et de pauvreté, et on nous demande de faire le travail sans nous en donner les moyens, et c’est le nœud du problème ».
-
- Une meilleure relation à l’école
La principale amélioration que l’on peut observer aujourd’hui, si on compare la situation avec les années 1970, est la relative bonne connaissance que possède le corps enseignant des difficultés que peuvent vivre des enfants issus de l’immigration et des milieux précaires, nous explique Teresa. Alors qu’en 1970, le dialogue est absent, le CASI-UO collabore actuellement avec des écoles d’Anderlecht et tient des réunions d’informations communes. « La collaboration est vraiment souhaitée, encouragée et organisée afin de résoudre les problèmes portés par les enfants de l’immigration. On rencontre une disponibilité qu’il n’y avait pas auparavant, notamment parce que l’enseignant se retrouve face à des difficultés. Et nous comprenons que ce n’est pas facile pour l’enseignant, son rôle est vraiment très compliqué. » Des formations adaptées sont aujourd’hui à la disposition des enseignant.e.s, notamment celles données par l’asbl ChanGements pour l’égalité (CGE)[24], souligne Teresa. Elle poursuit en indiquant que, pour elle, le rôle du décret dans ce rapprochement entre les structures scolaires et les EDD est indéniable.
Giulio abonde dans le même sens : « On rencontre des professeurs, des directions, des éducateurs ou des psychologues dans l’école qui sont super à l’écoute ». Un bémol cependant, il s’agit là d’individus ou d’écoles volontaires, pas de l’institution scolaire dans son ensemble. Les écoles ont encore une « méconnaissance du travail et de la raison d’être des écoles des devoirs », considère Giulio, et « la première chose qu’on fait quand on va dans les écoles, c’est leur expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Ça peut sembler banal, mais, en fait, ils ne le savent pas. Ils nous voient comme une étude organisée, comme le font les écoles après les cours ». Cependant, Giulio précise qu’après une petite phase d’explication du rôle des EDD, « on est bien reçu généralement et des collaborations se mettent en action ». Celles-ci sont toutefois uniquement le fait de la bonne volonté d’enseignant.e.s et d’EDD. Pour Giulio, il est pourtant primordial que ce type de travail soit effectué « de manière beaucoup plus structurelle et structurée entre écoles des devoirs, direction, PO [25], etc., en début ou en fin d’année ».
- Du bénévolat au salariat, du militantisme au professionnalisme
Toute médaille possédant un revers, l’évolution du secteur des EDD vers une part plus grande d’emplois rémunérés et de professionnalisme amène de nouveaux débats internes, qui ne sont d’ailleurs pas exclusifs aux écoles de devoirs, mais qui traversent l’ensemble du secteur associatif. De l’avis de Teresa, la question principale réside dans le passage « d’un agir militant à une fonction payée ». Elle regrette particulièrement « cette spontanéité et cette envie profonde de se donner pour sa propre communauté ».
Dans les premières années du CASI jusqu’à la reconnaissance structurelle, personne n’est salarié, nous explique-t-elle. « On était tous des militants, plus que des bénévoles, et on suivait cette formation qu’était l’Université ouvrière qui durait trois ans, le soir. Et après trois ans, on commençait à être responsable d’activités et on rentrait dans le système global du CASI qui nous permettait de participer aux assemblées, d’avoir des responsabilités par rapport aux activités. […] Parce que l’objectif de l’Université ouvrière, c’était de former ce qu’on appelait, à l’époque, des multiplicateurs sociaux qui deviendraient des leaders, qui prendraient en charge leur propre communauté. »
Aujourd’hui, l’équipe de l’EDD est composée de deux personnes salariées, renforcée par deux ou trois jeunes universitaires sous contrat étudiant et une bénévole. Cette évolution progressive, Teresa la situe à partir de la fin des années 1990. Le CASI reçoit alors des subsides et engage des personnes qui « n’ont pas suivi le parcours de l’Université ouvrière et de la formation en interne ». Teresa est maintenant la dernière à avoir suivi ce parcours de formation au CASI, c’est pourquoi elle se pose la légitime question de la relève : « Je procède par étapes pour que les autres puissent se former un maximum. L’éducation permanente aussi s’est professionnalisée. Avant on était des militants, et aujourd’hui, on est des permanents. Il faut répondre au décret et coller aux dossiers de l’éducation permanente, faire d’autres activités, compléter des dossiers et ça enlève cette spontanéité, cet enthousiasme et cette liberté pour agir ».
Si son avis est partagé, Teresa ne remet pas en cause certains bienfaits de la professionnalisation du secteur. Elle apprécie que le métier d’animateur soit maintenant reconnu et qu’il existe une panoplie de formations qui permettent de s’améliorer de manière continue. Elle met en évidence le rôle des associations qui doivent choisir des profils en adéquation avec leurs objectifs et leurs valeurs, et précise que le CASI redouble d’attention à ce sujet. « D’abord pour choisir des personnes qui ont déjà un intérêt pour toutes les questions touchant à l’immigration. Pas par communauté, parce qu’aujourd’hui, je dois t’avouer qu’il n’y a presque plus d’italiens dans nos écoles des devoirs, même au CASI. […] On a une charte en interne, on a un projet pédagogique et il faut adhérer à tout cela. Ce n’est pas n’importe qui vient faire l’école des devoirs ».
Dans le secteur associatif, les reconnaissances structurelles bouleversent effectivement les profils engagés. Les militant.e.s sont progressivement remplacé.e.s par des salarié.e.s, qui n’ont ni les mêmes attentes, ni les mêmes exigences. Cette entrée de l’associatif dans l’univers marchand a pour corolaire que la forme principale de reconnaissance du travail accompli passe maintenant par la rémunération, ce qui constitue en quelque sorte un paradoxe avec cet « agir militant » qu’évoque Teresa. Dans le secteur associatif, qui s’est bâti sur une logique de « don », de militantisme bénévole, il est alors inévitable que ce bouleversement soulève complications et tensions.
Pour conclure sur ce sujet, Teresa estime, de manière générale, que l’évolution liée à la professionnalisation et à la reconnaissance est positive. Elle considère toutefois qu’il existe « aussi une ambigüité qu’il faut absolument éclaircir. Nous ne sommes pas au service de l’école. Et l’école des devoirs est vue comme ça. »
-
- École des devoirs et rattrapage scolaire, même combat ?
« Souvent, dans les écoles, dès qu’un enfant ou un jeune a un problème, dès qu’il y a un bulletin, nous le voyons très clairement. Le jour suivant, nous avons cinq, dix, voire quinze appels de parents qui nous disent que le prof leur a conseillés d’aller se renseigner auprès d’une école des devoirs », explique Giulio. L’EDD est ainsi perçue par certains acteurs scolaires comme de la remédiation scolaire. Teresa confirme que l’école leur « expédie » des enfants, avec parfois des recommandations spécifiques sur tel ou tel exercice à pratiquer : « Il faut faire ça, ça et ça ». Sur ce point précis, elle partage son énervement : « Non, excuse-moi, mais fais-le ! Parce que tu as l’enfant huit heures par jour, et nous, on ne l’a que deux heures par jour. Et il arrive, fatigué déjà. Parce que là aussi, c’est incroyable. L’enfant qui va à l’école de 8 heures à 15 heures 30 et puis de 16 heures à 18 heures chez nous. Et nous, on doit remédier à ses lacunes ? Et bien là, il y a des choses qui ne vont pas ».
Ce qui choque le CASI, continue Giulio, c’est de participer à « un système qui crée des échecs à répétitions. Nous sommes un des pays où les écoles sont les plus inégalitaires du monde, ce qui est dénoncé par l’OCDE[26], ce n’est pas moi qui le dis.[27] L’école, au lieu de diminuer les inégalités socioéconomiques, les augmente, et on est dans un marché scolaire qui est aberrant, où les gens qui ont des compétences choisissent les bonnes écoles et les autres prennent ce qui reste. C’est un peu ça, le libre choix à Bruxelles. Et nous, on récupère ce qui reste de ce qui reste ! »
La Belgique fait effectivement partie des pays dont l’enseignement est le plus inégalitaire en Europe et dans le monde parmi les pays industrialisés. Les enquêtes PISA de l’OCDE montrent également que cette inégalité à une origine sociale et que celle-ci détermine les chances de réussites des élèves. Cette situation résulte, selon certains auteurs, « de particularités liées au mode d’organisation de nos systèmes éducatifs, notamment l’âge précoce de la première orientation et un quasi-marché scolaire extrêmement libéralisé »[28].
-
- Manque de places, « shopping social » et pression de la réussite
Aujourd’hui, le CASI-UO reçoit plus du double de demandes. Il n’a plus de places disponibles, et se voit obligé de refuser environ soixante personnes par an, « sans toutefois savoir où les parents et les jeunes pourront trouver un soutien accessible et de qualité »[29]. Une situation que vivent toutes les écoles de devoirs de la commune selon Giulio. Car à Anderlecht, comme dans la Région de Bruxelles-Capitale dans son ensemble, un essor démographique important est observé depuis plusieurs années. La population anderlechtoise, après avoir longtemps diminué, passant de 95.000 personnes en 1980 à 88.000 jusqu’au début des années 2000, effectue ensuite une spectaculaire remontée[30]. En 2008, la commune compte déjà 99.085 habitant.e.s et aujourd’hui, ce sont plus de 120.000 personnes qui y sont recensées.[31] En moyenne, cela fait 1.600 personnes en plus par an pendant vingt ans sur un territoire de 17,7 kilomètres carrés.
À ce constat vient se greffer un autre phénomène lié à l’institutionnalisation progressive des EDD : être perçues comme un service public de l’administration. Les parents savent que les EDD sont subventionnées et qu’elles organisent leurs activités en fonction de ces subsides. Pour Teresa, « ça change vraiment beaucoup (le contexte de travail) », par rapport à une situation où les parents savaient que le travail réalisé par le CASI était réalisé bénévolement. « Et avec cette idée de gratuité, on donnait l’image qu’on travaillait pour eux. » Aujourd’hui, cela va même parfois jusqu’à « des menaces et une certaine “prepotenza”[32] » de la part de quelques parents. Car sur fond d’essor démographique, la guerre des places fait rage, et le CASI est alors confronté à des situations délicates que partage Teresa : « Vous devez inscrire mon enfant à l’école des devoirs parce que moi, j’habite Anderlecht », déclarent certains parents, « j’ai le droit et je suis prioritaire par rapport à d’autres et vous êtes payés pour faire ça ! »[33].
Malgré l’augmentation du nombre d’EDD à Anderlecht, qui se situe aujourd’hui à une vingtaine d’antennes selon Giulio, une concurrence entre les parents s’installe afin d’assurer une place pour leurs enfants. Cette situation entraine ce que Teresa nomme le « shopping social ». L’école renvoie les parents des élèves, qui n’arrivent pas à suivre, vers les EDD. Ce phénomène démontre, selon Giulio, la méconnaissance scolaire des réalités de travail des EDD, « ils nous renvoient la balle sans savoir qu’il n’y a pas de place dans les écoles des devoirs ». Donc, continue Teresa, les parents effectuent « le tour des écoles des devoirs du quartier en ne demandant ni la charte, ni le programme, ni le projet, mais : combien de jours ? combien ça coûte ? Et des garanties de réussite. C’est tout. »
Dans un système scolaire inégalitaire, les parents reportent tout simplement la pression sur les EDD. Une démarche qui apparait comme légitime, les parents souhaitant avant tout la réussite de leurs enfants. Le CASI en est bien conscient, lorsqu’il écrit qu’en « dépit de certains discours qui voudraient culpabiliser les familles pour les échecs des jeunes, nous remarquons que, dans la majorité des cas, les classes populaires mettent en place des stratégies qu’elles ont à disposition pour donner des possibilités de réussite à leurs enfants »[34].
Bien que légitime, cette démarche apporte donc son lot de complications pour le CASI,qui, de son côté, poursuit l’objectif de convaincre les parents que le but de l’EDD n’est pas uniquement de faire de l’accompagnement aux devoirs, mais bien d’amener les enfants à plus d’autonomie. Cela, afin de viser une réelle émancipation des jeunes « dans l’école mais également dans sa vie quotidienne », explique Giulio. Un projet pédagogique et de société auquel les parents n’adhèrent pas nécessairement. L’inscription de l’enfant aux activités de l’EDD passe alors par une discussion menée avec les parents. « On essaye de casser des mécanismes qui mènent l’école des devoirs à ne répondre qu’aux besoins de l’école […], surtout dans des quartiers où il n’existe pas d’écoles à pédagogie active et positive. » Lors de la signature de la convention qui lie les parents, les enfants et le CASI, l’équipe explique la manière de travailler prônée dans la structure et les parents s’engagent à participer à certaines activités, telles que les formations ou des rencontres informelles d’échange de vécu.
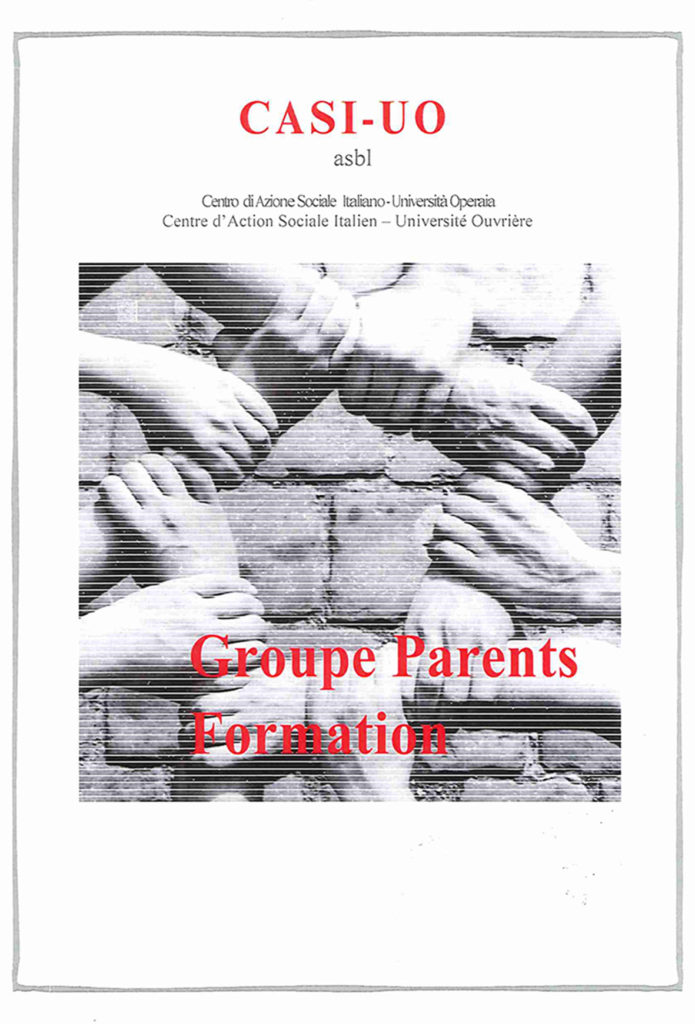
-
- Mobilité plus restreinte
Comme dans les années 1970, l’équipe de l’EDD explore les questions d’appropriation des espaces et de déplacements dans la cité, explique Teresa, « car lorsqu’on travaille avec une population précaire, il y a toute cette notion de réduction de la mobilité qui est en jeu ». Giulio poursuit : « Ils ne connaissent pas grand-chose de la ville dans laquelle ils vivent. Ils sont vraiment dans des mobilités hyper restreintes : maison – école – école des devoirs – maison ». Parfois, on ajoute la case « shopping » sur la carte, ajoute Teresa, « mais c’est à peu près tout ».
Nous ne sommes effectivement pas toutes et tous égaux devant les déplacements. La mobilité nécessite non seulement des moyens financiers importants, « mais aussi une certaine “culture” du déplacement qui s’acquiert par l’éducation et l’expérience. Se déplacer, surtout dans des environnements neufs, exige des compétences cognitives qui permettent de se former une représentation des lieux où l’on doit se mouvoir, du trajet à effectuer, des horaires, etc. Certaines personnes ont du mal à se déplacer au-delà de 10 km de leur domicile. Au-delà de cette zone, il s’agit de l’”inconnu”, d’un endroit qui fait peur »[35].
Cherchant à objectiver cette impression de mobilité toujours plus restreinte pour ses publics, Teresa explique que l’équipe initie une « activité “carte mentale intergénérationnelle” avec des ados et la première génération d’immigrés italiens, pour pouvoir comparer. Et il en résulte que la première génération d’immigrés avait un parcours plus large ». Devant ce constat plutôt alarmant et dans le but d’y remédier, l’équipe utilise les moments qui ne relèvent pas directement de la remédiation scolaire : « Ce que l’on a fait pendant les stages, c’est sortir l’enfant du quartier et lui faire découvrir autre chose, car il y a des enfants qui ne connaissent pas d’autres communes de Bruxelles, pour aller dans un musée ou toute autre activité. Et nous, on essaie d’élargir ce parcours ». Il est important « d’ouvrir la curiosité des enfants pour d’autres expériences », continue Teresa. Giulio nous explique qu’en partenariat avec des associations anderlechtoises, ils tentent de travailler sur la question de l’espace, de la parole et de la coopération en s’inspirant de pédagogies telles que celles de l’école de Barbiana ou de Célestin Freinet[36], « et de vraiment leur faire comprendre la place et le rôle qu’ils ont au sein de la société. Et qu’ils ne doivent pas lâcher et louper la possibilité de pouvoir s’élever dans cette société ».

Perspectives d’avenir : faire réseau et redevenir un contre-pouvoir
Après bientôt cinquante ans d’existence pour les plus anciennes écoles de devoirs, comment appréhender l’avenir et quelles perspectives envisager pour le secteur ? De l’avis de Teresa, « même si on est reconnu, si on a un cadre législatif, si on reçoit des subsides, l’école des devoirs n’est en aucun cas la continuité de l’école ». L’apport de moyens financiers supplémentaires ne résout pas la question de fond, poursuit-elle, « l’école des devoirs doit redevenir un contre-pouvoir. Sinon on ne s’en sortira pas, car on n’est pas un service. S’il faut s’organiser pour les enfants et pour les accompagner, il faut aussi dénoncer, avoir un projet politique, ne pas travailler seuls mais en réseau avec les autres écoles (des devoirs). C’est primordial car seul, on n’arrive à rien ». Pour cela, elle estime nécessaire de « repartir avec les groupes de base » d’habitant.e.s et d’organiser dans toutes les EDD des groupes de soutien aux parents, afin de les aider à affronter les nombreux défis auxquels ils sont confrontés.
Avant de relancer des groupes de base, Teresa souhaite réactualiser une pratique utilisée avec succès par le CASI-UO à ses débuts, mais tombée quelque peu en désuétude ces deux dernières décennies : « Pour moi (l’avenir), c’est repartir avec des enquêtes. […] Car les enquêtes te donnent aussi une analyse globale qui te permet de mieux agir. C’est repartir de la théorie pour faciliter la pratique et travailler en réseau. Si on travaille comme ça, ça a du sens ». L’enquête ouvrière, outil structurel et formateur du Mouvement ouvrier chrétien, notamment popularisé par la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) dans les années 1920[37], semble effectuer un retour en grâce ces dernières années. En attestent les différents articles du monde associatif et syndical qui lui sont consacrés.[38]
Enfin, Teresa rappelle la nécessité, aux yeux du CASI, de sortir de la remédiation scolaire. Elle estime primordial que les acteurs du secteur voient « l’école des devoirs comme une action politique et pas comme une activité de services parascolaires. Ce sont des activités nécessaires, il faut s’occuper des enfants, des parents mais il faut aller au-delà ».
Pour ces raisons, le CASI et une douzaine d’autres associations anderlechtoises se sont regroupées pour former le CAPES (Centre Accueil Parents Enfants Scolarité), un réseau d’écoles de devoirs, mais qui n’est pas pour autant une coordination officielle d’EDD, et qui entend mener une action sur deux niveaux, pédagogique et politique. Composé de centres de jeunes, de maisons des enfants, de centres alpha et d’associations d’éducation permanente, le CAPES bénéficie d’une diversité qui fait « sa richesse et qui donne aussi une vision beaucoup plus transversale de la société », estime Giulio.
Giulio précise que le projet est géré indépendamment du pouvoir communal et de manière horizontale, les différents acteurs y siègent avec le même statut. L’avantage, selon lui, est qu’on y discute de visions politiques : « Ce qu’il y a derrière l’école des devoirs, sa raison d’être et les raisons d’être des inégalités dans les écoles, qui sont à l’origine de ce système ». Pour le CAPES, il est extrêmement important « de ne pas abandonner la problématique d’origine », précise Giulio, « qui est que, si l’école des devoirs existe dans les quartiers populaires et dans ce format, c’est parce qu’il y a un problème structurel au niveau de l’école. Et qu’il ne faut surtout pas oublier de le traiter pour améliorer la société dans son ensemble et ne pas mettre un emplâtre sur une jambe de bois, pour soigner une énorme blessure qui est celle de l’école ».
Selon Giulio, il est indéniable que les discussions du CAPES aident les EDD à se réapproprier leur travail, à en comprendre les raisons profondes et leur rôle dans la cité. Et seul, précise-t-il, « on n’a aucun poids. On s’est mis ensemble pour réfléchir à tout un tas de questions qui nous touchent tous dans ce milieu-là et essayer de porter ensemble des questions adressées aux politiques, aux PO et aux autres (acteurs). (…) À nous de nous autoorganiser pour créer notre autonomie, sans attendre que les communes ou les autres institutions nous fédèrent ». L’enjeu, termine Giulio, « c’est de réinscrire les écoles de devoirs de façon beaucoup plus forte dans un rôle beaucoup plus politique, et, avec d’autres partenaires, de créer d’autres réseaux qui portent la voix du milieu populaire et un changement du fonctionnement structurel de l’école ». Finalement, comme le CASI l’écrit déjà dans les années 1970, Giulio est convaincu que les EDD ne doivent pas se concentrer sur les devoirs, mais plutôt « travailler à l’émancipation des jeunes enfants, via tous types d’activités socioculturelles, […] parce que les devoirs, les enfants en ont suffisamment à l’école ».
Conclusion : cinquante ans et après ?
Les témoignages retranscrits dans cette analyse doivent nécessairement être remis en perspective. Il ne s’agit nullement ici de présenter une étude exhaustive sur le secteur des écoles des devoirs. Les paroles de Teresa et de Giulio ouvrent les portes sur le parcours d’une EDD qui s’inscrit dans un contexte particulier, bruxellois, anderlechtois, cureghemois même, dans lequel la précarité sociale culturelle et économique est prégnante et dont l’identité de quartier est sans doute unique. Néanmoins, à travers l’évolution de l’EDD du CASI, il est possible de percevoir des points de tensions, moments cruciaux et enjeux qui peuvent traverser et questionner l’ensemble du secteur depuis ses débuts.
Les conditions ont évolué depuis les années 1970. Le décret de 2004, pour ne citer que lui, engendre de nombreux bouleversements à de multiples points de vue. Il prévoit notamment des objectifs de cohésion sociale et contient, sur papier, un projet de changement sociétal et d’émancipation. Dans les faits, les EDD déplorent manquer cruellement de moyens humains, financiers et structurels pour faire leur travail correctement et rencontrer ces objectifs. Surtout, aux yeux de Giulio et Teresa, le nœud du problème persiste : si l’école des devoirs existe dans les quartiers populaires et dans ce format, c’est qu’elle résulte d’un problème structurel au niveau de l’école. Et les chiffres de l’OCDE l’attestent, ce problème n’est aujourd’hui pas réglé.
Les éléments mis en lumières dans cette analyse permettent de dégager de nouvelles pistes de travail qu’il pourrait être intéressant d’exploiter. L’évolution des relations de l’EDD avec l’école, la précarisation grandissante de leurs publics ou leur mobilité restreinte à travers les époques, mais également le renouveau de l’attrait du Mouvement ouvrier pour les enquêtes, sont autant de questions qui méritent sans doute d’être travaillées.
Quant à Teresa, elle souhaite aujourd’hui se tourner résolument vers l’avenir. Pour cela, elle s’autorise à s’appuyer sur le vécu de l’institution : « Le CASI raconte une longue existence. Cinquante ans de CASI, c’est à la fois beaucoup et peu en même temps. Une association qui a cinquante ans d’existence n’a pas vécu tant d’années sans raison et cette longévité lui donne une plus-value, une légitimité et une histoire. Je considère que c’est une belle histoire qui raconte l’évolution de toute l’immigration et pas seulement celle de la communauté italienne. Une histoire faite de difficultés, de résistances, mais aussi d’intelligences, car on a uni nos intelligences, nos richesses et nos faiblesses ». Maintenant, continue-t-elle, « il faut préparer la relève ». Alors, afin d’aborder le futur, elle évoque « un nouveau défi au CASI qui est la nouvelle immigration italienne », arrivée à partir de 2008 en conséquence de la crise bancaire et financière. Actuellement, « on termine une enquête sur cette nouvelle immigration ». Une nouvelle enquête de terrain pour démarrer un nouveau cycle. La boucle est bouclée…
Notes
[1] Centro di azione sociale italiano – Università Operaia en italien.
[2] Voir à ce propos : Coenen M.-Th., RousseL L., L’université ouvrière en milieu immigré : l’arme de la culture. L’expérience du CASI-UO de 1970 à 1980 », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 5-6 : Les universités ouvrières, un enjeu contemporain, mars-juin 2018, mis en ligne le 3 avril 2018. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2018/03/20180330_CASI_UO.pdf
[3] CARHOP, interview de Teresa Butera réalisée par Julien Tondeur le 30 octobre 2020. Sauf mention contraire, toutes les citations de Teresa proviennent de cette interview.
[4] Cureghem agit, à l’époque comme aujourd’hui, comme point d’entrée dans la ville pour les migrant.e.s. Quartier de transit et d’identités multiples, il regroupe aujourd’hui plus de 25.000 personnes de 120 nationalités différentes, originaires de tous les continents. Près de la moitié de ses habitant.e.s sont des primo-arrivant.e.s. Voir : EL YAHIAOUI C., MORMONT M., « Les identités de Cureghem sous les projos », Alter-échos, n° 435-436, 22 décembre 2016 [En ligne] URL : https://www.alterechos.be/les-identites-de-cureghem-sous-les-projos/
[5] EISS, « Ente italiano di servizio sociale : o emigranti, o briganti (una forma di emarginazione di cui si parla poco) a cura del gruppo « Universita Operaia » di Bruxelles », p. 20, dans VISTOSI G., « Expression de foi et conscience de classe dans une Communauté d’ouvriers italiens immigrés : le groupe CASI-UO d’Anderlecht (Bruxelles) », Mémoire de licence en catéchèse et en pastorale, Lumen Vitae-Institut international de catéchèse et de pastoral – Faculté de théologie UCL, Bruxelles-Louvain, p. 55.
[6] COENEN M.-Th., ROUSSEL L., « L’université ouvrière en milieu immigré : l’arme de la culture – L’expérience du CASI-UO de 1970 à 1980 » ...
[7] COENEN M.-Th., ROUSSEL L., « L’université ouvrière en milieu immigré : l’arme de la culture – L’expérience du CASI-UO de 1970 à 1980 » ...
[8] Lorsqu’ils fondent le CASI-UO, les militant.e.s ont dans leur poche la Lettre à une Maîtresse d’École, ouvrage fondateur en matière d’éducation des populations défavorisées en Italie. Pour comprendre le rapport entretenu par le CASI-UO avec cette « doposcuola » de Barbiana, voir notamment : CASI-UO, VICARI P., « Le CASI-UO et l’école des devoirs », La Piazza. Bulletin d’information du CASI-UO, n° 77, décembre 2004, p. 6-7.
[9] COENEN M.-Th., ROUSSEL L., « L’université ouvrière en milieu immigré : l’arme de la culture – L’expérience du CASI-UO de 1970 à 1980 » ... et TONDEUR J., « L’action par la culture au CASI-UO. Dire l’immigration en textes et en chansons », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n°5-6 : Les universités ouvrières, un enjeu contemporain, mars-juin 2018, mis en ligne le 3 avril 2018. URL : http://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2018/03/20180330_Disques_CASI_UO-1.pdf
[10] « Le moulage des europarias. Situation des immigrés italiens dans l’école belge », dans Cahiers de l’immigration, n° 2, Bruxelles, Centro di Azione Sociale Italiano, 1976, p. 20.
[11] « Le moulage des europarias… », p. 23.
[12] DE SMET N., « École de devoirs…mais quels devoirs ? !. D’après les paroles de Teresa BUTERA recueillies par Noëlle DE SMET», TRACeS de ChanGements, n° 206, Réduire l’échec scolaire, mai-juin 2012. [En ligne] URL : https://www.changement-egalite.be/Ecole-de-devoirs-mais-quels
[13] DE SMET N., « École de devoirs… «
[14] CASI-UO, Écoles alternatives et quartiers populaires, Bruxelles, 1975, p. 9.
[15] CASI-UO, Écoles alternatives … p. 8.
[16] Voir : COENEN M.-Th., ROUSSEL L., « L’université ouvrière… », et TONDEUR J., « L’action par la culture… ».
[17] MOREAU L., ROSSION D., État des lieux des réalisations, besoins et enjeux des écoles de devoirs en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2011-2014, Bruxelles, Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et l’aide à la Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016, p. 22. [En ligne] URL : https://oejaj.cfwb.be/fileadmin/sites/oejaj/uploads/PublicationsTravaux/Rapports_d_evaluation/Etat_des_lieux_EDD/Rapport_2011-14.pdf
[18] Le premier siège du CASI-UO se situe au n° 5, rue des Matériaux, à Anderlecht, ensuite au n° 211, rue Adolphe Willemyns et aujourd’hui, au n° 94, rue Saint-Guidon, toujours à Anderlecht.
[19] CARHOP, interview de Giulio Iacovone réalisée par Julien Tondeur le 4 novembre 2020. Sauf mention contraire, toutes les citations de Giulio proviennent de cette interview.
[20] « La proportion de familles monoparentales est plus élevée à Anderlecht (11,9 %) que dans l’ensemble de la Région (10,9 %). Cette proportion s’élève à 33,3 % de l’ensemble des familles avec enfants, ce qui représente une proportion assez élevée parmi les communes bruxelloises. », dans Fiches communales d’analyse des statistiques locales en Région bruxelloise. Fiche 1 : Commune d’Anderlecht, Bruxelles, ULB-IGEAT et Observatoire de la santé et du social, Édition 2/2010, p. 14. [En ligne] URL : https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/fiches-communales/2010/01_anderlecht_fr.pdf
[21] COENEN M.-Th., « Introduction au dossier : Les écoles de devoirs : un engagement militant et politique », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 13 : Les écoles de devoirs : regard de l’histoire sur les mobilisations actuelles, décembre 2020, mis en ligne le 7 janvier 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/wp-content/uploads/2021/01/2021_RD_13_Intro_VD.pdf
[22] VICARI P., « Le CASI-UO et l’école des devoirs », La Piazza. Bulletin d’information du CASI-UO, n° 77, décembre 2004, p. 6-7.
[23] COENEN M.-Th., « Introduction au dossier… »
[24] ChanGements pour l’égalité est un mouvement socio-pédagogique, reconnu comme association d’éducation permanente, qui a pour objet social de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la formation en Communauté française de Belgique dans une perspective d’égalité et de démocratie.
[25] Le Pouvoir organisateur (PO) est l’organe représentant les pouvoirs publics subventionnés qui organisent des établissements scolaires de l’enseignement secondaire, supérieur, de promotion sociale et des centres psycho-médico-sociaux.
[26] Organisation de coopération et de développement économiques.
[27] BAMPS N., « La Belgique reste mauvaise élève en termes d’égalité à l’école », lecho.be, mis en le 23 octobre 2018. URL : https://www.lecho.be/dossier/enseignement/la-belgique-reste-mauvaise-eleve-en-termes-d-egalite-a-l-ecole/10062020.html . Pour le rapport de l’OCDE, voir : http://www.oecd.org/education/equity-in-education-9789264073234-en.htm
[28] HIRTT N., « Pourquoi sommes-nous les champions de l’inégalité scolaire ? Des causes de l’illettrisme », Journal de l’alpha, n° 167-168, p. 49. [En ligne] URL : https://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/images/documents/pdf/analyses2009/pourquoi_sommes_nous_les_champions_de_l_inegalite.pdf
[29] IACOVONE G., MORETTI M.-T., « CASI-UO, Le regard Écoles des devoirs », Bruxelles en mouvements, Inter-environnement-Bruxelles, Fédération de comités de quartier et groupes d’habitants, n° 286, janvier-février 2017, p. 18.
[30] Fiches communales d’analyse des statistiques locales en Région bruxelloise. Fiche 1 : Commune d’Anderlecht, Bruxelles, ULB-IGEAT et Observatoire de la Santé et du Social, Analyse des statistiques locales, Édition 2/2010, p. 9. [En ligne] URL : https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/fiches-communales/2010/01_anderlecht_fr.pdf
[31] Site WEB : IBSA.brussels, Institut bruxellois de statistique et d’analyse. URL : https://ibsa.brussels/chiffres/chiffres-cles-par-commune/anderlecht
[32] Prepotenza signifie arrogance en italien.
[33] CARHOP, interview de Teresa Butera réalisée par Julien Tondeur le 30 octobre 2020.
[34] IACOVONE G., MORETTI M.-T., « CASI-UO… »
[35] HUENS V., « Mobilité des travailleurs. Défis et outils pour les entreprises d’économie sociale », SAW-B novembre 2008, p. 1.
[36] Pédagogue français, Célestin Freinet (1896-1966) développe, avec sa femme Élise, une série de techniques basée sur l’expression libre des enfants. Militant engagé, il conçoit l’éducation comme un moyen de progrès et d’émancipation politique et civique.
[37] COENEN M.-T., DELVAUX A.-L., « L’enquête sociale, un outil d’éducation populaire », Le Chou de Bruxelles, Mouvements. Clés pour l’action populaire, CIEP-MOC Bruxelles, n° 1, septembre 2020, p. 39.
[38]MORVAN A., « Redécouvrir l’enquête ouvrière », Offensive, n° 34, juin 2012 [En ligne] URL : https://offensiverevue.files.wordpress.com/2015/02/offensive34.pdf ; RYDBERG E., « L’enquête ouvrière : chantier d’avenir ? », Éconosphères, mis en ligne le 21 septembre 2018. URL : http://www.econospheres.be/L-enquete-ouvriere-chantier-d-avenir
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
Tondeur J., « L’école des devoirs du CASI-UO, une activité seconde mais pas secondaire », Dynamiques. Histoire sociale en revue, n° 14 : Les écoles de devoirs (partie II). Des expériences militantes, mars-juin 2021, mis en ligne le 1er juin 2021. URL : https://www.carhop.be/revuescarhop/
